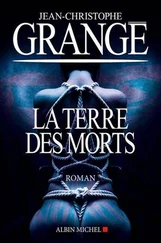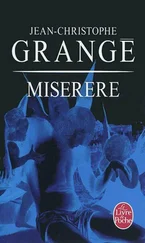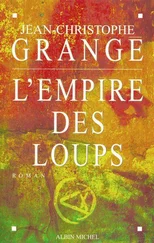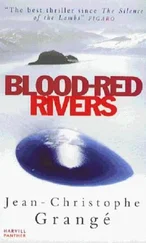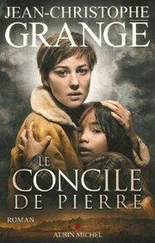Le jour vint. Un matin de septembre. Ils avaient ensemble quitté Paris, au milieu de juillet, et passé les dernières semaines qui lui restaient, en Engadine, près du pays où ils s’étaient retrouvés, il y avait six ans déjà.
Depuis cinq jours, ils n’avaient pu sortir: la pluie tombait sans relâche; ils étaient restés presque seuls à l’hôtel; la plupart des voyageurs avaient fui. Ce dernier matin, la pluie cessa enfin; mais la montagne restait vêtue de nuages. Les enfants partirent d’abord, avec les domestiques, dans une première voiture. À son tour, elle partit. Il l’accompagna jusqu’à l’endroit où la route descendait en lacets rapides sur la plaine d’Italie. Sous la capote de la voiture, l’humidité les pénétrait. Ils étaient serrés l’un contre l’autre, et ils ne se parlaient pas; ils se regardaient à peine. L’étrange demi-jour demi-nuit qui les enveloppait!… L’haleine de Grazia mouillait d’une buée sa voilette. Il pressait la petite main tiède sous le gant glacé. Leurs visages se joignirent. À travers la voilette humide, il baisa la chère bouche.
Ils étaient arrivés au tournant du chemin. Il descendit. La voiture s’enfonça dans le brouillard. Elle disparut. Il continuait d’entendre le roulement des roues et les sabots du cheval. Les nappes de brumes blanches coulaient sur les prairies. Sous le réseau serré, les arbres transis pleuraient. Pas un souffle. Le brouillard bâillonnait la vie. Christophe s’arrêta, suffoquant… Rien n’est plus. Tout est passé…
Il aspira largement le brouillard. Il reprit son chemin. Rien ne passe, pour qui ne passe point.
L’absence ajoute encore au pouvoir de ceux qu’on aime. Le cœur ne retient d’eux que ce qui nous est le plus cher. L’écho de chaque parole qui, par delà les espaces, vient de l’ami lointain, vibre dans le silence, religieusement.
La correspondance de Christophe et de Grazia avait pris le ton grave et contenu d’un couple qui n’en est plus à l’épreuve dangereuse de l’amour, mais qui, l’ayant passée, se sent sûr de sa route et marche, la main dans la main. Chacun des deux était fort pour soutenir et pour diriger l’autre, faible pour se laisser diriger et soutenir par lui.
Christophe retourna à Paris. Il s’était promis de n’y plus revenir. Mais que valent ces promesses! Il savait qu’il y trouverait encore l’ombre de Grazia. Et les circonstances, conspirant avec son secret désir contre sa volonté, lui montrèrent à Paris un devoir nouveau à remplir. Colette, très au courant de la chronique mondaine, avait appris à Christophe que son jeune ami Jeannin était en train de faire des folies. Jacqueline, qui avait toujours été d’une grande faiblesse envers son fils, n’essayait plus de le retenir. Elle passait elle-même par une crise singulière: trop occupée de soi, pour s’occuper de lui.
Depuis la triste aventure qui avait brisé son mariage et la vie d’Olivier, Jacqueline menait une existence très digne et retirée. Elle se tenait à l’écart de la société parisienne, qui, après lui avoir hypocritement imposé une sorte de quarantaine, lui avait de nouveau fait des avances, qu’elle avait repoussées. De son action elle n’éprouvait vis-à-vis de ces gens nulle honte; elle estimait qu’elle n’avait pas de compte à leur rendre: car ils valaient moins qu’elle; ce qu’elle avait accompli franchement, la moitié des femmes qu’elle connaissait le pratiquaient sans bruit, sous le couvert protecteur du foyer. Elle souffrait seulement du mal qu’elle avait fait à son meilleur ami, au seul qu’elle eût aimé. Elle ne se pardonnait pas d’avoir perdu, dans un monde aussi pauvre, une affection comme la sienne.
Ces regrets, cette peine, s’atténuèrent peu à peu. Il ne subsista plus qu’une souffrance sourde, un mépris humilié de soi et des autres, et l’amour de son enfant. Cette affection, où se déversait tout son besoin d’aimer, la désarmait devant lui; elle était incapable de résister aux caprices de Georges. Pour excuser sa faiblesse, elle se persuadait qu’elle rachetait ainsi sa faute envers Olivier. À des périodes de tendresse exaltée succédaient des périodes d’indifférence lassée; tantôt elle fatiguait Georges de son amour exigeant et inquiet, tantôt elle paraissait se fatiguer de lui, et elle le laissait tout faire. Elle se rendait compte qu’elle était une mauvaise éducatrice, elle s’en tourmentait; mais elle n’y changeait rien. Quand elle avait (rarement) essayé de modeler ses principes de conduite sur l’esprit d’Olivier, le résultat avait été déplorable; ce pessimisme moral ne convenait ni à elle, ni à l’enfant. Au fond, elle ne voulait avoir sur son fils d’autre autorité que celle de son affection. Et elle n’avait pas tort: car entre ces deux êtres, si ressemblants qu’ils fussent, il n’était d’autres liens que du cœur. Georges Jeannin subissait le charme physique de sa mère; il aimait sa voix, ses gestes, ses mouvements, sa grâce, son amour. Mais il se sentait, d’esprit, étranger à elle. Elle ne s’en aperçut qu’au premier souffle de l’adolescence, lorsqu’il s’envola loin d’elle. Alors, elle s’étonna, elle s’indigna, elle attribua cet éloignement à d’autres influences féminines; et, en voulant maladroitement les combattre, elle ne fit que l’éloigner davantage. En réalité, ils avaient toujours vécu, l’un à côté de l’autre, préoccupés chacun de soucis différents et se faisant illusion sur ce qui les séparait, grâce à une communion de sympathies et d’antipathies à fleur de peau, dont il ne resta plus rien quand de l’enfant (cet être ambigu, encore tout imprégné de l’odeur de la femme) l’homme se dégagea. Et Jacqueline disait, avec amertume, à son fils:
– Je ne sais pas de qui tu tiens. Tu ne ressembles ni à ton père, ni à moi.
Elle achevait ainsi de lui faire sentir tout ce qui les séparait; et il en éprouvait un secret orgueil, mêlé de fièvre inquiète.
Les générations qui se suivent ont toujours un sentiment plus vif de ce qui les désunit que de ce qui les unit; elles ont besoin de s’affirmer leur importance de vivre, fût-ce au prix d’une injustice ou d’un mensonge avec soi-même. Mais ce sentiment est, suivant l’époque, plus ou moins aigu. Dans les âges classiques où se réalise, pour un temps, l’équilibre des forces d’une civilisation, – ces hauts plateaux bordés de pentes rapides, – la différence de niveau est moins grande d’une génération à l’autre. Mais dans les âges de renaissance ou de décadence, les jeunes hommes qui gravissent ou dévalent la pente vertigineuse laissent loin, par derrière, ceux qui les précédaient. – Georges, avec ceux de son âge, remontait la montagne.
Il n’avait rien de supérieur, ni par l’esprit, ni par le caractère: une égalité d’aptitudes, dont aucune ne dépassait le niveau d’une élégante médiocrité. Et cependant, il se trouvait, sans efforts, au début de sa carrière, plus élevé de quelques marches que son père, qui avait dépensé, dans sa trop courte vie, une somme incalculable d’intelligence et d’énergie.
À peine les yeux de sa raison s’étaient ouverts au jour qu’il avait aperçu autour de lui cet amas de ténèbres transpercées de lueurs éblouissantes, ces monceaux de connaissances et d’inconnaissances, de vérités ennemies, d’erreurs contradictoires, où son père avait fiévreusement erré. Mais il avait en même temps pris conscience d’une arme qui était en son pouvoir, et qu’Olivier n’avait jamais connue: sa force…
D’où lui venait-elle?… Mystères de ces résurrections d’une race, qui s’endort épuisée, et se réveille débordante, comme un torrent de montagne, au printemps!… Qu’allait-il faire de cette force? L’employer, à son tour, à explorer les fourrés inextricables de la pensée moderne? Ils ne l’attiraient point. Il sentait peser sur lui la menace des dangers qui s’y tenaient embusqués. Ils avaient écrasé son père. Plutôt que de renouveler l’expérience et de rentrer dans la forêt magique, il y eût mis le feu. Il n’avait fait qu’entr’ouvrir ces livres de sagesse ou de folie sacrée dont Olivier s’était grisé: la pitié nihiliste de Tolstoy, le sombre orgueil destructeur d’Ibsen, la frénésie de Nietzsche, le pessimisme héroïque et sensuel de Wagner. Il s’en était détourné avec un mélange de colère et d’effroi. Il haïssait la lignée d’écrivains réalistes qui, pendant un demi-siècle, avaient tué la joie de l’art. Il ne pouvait cependant effacer tout à fait les ombres du triste rêve dont son enfance avait été bercée. Il ne voulait pas regarder derrière lui; mais il savait bien que derrière lui, l’ombre était. Trop sain pour chercher un dérivatif à son inquiétude dans le scepticisme paresseux de l’époque précédente, il abominait le dilettantisme des Renan et des Anatole France, comme une dépravation de la libre intelligence, le rire sans gaieté, l’ironie sans grandeur: moyen honteux, et bon pour des esclaves, qui jouent avec leurs chaînes, impuissants à les briser!
Читать дальше