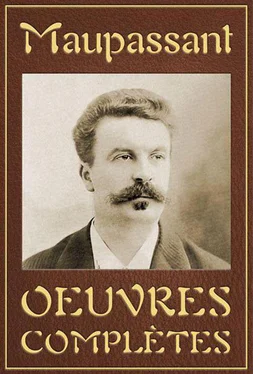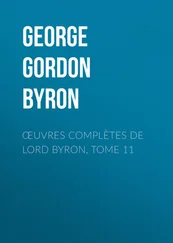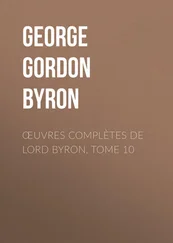C’est M. Gabriel Charmes, l’éminent rédacteur des Débats, qui a abandonné l’Égypte anglaise pour la côte charmante du Midi français, et qui continue ses études si intéressantes sur le rôle de la torpille dans les guerres maritimes.
Voici Beaulieu, le bien nommé. Puis Monaco, Monte-Carlo, dont les noms sonnent comme des sacs d’écus. Admirables villes habitées par la plus odieuse population de la terre. Je parle de la population volante — sans jeu de mots ; — une cour des Miracles, une race de chiffonniers, un quartier peuplé de mendiants sont moins horribles que ce mélange de vieilles femmes à cabas, d’aventuriers et de gens du monde qui entourent les tables de jeu. On n’imagine point ce public interlope, étrange et répugnant.
Mais qu’il est admirable le vieux Monaco, sur son roc au pied de l’énorme montagne où l’on voit poindre, tout en haut, un fort français. Monte-Carlo n’est pas seulement la patrie de la roulette, c’est aussi celle de la musique. On y donne de magnifiques concerts, et on y rencontre tous les artistes du monde : voici Mme Nilsson qui cause avec M. Faure, voici Mme Heilbron, Mme Franck-Duvernoy qui vient d’être acclamée dans le premier acte d’Hérodiade chanté par elle en grande artiste.
Et là-bas c’est Menton, le point le plus chaud de la côte, le pays préféré des malades.
Donc les Parisiens quittent la Méditerranée et rentrent à Paris.
Mais alors quelles sont les gens qui peuplent Paris en l’absence des vrais Parisiens qui n’y sont jamais ? Car la ville est toujours pleine, hiver comme été ; et il serait bien difficile à un ignorant de dire si les Parisiens sont ou ne sont pas à Paris.
— Les gens qui restent, monsieur, sont les provinciaux de Paris.
— Ah ! Très bien, mais à quoi les reconnaît-on ?
— On les reconnaît à leurs mœurs. Je veux dire que, ne quittant jamais une ville qu’il est de bon ton de quitter à certaines époques, ils vivent dedans comme des provinciaux encroûtés.
Je dois ajouter qu’il existe à Paris plusieurs sortes de provinciaux parisiens :
1 °Ceux pour qui Paris constitue l’univers entier et qui ignorent Argenteuil autant que Londres ou Saint-Pétersbourg. Rien n’existe pour eux en dehors de ce qui se fait dans l’enceinte des fortifications. Ceux-là ne connaissent point d’autres arbres que ceux des boulevards, d’autres nouvelles que celles du boulevard, d’autre chemin de fer que celui de la Ceinture. Ils vivent une vie affairée, mouvementée, étroite et pressée. Ils sont toujours en retard de dix minutes en tout ce qu’ils font ; ce qui les empêche de jamais penser longuement à des choses profondes, de jamais entreprendre un travail de grande étendue, de connaître autre chose que les besognes rapides, les plaisirs immédiats, les affaires urgentes de l’existence parisienne. Ils méprisent la province, les voyages, la mer, les bois, les peuples voisins, les mœurs des Anglais, des Allemands, des Russes et des Américains, ces provinciaux du trottoir parisien ! Ils se moquent de ce qu’ils ne savent pas, de ce qu’ils ne comprennent pas, de ce qu’ils ne connaissent pas, persuadés d’avance que rien ne vaut leur intelligence harcelée par de menues occupations.
Ils se disent et se croient les Parisiens par excellence, les seuls spirituels des hommes, les seuls connaisseurs en art, les seuls dentistes de la terre.
Les deux pôles de leur préoccupation sont le journal ou le théâtre. Ils se passionnent pour tout ce qu’on fait à Paris.
2° A côté d’eux vit le peuple innombrable des vrais provinciaux, enfermés dans Paris, comme on le serait dans une prison. Il se divise en tribus nombreuses : tribu des employés, tribu des fonctionnaires, tribu des commerçants, tribu du vieux faubourg. Ils vivent ceux-là entre eux, dans leur société. Ils voient leurs connaissances, leur monde, sans se douter que Paris, le vrai Paris est fait de cent mondes différents, et que chacun renferme des mystères étranges. Ils ne se doutent pas que le vrai Parisien, lui, connaît tous ces mondes, les aime et les fréquente, se trouve chez lui partout, parle avec chacun suivant sa langue et sa morale.
Les gens attardés de ce qu’on appelle encore le faubourg Saint-Germain — provinciaux.
La société des Ponts et Chaussées, par exemple, si particulière, fermée, vivant suivant des traditions, si préoccupée de hiérarchies et de convenances, monde honorable entre tous, mais morne et éteint, est-ce autre chose qu’un monde de province à Paris ?
Chaque quartier a ses provinciaux différents chez qui on retrouve toujours les traits caractéristiques du provincial. Chaque rue est une province où on voisine, où on potine, où on complote, où on végète comme à Carpentras, où on ignore les choses importantes du jour, de la vraie vie du monde, le mouvement de la ville et des peuples voisins, l’activité de la pensée humaine en travail, les livres, les arts, la science.
Le vrai Parisien, au contraire, qui se trouve dans toutes les classes, dans toutes les professions, dans tous les milieux, ignore son voisinage, ne sait pas les noms des locataires de sa maison, mais connaît ceux de tous les gens célèbres, possède leur histoire et leurs œuvres, pénètre dans tous les salons, s’occupe et se préoccupe de toutes les manifestations de l’esprit, ne se perdrait pas plus dans Nice, dans Florence ou dans Londres que dans Paris. Il vit de la vie générale et non d’une vie cloîtrée comme le provincial. Il n’a guère de morale et guère de croyance, guère d’opinion et guère de religion, bien qu’il en montre par décence et par savoir-vivre ; il s’intéresse à tout sans se passionner plus d’une semaine au plus. Son esprit est ouvert à tout, accepte tout, regarde tout, s’amuse de tout et se moque de tout après avoir un peu cru à tout.
La Chine des poètes
( Gil Blas , 17 mars 1885)
« Allez au pays de Chine
Et sur ma table apportez
Le papier de paille fine
Plein de reflets argentés. »
C’est ainsi que parle un poète qui adore la Chine : Louis Bouilhet.
Qu’est-ce au juste que la Chine, dont on parle tant en ce moment, la Chine de M. Ferry ? Personne ne le sait, et le président du Conseil pas plus que moi.
Nous avons lu sur elle des livres singuliers, des récits bizarres. Nous nous sommes fatigué les yeux sur des cartes de géographie où sont écrits des milliers de noms invraisemblables, et puis nous avons rêvé. Alors dans un brouillard de songe qui ressemblait à une griserie d’opium, nous est apparu vaguement un immense pays, enfermé par une muraille sans fin, plein de tours de porcelaine, de poteries éclatantes et d’hommes étranges aux yeux longs, au teint jaune, portant au sommet de la tête une tresse de cheveux tombant jusqu’à terre. Il nous a semblé entendre des bruits de clochettes, des cris drôles ; nous nous sommes figuré cette humanité extravagante mangeant des nids sautés au beurre, et des grains de riz au moyen de baguettes de bois, comme feraient les clowns de cirque pour amuser le public.
Nous avons entrevu des dragons d’or sur des soieries roses, toutes sortes de choses belles ou comiques, d’une fantaisie opulente et burlesque. Et nous avons cru avoir une idée de la Chine.
Or, nous ne savons rien d’elle. — Car il faut avoir vu une terre pour la connaître, une terre surtout si différente de la nôtre.
Nous avons lu les voyageurs. Ils ne nous ont rien enseigné de précis ; ils n’ont fait qu’égarer notre imagination en de confuses images.
Qu’est-ce que la Chine pourtant ?
Ouvrons les poètes et cherchons la Chine qu’ils ont inventée, eux, ces créateurs de régions idéales.
Читать дальше