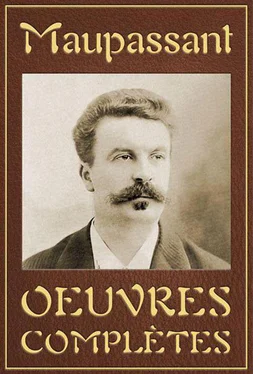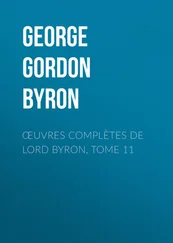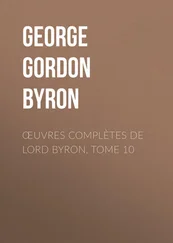Le président de la République a-t-il prévu une guerre possible avec le prince de Monaco ou la république d’Andorre ? Est-il résolu à céder Nice au premier et Bordeaux à la seconde, ou prétend-il lutter contre les armées de ces puissances ?
Et tout cela pour le Tonkin ?
Il est donc écrit que nos colonies nous seront toujours fatales.
Les gens compétents s’écrient : « Quoi d’étonnant ? Les Français ne sauront jamais coloniser. »
En y réfléchissant bien, j’arrive à croire tout simplement que nous ne savons pas choisir nos colonies. Nous prenons les rossignols, en nous étonnant qu’ils ne rapportent rien.
Si j’étais le gouvernement, comme disent tous ceux qui ont des idées sur la manière de sauver la France, je sais bien ce que je ferais. Je mettrais dans une valise toutes nos colonies, le Sénégal, le Gabon, la Tunisie, la Guyane, la Guadeloupe, la Cochinchine, le Congo, le Tonkin et le reste, et j’irais trouver M. de Bismarck. Je lui dirais : « Monsieur, vous cherchez des colonies, en voici un stock, un tas, un assortiment complet. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les nuances. Elles sont habitées par des Arabes, des Nègres, des Indiens, des Chinois, des Annamites, etc. Je vous demande, pour chacune, un kilomètre d’Alsace et un kilomètre de Lorraine. »
Et si le chancelier allemand acceptait, je ferais certes une bonne affaire.
On s’étonne que le budget ne tienne jamais debout et que l’argent de la caisse publique coule comme l’eau d’une fontaine, et on ne réfléchit pas que nous entretenons des troupes et des fonctionnaires dans tous les pays stériles et inhabitables dont la fantaisie ignorante d’un ministre nous a fait prendre possession.
En MATIÈRE de colonisation, il est une loi qu’on devrait, semble-t-il, ne jamais oublier.
Il est inutile de s’emparer d’une terre que l’Européen n’a point peuplée, s’il a pu y accéder depuis longtemps.
La graine humaine pousse comme celle des plantes quand le sol est bon pour elle. L’Amérique n’est-elle pas un exemple décisif ? L’Européen l’a envahie, couverte, d’un bout à l’autre. La puissance absorbante de la race blanche devient irrésistible dans les climats qui lui conviennent.
Mais toute tentative de colonisation reste vaine dans les régions où le Blanc ne trouve point les conditions d’air, de salubrité et d’existence qui lui sont indispensables.
Regardons l’Afrique.
L’Européen la connaît depuis le commencement des temps, et il n’a jamais pu s’y installer. Nous l’avons abordée par tous ses rivages, sans pouvoir y faire souche, y prendre racine comme nous avons fait en Amérique. Nous l’avons traversée sans parvenir même à l’explorer. Nous campons sur ses bords, nous n’entrons pas. A quoi nous servent le Sénégal et le Gabon ? Sont-ce là des terres opulentes comme celles d’où nous viennent les blés qui tuent la culture française ? Que ferons-nous au Congo, que ferons-nous à Tunis ? Rien. Nous y dépenserons beaucoup d’argent, pour l’honneur, pour un honneur bien problématique.
Tout ministre a la turlutaine de donner des colonies à la patrie, sans distinguer les colonies utiles des colonies mineures. On envoie un explorateur, un militaire avide d’avancement, un voyageur avide de spéculation. Il fait un rapport en termes pompeux. On s’empare aussitôt du Tonkin, du Congo ou de Madagascar et on l’annonce à grand bruit. Cela fait vingt ou trente millions de plus à inscrire chaque année aux dépenses du budget.
A qui la faute ? Aux ministres d’abord, et aux députés ensuite. Il n’est en ce moment, d’un bout à l’autre de la France, qu’un cri de colère et de mépris contre la servile majorité qui a suivi M. Ferry en toutes ses fantaisies funestes et qui fa lâché ensuite en se lavant les mains à la façon de Ponce Pilate.
Cette exécution brutale du chef du pouvoir par ses amis ne contribuera pas peu au mouvement de plus en plus accentué de l’opinion publique, à cette sorte d’envahissement jusqu’au peuple de scepticisme et de dédain pour ses représentants.
Entrez dans les petits restaurants de Paris, dans ceux où mangent les travailleurs ; les gens qui causent se moquent de leurs élus, parlent d’eux comme ils feraient de bonnes ganaches amusantes.
Les cochers de fiacre, devant le kiosque de la station, à, côté du sergent de ville qui pointe leurs numéros, plaisantent agréablement les délégués populaires.
Dans un salon, lorsqu’on voit entrer quelque monsieur ignoré et qu’on demande : « Qui est celui-là ? » si on vous répond : a C’est un député », une vague pitié vous envahit.
La Chambre donne tellement à rire et à s’indigner, offre tant de raisons de la blâmer, de la blaguer, de la bafouer, ses maladresses sont tellement visibles, ses emballements tellement grotesques que le métier de député devient une profession comique qui inspirera bientôt un doux mépris aux petits enfants eux-mêmes.
Et pourtant on rencontre parmi les représentants du pays beaucoup d’hommes distingués, instruits et intelligents, mais ils n’ont pas d’esprit d’ensemble, car il faut une grande pratique de la politique à une assemblée quelconque pour qu’elle devienne intelligente en masse.
Les qualités d’initiative intellectuelle, de libre arbitre, de réflexion sage et même de pénétration de tout homme supérieur isolé, disparaissent en général dès que cet homme est mêlé à un grand nombre d’autres hommes.
Voici un passage d’une lettre de lord Chesterfield à son fils (1751), qui constate avec une rare humilité cette subite élimination des qualités actives de l’esprit dans toute nombreuse réunion.
« Lord Macclesfield qui a eu la plus grande part dans la préparation du bill, et qui est l’un des plus grands mathématiciens et astronomes de l’Angleterre, parla ensuite, avec une connaissance approfondie de la question, et avec toute la clarté qu’une matière aussi embrouillée pouvait comporter. Mais comme ses mots, ses périodes et son élocution étaient loin de valoir les miens, la préférence me fut donnée à l’unanimité, bien injustement, je l’avoue.
« Ce sera toujours ainsi. Toute assemblée nombreuse est foule : quelles que soient les individualités qui la composent, il ne faut jamais tenir à une foule le langage de la raison pure. C’est seulement à ses passions, à ses sentiments et à ses intérêts apparents qu’il faut s’adresser.
« Une collectivité d’individus n’a plus de faculté de compréhension, etc. »
Cette profonde observation de lord Chesterfield, observation faite souvent d’ailleurs et notée avec intérêt par les philosophes de l’école scientifique, allemands et anglais, constitue un des arguments les plus sérieux contre les gouvernements représentatifs.
Le même phénomène, phénomène surprenant, se produit chaque fois qu’un grand nombre d’hommes est réuni. Toutes ces personnes, côte à côte, distinctes, différentes d’esprit, d’intelligence, de passions, d’éducation, de croyances, de préjugés, tout à coup, par le seul fait de leur réunion, forment un être spécial, doué d’une âme propre, d’une manière de penser nouvelle, commune, et qui ne,semble nullement formée de la moyenne des opinions individuelles. C’est une foule, et cette foule est quelqu’un, un vaste individu collectif, aussi distinct d’une autre foule qu’un homme est distinct d’un autre homme.
Un dicton populaire affirme que « la foule ne raisonne pas » . Or pourquoi la foule ne raisonne-t-elle pas, du moment que chaque particulier dans la foule raisonne ? Pourquoi une foule fera-t-elle spontanément ce qu’aucune des unités de cette foule n’aurait fait ? Pourquoi une foule a-t-elle des impulsions irrésistibles, des volontés féroces, des entraînements stupides que rien n’arrête, et emportée par ces entraînements irréfléchis accomplit-elle des actes qu’aucun des individus qui la composent n’accomplirait ?
Читать дальше