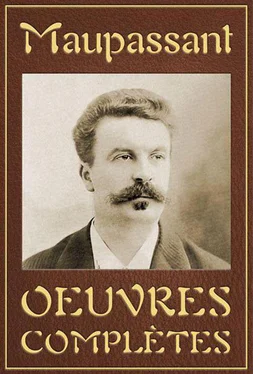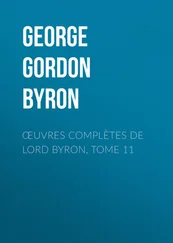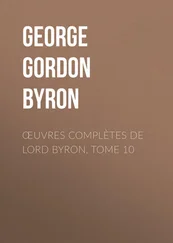Il aimait ce superbe et tranquille paysage que ses yeux avaient vu depuis son enfance. Presque jamais il ne descendait dans le jardin, ayant horreur du mouvement. Parfois pourtant, quand un ami venait le voir, il se promenait avec lui le long d’une grande allée de tilleuls, plantée en terrasse, et qui semblait faite pour les graves et douces causeries.
Il prétendait que Pascal était venu jadis dans cette maison et qu’il avait dû aussi marcher, rêver et parler sous ces arbres. Son cabinet ouvrait trois fenêtres sur le jardin et deux sur la rivière. Il était très vaste, n’ayant pour ornement que des livres, quelques portraits d’amis et quelques souvenirs de voyages : des corps de jeunes caïmans séchés, un pied de momie qu’un domestique naïf avait ciré comme une botte et demeuré noir, des chapelets d’ambre d’Orient, un bouddha doré, dominant la grande table de travail, et regardant de ses yeux longs, dans son immobilité divine et séculaire, un admirable buste de Pradier, représentant la sueur de Gustave, Caroline Flaubert, morte toute jeune femme, et, par terre, d’un côté un immense divan turc couvert de coussins, de l’autre une magnifique peau d’ours blanc.
Il se mettait à la besogne dès neuf ou dix heures du matin, se levait pour déjeuner, puis reprenait aussitôt son labeur. Il dormait souvent une heure ou deux dans l’après-midi ; mais il veillait jusqu’à trois ou quatre heures du matin, accomplissant alors le meilleur de sa besogne, dans le silence calme de la nuit, dans le recueillement du grand appartement tranquille, à peine éclairé par les deux lampes couvertes d’un abat-jour vert. Les mariniers, sur la rivière, se servaient comme d’un phare, des fenêtres de « Monsieur Gustave ». Il s’était fait dans le pays une sorte de légende autour de lui. On le regardait comme un brave homme, un peu toqué, dont les costumes singuliers effaraient les yeux et les esprits. Il était toujours vêtu, pour travailler, d’un large pantalon, noué par une cordelière de soie à la ceinture, et d’une immense robe de chambre tombant jusqu’à terre. Ce vêtement, qu’il avait adopté non par pose, mais à cause de son ampleur commode, était en drap brun l’hiver, et, l’été, en étoffe légère, à fond blanc et à dessins clairs. Les bourgeois de Rouen, allant déjeuner à la Bouille, le dimanche, rentraient déçus dans leur espoir quand ils n’avaient pu voir, du pont du bateau à vapeur, cet original de M. Flaubert, debout dans sa haute fenêtre.
Lui aussi prenait plaisir à regarder passer ce bateau chargé de monde. Il portait à ses yeux une jumelle de théâtre qui traînait toujours au bord de sa table ou sur le coin de sa cheminée et contemplait curieusement tous ces visages tournés vers lui. Leur laideur l’amusait, leur étonnement le dilatait ; il lisait sur les figures les caractères, le tempérament, la bêtise de chacun.
On a beaucoup parlé de sa haine contre le bourgeois.
Il faisait de ce mot bourgeois le synonyme de bêtise et le définissait ainsi : « J’appelle bourgeois quiconque pense bassement. » Ce n’est donc nullement à la classe bourgeoise qu’il en voulait, mais à une sorte particulière de bêtise qu’on rencontre le plus souvent dans cette classe. Il avait, du reste, pour le « bon peuple », un mépris aussi complet. Mais, se trouvant moins souvent en contact avec l’ouvrier qu’avec les gens du monde, il souffrait moins de la sottise populaire que de la sottise mondaine. L’ignorance, d’où viennent les croyances absolues, les principes dits immortels, toutes les conventions, tous les préjugés, tout l’arsenal des opinions communes ou élégantes, l’exaspéraient. Au lieu de sourire, comme beaucoup d’autres, de l’universelle niaiserie, de l’infériorité intellectuelle du plus grand nombre, il en souffrait horriblement. Sa sensibilité cérébrale excessive lui faisait sentir comme des blessures les banalités stupides que chacun répète chaque jour. Quand il sortait d’un salon où la médiocrité des propos avait duré tout un soir, il était affaissé, accablé, comme si on l’eût roué de coups, devenu lui-même idiot, affirmait-il, tant il possédait la faculté de pénétrer dans la pensée des autres.
Vibrant toujours, impressionnable aussi, il se comparait à un écorché que le moindre contact fait tressaillir de douleur, et la bêtise humaine, assurément, le blessa durant toute sa vie, comme blessent les grands malheurs intimes et secrets. Il la considérait un peu comme une ennemie personnelle acharnée à le martyriser ; et il la poursuivit avec fureur ainsi qu’un chasseur poursuit sa proie, l’atteignant jusqu’au fond des plus grands cerveaux. Il avait, pour la découvrir, des subtilités de limier, et son œil rapide tombait dessus, qu’elle se cachât dans les colonnes d’un journal ou même entre les lignes d’un beau livre. Il en arrivait parfois à un tel degré d’exaspération, qu’il aurait voulu détruire la race humaine.
La misanthropie de ses œuvres ne vient pas d’autre chose.
La saveur amère qui s’en dégage n’est que cette constante constatation de la médiocrité, de la banalité, de la sottise sous toutes ses formes. Il la note à toutes les pages, presque à tous les paragraphes, par un mot, par une simple intention, par l’accent d’une scène ou d’un dialogue. Il emplit le lecteur intelligent d’une mélancolie désolée devant la vie. Le malaise inexpliqué qu’ont éprouvé beaucoup de gens en ouvrant l’Éducation sentimentale n’était que la sensation irraisonnée de cette éternelle misère des pensées montrées à nu dans les crânes.
Il disait quelquefois qu’il aurait pu appeler ce livre « les Fruits secs », pour en faire mieux comprendre l’intention. Chaque homme, en le lisant, se demande avec inquiétude s’il n’est pas un des tristes personnages de ce morne roman, tant on retrouve en chacun des choses personnelles, intimes et navrantes.
Après l’énumération de ses lectures effrayantes, il écrivait un jour : « Et tout cela dans l’unique but de cracher sur mes contemporains le dégoût qu’ils m’inspirent ! Je vais, enfin, dire ma manière de penser, exhaler mon ressentiment, vomir ma haine, expectorer mon fiel, déterger mon indignation ! » Ce mépris d’idéaliste exalté pour la bêtise courante et la banalité commune était accompagné d’une admiration véhémente pour les gens supérieurs, quel que fût le genre de leur talent ou.la nature de leur érudition. N’ayant jamais aimé que la pensée, il en respectait toutes les manifestations ; et ses lectures s’étendaient aux livres qui semblent ordinairement le plus étrangers à l’art littéraire. Il se fâcha avec un journal ami où on avait maladroitement critiqué M. Renan ; le nom seul de Victor Hugo l’emplissait d’enthousiasme ; il avait pour amis des hommes comme MM. Georges Pouchet et Berthelot ; son salon de Paris était des plus curieux.
Il recevait le dimanche, depuis une heure jusqu’à sept, dans un appartement de garçon, très simple, au cinquième étage. Les murs étaient nus et le mobilier modeste, car il avait en horreur le bibelot d’art.
Dès qu’un coup de timbre annonçait le premier visiteur, il jetait sur sa table de travail, couverte de feuilles de papier éparpillées et noires d’écriture, un léger tapis de soie rouge qui enveloppait et cachait tous les outils de son travail, sacrés pour lui comme les objets du culte pour un prêtre. Puis, son domestique sortant presque toujours le dimanche, il allait ouvrir lui-même.
Le premier venu était souvent Ivan Tourgueneff, qu’il embrassait comme un frère. Plus grand encore que Flaubert, le romancier russe aimait le romancier français d’une Élection profonde et rare. Des affinités de talent, de philosophie et d’esprit, des similitudes de goûts, de vie et de rêves, une conformité de tendances littéraires, d’idéalisme exalté, d’admiration et d’érudition, mettaient entre eux tant de points de contact incessants qu’ils éprouvaient, l’un et l’autre, en se revoyant, une joie du cœur plus encore peut-être qu’une joie de l’intelligence.
Читать дальше