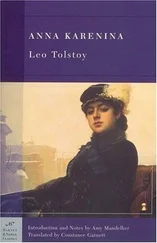«Mettez-la-moi», murmura celle-ci en souriant.
Levine se tourna de son côté, et, frappé du rayonnement de son visage, il se sentit, comme elle, heureux et rasséréné.
Ils écoutèrent, la joie au cœur, la lecture de l’épître et le roulement de la voix du diacre au dernier vers, fort apprécié du public étranger qui l’attendait avec impatience. Ils burent avec joie l’eau et le vin tièdes dans la coupe, et suivirent presque gaiement le prêtre lorsqu’il leur fit faire le tour du pupitre en tenant leurs mains dans les siennes. Cherbatzky et Tchirikof, soutenant les couronnes, suivaient les mariés et souriaient aussi, tout en trébuchant sur la traîne de la mariée. L’éclair de joie allumé par Kitty se communiquait, semblait-il, à toute l’assistance. Levine était convaincu que le diacre et le prêtre en subissaient la contagion comme lui.
Les couronnes ôtées, le prêtre lut les dernières prières et félicita le jeune couple. Levine regarda Kitty et crut ne l’avoir encore jamais vue aussi belle; c’était la beauté de ce rayonnement intérieur qui la transformait; il voulut parler, mais s’arrêta, craignant que la cérémonie ne fût pas encore terminée. Le prêtre lui dit doucement, avec un bon sourire:
«Embrassez votre femme, et vous, embrassez votre mari», et il leur reprit les cierges.
Levine embrassa sa femme avec précaution, lui prit le bras et sortit de l’église, ayant l’impression nouvelle et étrange de se sentir tout à coup rapproché d’elle. Il n’avait pas cru jusqu’ici à la réalité de tout ce qui venait de se passer, et ne commença à y ajouter foi que lorsque leurs regards étonnés et intimidés se rencontrèrent; il sentit alors que, bien réellement, ils ne faisaient plus qu’un.
Le même soir, après souper, les jeunes mariés partirent pour la campagne.
Wronsky et Anna voyageaient ensemble en Europe depuis trois mois; ils avaient visité Venise, Rome, Naples, et venaient d’arriver dans une petite ville italienne où ils comptaient séjourner quelque temps.
Un imposant maître d’hôtel, aux cheveux bien pommadés et séparés par une raie qui partait du cou, en habit noir, large plastron de batiste, et breloques se balançant sur un ventre rondelet, répondait dédaigneusement, les mains dans ses poches, aux questions que lui adressait un monsieur.
Des pas sur l’escalier de l’autre côté du perron firent retourner le brillant majordome, et lorsqu’il aperçut le comte russe, locataire du plus bel appartement de l’hôtel, il retira respectueusement ses mains de ses poches, et prévint le comte, en saluant, que le courrier était venu annoncer que l’intendant du palais, pour lequel on était en négociations, consentait à signer le bail.
«Très bien, dit Wronsky. Madame est-elle à la maison?
– Madame était sortie, mais elle vient de rentrer», répondit le maître d’hôtel.
Wronsky ôta son chapeau mou à larges bords, essuya de son mouchoir son front et ses cheveux rejetés en arrière qui dissimulaient sa calvitie, puis voulut passer, tout en jetant un regard distrait sur le monsieur arrêté à le contempler.
«Monsieur est russe et vous a demandé», dit le maître d’hôtel.
Wronsky se retourna encore une fois, ennuyé à l’idée de ne pouvoir éviter les rencontres, et content cependant de trouver une distraction quelconque: ses yeux et ceux de l’étranger s’illuminèrent:
«Golinitchef!
– Wronsky!»
C’était effectivement Golinitchef, un camarade de Wronsky au corps des pages: il y appartenait au parti libéral et en était sorti avec un grade civil sans aucune intention d’entrer au service. Depuis leur sortie du corps ils ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois.
Wronsky, lors de cette unique rencontre, avait cru comprendre que son ancien camarade méprisait, du haut de ses opinions extra-libérales, la carrière militaire; il l’avait, en conséquence, traité froidement et avec hauteur, ce qui avait laissé Golinitchef indifférent, mais ne leur avait pas donné le désir de se revoir. Et cependant ce fut avec un cri de joie qu’ils se reconnurent. Peut-être Wronsky ne se douta-t-il pas que la cause du plaisir qu’il avait à retrouver Golinitchef était le profond ennui qu’il éprouvait; mais, oubliant le passé, il lui tendit la main, et l’expression un peu inquiète de la physionomie de Golinitchef fit place à une satisfaction manifeste.
«Enchanté de te rencontrer! dit Wronsky avec un sourire amical qui découvrit ses belles dents.
– On m’a dit ton nom, je ne savais pas si c’était toi; très, très heureux…
– Mais entre donc. Que fais-tu ici?
– J’y suis depuis plus d’un an. Je travaille.
– Vraiment? dit Wronsky avec intérêt. Entrons donc.»
Et selon l’habitude propre aux Russes de parler français quand ils ne veulent pas être compris de leurs domestiques, il dit en français:
«Tu connais M meKarénine? nous voyageons ensemble, j’allais chez elle». Et tout en parlant il examinait la physionomie de Golinitchef.
– Ah! Je ne savais pas (il le savait parfaitement), répondit celui-ci avec indifférence.
– Y a-t-il longtemps que tu es ici?
– Depuis trois jours», répondit Wronsky, continuant à observer son camarade.
«C’est un homme bien élevé, qui voit les choses dans leur véritable jour; on peut le présenter à Anna», se dit-il, interprétant favorablement la façon dont Golinitchef venait de détourner la conversation.
Depuis qu’il voyageait avec Anna, Wronsky, à chaque rencontre nouvelle, avait éprouvé le même sentiment d’hésitation; généralement les hommes avaient compris la situation «comme elle devait être comprise». Il eût été embarrassé de dire ce qu’il entendait par là. Au fond, ces personnes ne cherchaient pas à comprendre, et se contentaient d’une tenue discrète, exempte d’allusions et de questions, comme font les gens bien élevés en présence d’une situation délicate et compliquée.
Golinitchef était certainement de ceux-là, et lorsque Wronsky l’eût présenté à Anna, il fut doublement content de l’avoir rencontré, son attitude étant correcte autant qu’on pouvait le désirer, et ne lui coûtant visiblement aucun effort.
Golinitchef ne connaissait pas Anna, dont la beauté et la simplicité le frappèrent. Elle rougit en voyant entrer les deux hommes, et cette rougeur enfantine plut infiniment au nouveau venu. Il fut charmé de la façon naturelle dont elle abordait sa situation, appelant Wronsky par son petit nom, et disant qu’ils allaient s’installer dans une maison qu’on décorait du nom de palazzo, de l’air d’une personne qui veut éviter tout malentendu devant un étranger.
Golinitchef, qui connaissait Alexis Alexandrovitch, ne put s’empêcher de donner raison à cette femme jeune, vivante et pleine d’énergie; il admit, ce qu’Anna ne comprenait guère elle-même, qu’elle pût être heureuse et gaie tout en ayant abandonné son mari et son fils, et perdu sa bonne renommée.
«Ce palazzo est dans le guide, dit Golinitchef. Vous y verrez un superbe Tintoret de sa dernière manière.
– Faisons une chose: le temps est superbe, retournons le voir, dit Wronsky, s’adressant à Anna.
– Très volontiers, je vais mettre mon chapeau. Vous dites qu’il fait chaud?» dit-elle sur le pas de la porte, se retournant vers Wronsky et rougissant encore.
Wronsky comprit qu’Anna, ne sachant pas au juste qui était Golinitchef, se demandait si elle avait eu avec lui le ton qu’il fallait.
Il la regarda, longuement, tendrement, et répondit:
«Non, trop chaud.»
Anna devina qu’il était satisfait d’elle, et lui répondant par un sourire, sortit de son pas vif et gracieux.
Читать дальше