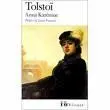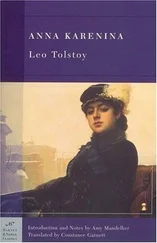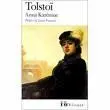
Léon Tolstoï
Anna Karénine Tome II
«Je me suis réservé à la vengeance.»
dit le Seigneur.
Les Karénine continuèrent à vivre sous le même toit, à se rencontrer chaque jour, et à rester complètement étrangers l’un à l’autre. Alexis Alexandrovitch se faisait un devoir d’éviter les commentaires des domestiques en se montrant avec sa femme, mais il dînait rarement chez lui. Wronsky ne paraissait jamais: Anna le rencontrait au dehors, et son mari le savait.
Tous les trois souffraient d’une situation qui eût été intolérable si chacun d’eux ne l’avait jugée transitoire. Alexis Alexandrovitch s’attendait à voir cette belle passion prendre fin, comme toute chose en ce monde, avant que son honneur fût ostensiblement entaché; Anna, la cause de tout le mal, et sur qui les conséquences en pesaient le plus cruellement, n’acceptait sa position que dans la conviction d’un dénouement prochain. Quant à Wronsky, il avait fini par croire comme elle.
Vers le milieu de l’hiver, Wronsky eut une semaine ennuyeuse à traverser. Il fut chargé de montrer Pétersbourg à un prince étranger, et cet honneur, que lui valurent son irréprochable tenue et sa connaissance des langues étrangères, lui parut fastidieux. Le prince voulait être à même de répondre aux questions qui lui seraient adressées au retour sur son voyage, et profiter cependant de tous les plaisirs spécialement russes. Il fallait donc l’instruire le matin et l’amuser le soir. Or ce prince jouissait d’une santé exceptionnelle, même pour un prince, et il était arrivé, grâce à des soins minutieusement hygiéniques de sa personne, à supporter des fatigues excessives, tout en restant frais comme un grand concombre hollandais, vert et luisant. Il avait beaucoup voyagé, et l’avantage incontestable qu’il reconnaissait aux facilités de communication modernes, était de pouvoir s’amuser de façons variées. En Espagne, il avait donné des sérénades, courtisé des Espagnoles, et joué de la mandoline; en Suisse, il avait chassé le chamois; en Angleterre, sauté des haies en habit rouge et parié de tuer 200 faisans; en Turquie, il avait pénétré dans un harem; aux Indes, il s’était promené sur des éléphants, et maintenant il tenait à connaître les plaisirs de la Russie.
Wronsky, en sa qualité de maître des cérémonies, organisa, non sans peine, le programme des divertissements; c’étaient les blinis [1], les courses de trotteurs, la chasse à l’ours, les parties de troïka, les Bohémiennes, les réunions intimes dans lesquelles on lançait au plafond des plateaux chargés de vaisselle. Le prince s’assimilait ces divers plaisirs avec une rare facilité, et s’étonnait, après avoir tenu une Bohémienne sur ses genoux, et brisé tout ce qui lui tombait sous la main, que l’entrain russe s’arrêtât là. Au fond, ce qui l’amusa le plus, ce furent les actrices françaises, les danseuses et le champagne.
Wronsky connaissait les princes, en général; mais, soit qu’il eût changé dans les derniers temps, soit que l’intimité de celui qu’on le chargeait de divertir fut particulièrement pénible, cette semaine lui sembla cruellement longue. Il éprouva l’impression d’un homme préposé à la garde d’un fou dangereux qui redouterait son malade, et craindrait pour sa propre raison; malgré la réserve officielle où il se retranchait, il rougit plus d’une fois de colère en écoutant les réflexions du prince sur les femmes russes qu’il daigna étudier. Ce qui irritait le plus violemment Wronsky dans ce personnage, c’était de trouver en lui comme un reflet de sa propre individualité, et ce miroir n’avait rien de flatteur. L’image qu’il y voyait était celle d’un homme bien portant, très soigné, fort sot et enchanté de sa personne, d’humeur égale avec ses supérieurs, simple et bon enfant avec ses égaux, froidement bienveillant envers ses inférieurs, mais gardant toujours l’aisance et les façons d’un «gentleman». Wronsky se comportait exactement de même, et s’en était fait un mérite jusque-là; mais comme il jouait auprès du prince un rôle inférieur, ces airs dédaigneux l’exaspérèrent. «Quel sot personnage! Est-il possible que je lui ressemble!» pensait-il. Aussi, au bout de la semaine, fut-il soulagé de quitter ce miroir incommode sur le quai de la gare, où le prince, en partant pour Moscou, lui adressa ses remerciements. Ils revenaient d’une chasse à l’ours, et la nuit s’était passée à donner une brillante représentation de l’audace russe.
Wronsky trouva en rentrant chez lui un billet d’Anna: «Je suis malade et malheureuse, écrivait-elle; je ne puis sortir et ne puis me passer plus longtemps de vous voir. Venez ce soir, Alexis Alexandrovitch sera au conseil de sept heures à dix.»
Cette invitation, faite malgré la défense formelle du mari, lui sembla étrange; mais il finit par décider qu’il irait chez Anna.
Depuis le commencement de l’hiver, Wronsky était colonel, et depuis qu’il avait quitté le régiment il vivait seul. Après son déjeuner il s’étendit sur un canapé, et le souvenir des scènes de la veille se lia d’une façon bizarre dans son esprit à celui d’Anna, et d’un paysan qu’il avait rencontré à la chasse; il finit par s’endormir, et, quand il se réveilla, la nuit était venue. Il alluma une bougie avec une impression de terreur qu’il ne put s’expliquer. «Que m’est-il arrivé? qu’ai-je vu de si terrible en rêve?» se demanda-t-il. «Oui, oui, le paysan, un petit homme sale, à barbe ébouriffée, faisait je ne sais quoi courbé en deux, et prononçait en français des mots étranges. Je n’ai rien rêvé d’autre, pourquoi cette épouvante?» Mais, en se rappelant le paysan et ses mots français incompréhensibles, il se sentit frissonner de la tête aux pieds. «Quelle folie!» pensa-t-il en regardant sa montre. Il était plus de huit heures et demie; il appela son domestique, s’habilla rapidement, sortit, et, oubliant complètement son rêve, ne s’inquiéta plus que de son retard.
En approchant de la maison Karénine il regarda encore sa montre, et vit qu’il était neuf heures moins dix. Un coupé attelé de deux chevaux gris était arrêté devant le perron; il reconnut la voiture d’Anna. «Elle vient chez moi», se dit-il, «cela vaut bien mieux. Je déteste cette maison, mais cependant je ne veux pas avoir l’air de me cacher»; et avec le sang-froid d’un homme habitué dès l’enfance à ne pas se gêner, il quitta son traîneau et monta le perron. La porte s’ouvrit, et le suisse, portant un plaid, fit avancer la voiture. Quelque peu observateur que fût Wronsky, la physionomie étonnée du suisse le frappa; il avança cependant et vint presque se heurter à Alexis Alexandrovitch. Un bec de gaz placé à l’entrée du vestibule éclaira en plein sa tête pâle et fatiguée. Il était en chapeau noir, et sa cravate blanche ressortait sous un col de fourrure. Les yeux mornes et ternes de Karénine se fixèrent sur Wronsky; celui-ci salua, et Alexis Alexandrovitch, serrant les livres, leva la main à son chapeau et passa. Wronsky le vit monter en voiture sans se retourner, prendre par la portière le plaid et la lorgnette que lui tendait le suisse, et disparaître.
«Quelle situation!» pensa Wronsky entrant dans l’antichambre les yeux brillants de colère; «si encore il voulait défendre son honneur, je pourrais agir, traduire mes sentiments d’une façon quelconque; mais cette faiblesse et cette lâcheté!… J’ai l’air de venir le tromper, ce que je ne veux pas.»
Читать дальше