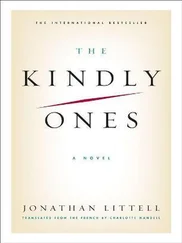Je me redressai et me dirigeai vers le coin où quelques-uns de mes vêtements traînaient en tas pour enfiler un pantalon, tirant les bretelles sur mes épaules nues. En passant devant le miroir de la chambre je me regardai: une grande marque rouge barrait ma gorge. Je descendis; à la cuisine, je croquai une pomme, bus un peu de vin à une bouteille ouverte. Il n'y avait plus de pain. Je sortis sur la terrasse: le temps restait frais, je me frottai les bras. Ma verge irritée me faisait mal, le pantalon en laine l'exaspérait. Je regardai mes doigts, mes avant-bras, je jouai à vider de la pointe de l'ongle les grosses veines bleues de mon poignet. Mes ongles étaient sales, celui du pouce gauche était cassé. De l'autre côté de la maison, dans la cour, des oiseaux croassaient. L'air était vif, mordant, la neige au sol avait un peu fondu puis avait durci en surface, les traces laissées par mes pas et mon corps sur la terrasse restaient bien visibles. J'allai jusqu'à la rambarde et me penchai. Un corps de femme était couché dans la neige du jardin, à demi nu dans sa robe de chambre entrebâillée, immobile, la tête penchée, les yeux ouverts vers le ciel. Le bout de sa langue reposait délicatement sur le coin de ses lèvres bleuies; entre ses jambes, une ombre de poils renaissait sur son sexe, ils devaient encore continuer à pousser, obstinément. Je ne pouvais pas respirer: ce corps dans la neige était le miroir de celui de la fille de Kharkov. Et je sus alors que le corps de cette fille, que sa nuque tordue, son menton proéminent, ses seins glacés et rongés étaient eux le reflet aveugle non pas, comme je l'avais alors cru, d'une image mais de deux, confondues et séparées, l'une debout sur la terrasse et l'autre en bas, couchée dans la neige. Vous devez penser: Ah, cette histoire est enfin finie. Mais non, elle continue encore.
Thomas me trouva assis sur une chaise, au bord de la terrasse, je regardais les bois, le ciel, je buvais de l'eau-de-vie au goulot, à petits coups. La balustrade surélevée me cachait le jardin, mais la pensée de ce que j'y avais vu me minait doucement l'esprit. Un ou deux jours devaient s'être écoulés, ne me demandez pas comment je les ai passés. Thomas avait contourné la maison par le flanc: je n'avais rien entendu, ni bruit de moteur, ni appel. Je lui tendis la bouteille: «Salut et fraternité. Bois». J'étais sans doute un peu ivre. Thomas regarda autour de lui, but un peu, mais ne me rendit pas la bouteille. «Qu'est-ce que tu fous?» demanda-t-il enfin. Je lui souris niaisement. Il contempla la façade de la maison. «Tu es seul?» – «Je pense, oui». Il s'approcha de moi, me regarda, répéta: «Qu'est-ce que tu fous? Ton congé a expiré voilà une semaine. Grothmann est furieux, il parle de te faire passer en conseil de guerre pour désertion. Ces jours-ci, les conseils de guerre durent cinq minutes». Je haussai les épaules et fis un geste vers la bouteille qu'il tenait toujours à la main. Il l'éloigna. «Et toi? demandai-je. Qu'est-ce que tu fais ici?» – «Piontek m'a dit où tu étais. C'est lui qui m'a amené. Je suis venu te chercher». – «Il faut partir, alors?» fis-je tristement. – «Oui. Va t'habiller». Je me levai, montai à l'étage. Dans la chambre d'Una, au lieu de me vêtir, je m'assis sur son divan en cuir et allumai une cigarette. Je pensais à elle, avec difficulté, des pensées étrangement vides et creuses. La voix de Thomas, dans l'escalier, me tira de ma rêverie: «Dépêche-toi! Merde!» Je m'habillai, enfilant mes vêtements un peu au hasard, mais avec un certain bon sens, car il faisait froid, des sous-vêtements longs, des chaussettes en laine, un pull-over à col roulé sous mon uniforme de bureau. L'éducation sentimentale traînait sur le secrétaire: je glissai le volume dans la poche de ma tunique. Puis je commençai à ouvrir les fenêtres pour tirer les volets. Thomas apparut dans l'encadrement de la porte: «Mais qu'est-ce que tu fais?» – «Eh bien, je ferme. On ne va quand même pas laisser la maison grande ouverte». Sa mauvaise humeur éclata alors: «Tu ne sembles pas te rendre compte de ce qui se passe. Les Russes attaquent tout le long du front depuis une semaine. Ils peuvent arriver d'une minute à l'autre». Il me prit sans ménagement par le bras: «Allez, viens». Dans le grand hall, je me dégageai vivement de sa poigne et allai chercher la grosse clef de la porte d'entrée. J'enfilai mon manteau et mis ma casquette. En sortant je verrouillai soigneusement la porte. Dans la cour devant la maison, Piontek frottait le phare d'une Opel. Il se redressa pour me saluer et nous montâmes dans le véhicule, Thomas à côté de Piontek, moi à l'arrière. Dans la longue allée, entre les cahots, Thomas demandait à Piontek: «Tu crois qu'on peut repasser par Tempelburg?» – «Je ne sais pas, Herr Standartenführer. Ça avait l'air tranquille, on peut essayer». Sur la route principale Piontek vira à gauche. Dans Alt Draheim, quelques familles chargeaient encore des chariots attelés à de petits chevaux poméraniens. La voiture contourna le vieux fort et commença à monter la longue côte de l'isthme. Un char apparut au sommet, bas et trapu. «Merde! s'exclama Thomas. Un T-34!» Mais Piontek avait déjà pilé et engagé une marche arrière. Le char abaissa son canon et tira vers nous, mais il ne pouvait pointer aussi bas et l'obus nous passa au-dessus et explosa à côté de la route, à l'entrée du village. Le char s'avança dans un ferraillement de chenilles pour tirer plus bas; Piontek reculait rapidement la voiture en travers de la route et repartait à toute allure en direction du village; le second coup frappa assez près, faisant éclater une vitre, à gauche, puis nous avions contourné le fort et étions à l'abri. Au village les gens avaient entendu les détonations et couraient dans tous les sens. Nous traversâmes sans nous arrêter et reprîmes vers le nord. «Ils n'ont quand même pas pu prendre Tempelburg! rageait Thomas. On est passés il y a deux heures!» – «Ils ont peut-être contourné par les champs», suggéra Piontek. Thomas examinait une carte: «Bon, va jusqu'à Bad Polzin. On se renseignera là. Même si Stargard est tombé on peut faire Schivelbein-Naugard puis rejoindre Stettin». Je ne prêtais pas trop attention à ses propos, je regardais le paysage par la vitre fracassée dont j'avais déblayé les derniers débris. De hauts peupliers espacés bordaient la longue route droite et au-delà s'étendaient des champs enneigés et silencieux, le ciel gris où voletaient quelques oiseaux, des fermes isolées, closes, muettes. À Klaushagen, un petit village propre, triste et digne, quelques kilomètres plus bas, un barrage de Volkssturm en costumes civils avec des brassards fermait la route, entre un petit lac et un bois. Anxieusement, ces paysans nous demandèrent des nouvelles: Thomas leur conseilla de partir avec leurs familles vers Polzin, mais ils hésitaient, tortillaient leurs moustaches et tripotaient leurs vieilles pétoires et les deux Panzerfäuste qu'on leur avait attribués. Certains avaient accroché à leurs vestes leurs médailles de la Grande Guerre. Les Schupo en uniforme vert bouteille qui les encadraient ne semblaient pas plus à l'aise qu'eux, les hommes palabraient avec ce parler lent des conseils municipaux, presque solennels d'angoisse.
À l'entrée de Bad Polzin, les défenses paraissaient plus solidement organisées. Des Waffen-SS gardaient la route et une pièce de PAK, positionnée sur une hauteur, couvrait l'approche. Thomas sortit de la voiture pour conférer avec l'Untersturmführer qui commandait la section, mais celui-ci ne savait rien et nous renvoya à son supérieur, en ville, au PC installé dans le vieux château. Les véhicules et les chariots encombraient les rues, l'atmosphère était tendue, des mères criaient après leurs enfants, des hommes tiraient brutalement les longes des chevaux, houspillaient les travailleurs agricoles français qui chargeaient les matelas et les sacs de provisions. Je suivis Thomas dans le PC et restai derrière lui à écouter. L'Obersturmführer ne savait pas grand-chose, non plus; son unité était rattachée au Xe corps SS, on l'avait envoyé ici à la tête d'une compagnie pour tenir les axes; et il pensait que les Russes viendraient du sud ou de l'est – la 2e armée, autour de Danzig et Gotenhafen, était déjà coupée du Reich, les Russes avaient percé jusqu'à la Baltique sur l'axe Neustettin-Köslin, cela il en était à peu près sûr – mais il supposait les voies vers l'ouest encore libres. Nous prîmes la route de Schivelbein. C'était une chaussée en dur, les longs chariots de réfugiés en occupaient tout un côté, un déversement continu, le même triste spectacle qu'un mois auparavant sur l'autostrade de Stettin à Berlin. Lentement, au pas des chevaux, l'Est allemand se vidait. Il y avait peu de trafic militaire, mais beaucoup de soldats, armés ou non, marchaient seuls parmi les civils, des Rückkämpfer qui cherchaient à rejoindre leurs unités ou à en retrouver une autre. Il faisait froid, un vent fort soufflait par la vitre brisée de la voiture, charriait une neige mouillée. Piontek doublait les chariots en klaxonnant, des hommes à pied, des chevaux, du bétail congestionnaient la route, s'écartaient avec lenteur. Nous longions des champs, puis de nouveau la route passait par une forêt de sapins. Devant nous les chariots s'arrêtaient, il y avait de l'agitation, j'entendis un bruit énorme, incompréhensible, les gens criaient et couraient vers la forêt. «Les Russes!» braillait Piontek. -»Dehors, dehors!» ordonna Thomas. Je sortis sur la gauche avec Piontek: à deux cents mètres devant nous, un char avançait rapidement dans notre direction, écrasant sur son passage chariots, chevaux, fuyards retardataires. Épouvanté, je courus à toutes jambes avec Piontek et des civils me cacher dans la forêt; Thomas avait traversé la colonne pour filer de l'autre côté. Les charrettes, sous les chenilles du char, éclataient comme des allumettes; les chevaux mouraient dans des hennissements terribles coupés net par le grondement métallique. Notre voiture fut harponnée de front, repoussée, balayée, et, dans un vacarme de tôle broyée, projetée en bas du fossé, sur le flanc. Je distinguais le soldat perché sur le char, juste devant moi, un Asiatique au visage camus noir d'huile de moteur; sous son casque de tankiste en cuir, il portait de petites lunettes hexagonales de femme aux verres teintés en rose, et tenait dans une main une grosse mitrailleuse à chargeur rond, de l'autre, perchée sur son épaule, une ombrelle d'été, bordée de guipure; jambes écartées, appuyé contre la tourelle, il chevauchait le canon comme une monture, absorbant les impacts du char avec l'aisance d'un cavalier scythe dirigeant des talons un petit cheval nerveux. Deux autres chars avec des matelas ou des sommiers fixés à leurs flancs suivaient le premier, achevant sous leurs chenilles les mutilés qui gigotaient parmi les débris. Leur passage dura une dizaine de secondes, tout au plus, ils continuaient vers Bad Polzin, avec dans leur sillage une large bande d'éclats de bois mêlés de sang et de bouillie de chair dans des flaques d'entrailles de chevaux. De longues traînées laissées par les blessés qui avaient tenté de ramper à l'abri rougissaient la neige des deux côtés de la route; çà et là, un homme se tordait, sans jambes, en beuglant, sur la route c'étaient des torses sans tête, des bras dépassant d'une pâtée rouge et immonde. Je tremblais de tous mes membres, Piontek dut m'aider à regagner la route. Autour de moi les gens hurlaient, gesticulaient, d'autres restaient immobiles et en état de choc, et les enfants poussaient des cris stridents, sans fin. Thomas me rejoignit tout de suite et fouilla dans les débris de la voiture pour en retirer la carte et un petit sac. «Il va falloir continuer à pied», dit-il. J'esquissai un geste hébété: «Et les gens…?» – «Il faudra qu'ils se débrouillent, coupa-t-il. On ne peut rien faire. Viens». Il me fit retraverser la route, suivi de Piontek. Je veillais à ne pas mettre les pieds dans des restes humains, mais il était impossible d'éviter le sang, mes bottes laissèrent de grandes traces rouges dans la neige. Sous les arbres, Thomas déplia la carte, «Piontek, ordonna-t-il, va fouiller les chariots, trouve-nous de quoi manger». Puis il étudia la carte. Lorsque Piontek revint avec quelques provisions serrées dans une taie d'oreiller, Thomas nous la montra. C'était une carte à grande échelle de la Poméranie, elle indiquait les routes et les villages, mais guère plus. «Si les Russes sont venus de là, c'est qu'ils ont pris Schivelbein. Ils doivent aussi être en train de monter vers Kolberg. On va aller au nord, essayer de rejoindre Belgarde. Si les nôtres y sont encore, c'est bon, sinon on avisera. En évitant les routes on devrait être tranquilles: s'ils sont allés si vite, c'est que l'infanterie est encore loin derrière». Il m'indiqua un village sur la carte, Gross Rambin: «Là, c'est la voie ferrée. Si les Russes n'y sont pas encore, on y trouvera peut-être quelque chose».
Читать дальше