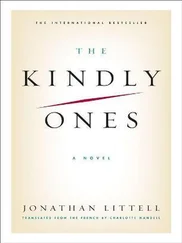Un éclat de lumière du soleil couchant passait sous les nuages et venait frapper le mur de la chambre, le secrétaire, le flanc de l'armoire, le pied du lit. Je me levai et allai pisser, puis descendis à la cuisine. Tout était silencieux. Je coupai des morceaux d'un bon pain de campagne gris, les beurrai, y posai de grosses tranches de jambon. Je trouvai aussi des cornichons, une terrine de pâté, des œufs durs et disposai le tout sur un plateau avec des couverts, deux verres, et une bouteille de bon vin de Bourgogne, un vosne-romanée, je crois me souvenir. Je retournai dans la chambre et posai le plateau sur le lit. Je m'assis en tailleur et contemplai l'espace vide des draps devant moi, de l'autre côté du plateau. Lentement ma sœur y prenait corps, avec une solidité surprenante. Elle dormait sur le flanc, repliée sur elle-même; la pesanteur tirait ses seins et même un peu son ventre de côté, vers le bas, sa peau était tendue sur sa hanche dressée, angulaire. Ce n'était pas son corps qui dormait mais elle qui, apaisée, dormait blottie dans son corps. Un peu de sang rouge vif filtrait entre ses jambes, sans tacher le lit, et toute cette lourde humanité était comme un pieu fiché dans mes yeux, mais qui ne m'aveuglait pas, qui au contraire ouvrait mon troisième œil, cet œil pinéal greffé dans ma tête par un sniper russe. Je débouchai la bouteille, humai profondément l'odeur capiteuse, puis versai deux verres. Je bus et me mis à manger. J'avais une faim immense, je dévorai tout ce qu'il y avait là et vidai la bouteille de vin. Dehors, le jour achevait de tomber, la chambre s'obscurcissait. Je débarrassai le plateau, allumai des bougies, et apportai des cigarettes que je fumai allongé sur le dos, le cendrier posé sur mon ventre. Au-dessus de moi, j'entendais un bourdonnement frénétique. Je cherchai des yeux, sans bouger, et vis une mouche au plafond. Une araignée la quittait et filait dans une fente de la moulure. La mouche était piégée dans la toile de l'araignée, elle se débattait avec ce bourdonnement pour se dégager, en vain. À ce moment-là un souffle passa sur ma verge, un doigt fantôme, la pointe d'une langue; tout de suite, elle commença à gonfler, à se déplier. J'écartai le cendrier et imaginai son corps se glissant sur moi, se cabrant pour m'enfoncer en elle tandis que ses seins me pesaient dans les mains, ses lourds cheveux noirs formant un rideau autour de ma tête, encadrant un visage illuminé par un sourire immense, radieux, qui me disait: «Tu as été mis dans ce monde pour une seule chose, pour me baiser». La mouche continuait à bourdonner, mais à intervalles de plus en plus espacés, cela venait d'un coup puis s'arrêtait. Je sentais entre mes mains comme la base de sa colonne, juste au-dessus des reins, sa bouche, au-dessus de moi, murmurait: «Ah, Dieu, ah, Dieu». Après, je regardai encore la mouche. Elle restait muette et immobile, le poison l'avait enfin terrassée. J'attendais que l'araignée ressorte. Puis je dus m'endormir. Une furieuse poussée de bourdonnements me réveilla, j'ouvris les yeux et regardai. L'araignée se tenait près de la mouche qui se débattait. L'araignée hésitait, elle avançait et reculait, enfin elle retourna à sa fente. La mouche de nouveau cessa de s'agiter. J'essayai d'imaginer sa terreur silencieuse, sa peur fracturée dans ses yeux à facettes. De temps en temps, l'araignée ressortait, testait sa proie d'une patte, ajoutait quelques tours au cocon, s'en retournait; et moi, j'observais cette agonie interminable, jusqu'au moment où l'araignée, des heures plus tard, traîna enfin la mouche morte ou terrassée dans la moulure pour la consommer, paisiblement.
Le jour venu, toujours nu, je chaussai des souliers pour ne pas me salir les pieds et allai explorer cette grande maison froide et obscure. Elle se déployait autour de mon corps électrisé, à la peau blanche et hérissée par le froid, aussi sensible sur toute sa surface que ma verge raidie ou mon anus qui picotait. C'était une invitation aux pires débordements, aux jeux les plus insanes et les plus transgressifs, et puisque le corps tendre et chaud que je désirais se refusait à moi, alors je me servais de sa maison comme je me serais servi de lui, je faisais l'amour à sa maison. J'entrais partout, je me couchais dans les lits, m'étendais sur les tables ou les tapis, je me frottais le derrière contre le coin des meubles, me branlais dans les fauteuils ou dans les armoires closes, au milieu de vêtements sentant la poussière et la naphtaline. J'entrai même ainsi chez von Üxküll, avec un sentiment de triomphe enfantin d'abord, puis d'humiliation. Et l'humiliation d'une manière ou d'une autre ne me lâchait pas, le sentiment de la folle vanité de mes gestes, mais cette humiliation et cette vanité aussi se mettaient à mon service, et j'en profitais avec une joie mauvaise, sans bornes. Ces pensées disloquées, cet épuisement frénétique des possibilités avaient pris la place du temps. Les levers, les couchers de soleil ne faisaient que marquer le rythme, comme la faim ou la soif ou les besoins naturels, comme le sommeil qui surgissait à n'importe quel moment pour m'engloutir, réparer mes forces, et me rendre à la misère de mon corps. Parfois je m'habillais un peu et sortais marcher. Il faisait presque chaud, les champs abandonnés au-delà de la Drage étaient devenus lourds, gras, leur terre meuble me collait aux pieds et me forçait à les contourner. Durant ces marches je ne voyais personne. Dans la forêt, un souffle de vent suffisait à me bouleverser, je baissais mon pantalon et retroussais ma chemise et me couchais à même la terre dure et froide et couverte d'aiguilles de pin qui me piquaient le derrière. Dans les bois touffus après le pont sur la Drage, je me mis entièrement nu, sauf les chaussures, que je conservai, et commençai à courir, comme quand j'étais gamin, à travers les branchages qui me griffaient la peau. Enfin je m'arrêtai contre un arbre et me retournai, les deux mains derrière moi enserrant le tronc, pour frotter lentement mon anus contre l'écorce. Mais cela ne me satisfaisait pas. Un jour, je trouvai un arbre couché de travers, renversé par une tempête, avec une branche cassée sur le haut du tronc, et avec un canif je raccourcis encore cette branche, en ôtai l'écorce et en polis le bois, arrondissant soigneusement le bout. Puis, la trempant copieusement de salive, je me plaçai à califourchon sur le tronc et, m'appuyant sur mes mains, enfonçai lentement cette branche en moi, jusqu'au bout. Cela me donnait un plaisir immense, et tout ce temps, les yeux clos, ma verge oubliée, j'imaginais ma sœur faisant la même chose, faisant devant moi comme une dryade lubrique l'amour avec les arbres de sa forêt, se servant de son vagin comme de son anus pour prendre un plaisir infiniment plus affolant que le mien. Je jouis avec de grands spasmes désordonnés, m'arrachant à la branche tachée, retombant de côté et en arrière sur une branche morte qui m'entailla profondément le dos, une douleur crue et adorable sur laquelle je restai plusieurs instants appuyé par le poids de mon corps presque évanoui Enfin je roulai de côté, le sang coulant librement de ma plaie, des feuilles mortes et des aiguilles collées à mes doigts, je me relevai, les jambes tremblant de plaisir, je me mis à courir entre les arbres. Plus loin les bois devenaient humides, une boue fine humectait la terre, des plaques de mousse revêtaient les endroits plus secs, je glissai dans la boue et m'abattit sur le flâne, pantelant. Le chant creux d'un coucou résonnait à travers le sous-bois. Je me relevai et descendis jusqu'à la Drage, j'ôtai mes chaussures et me plongeai dans l'eau glacée qui me bloqua les poumons pour rincer la boue et le sang qui coulait toujours, mêlé lorsque je ressortis à l'eau froide qui ruisselait sur mon dos. Une fois sec je me sentis vivifié, l'air sur ma peau était chaud et doux. J'aurais voulu couper des branches, construire une hutte que j'aurais tapissée de mousse, et y passer la nuit, nu; mais il faisait quand même trop froid, et puis il n'y avait pas d'Yseut pour la partager avec moi, pas de Marc non plus pour nous chasser du château. Alors je cherchai à me perdre dans les bois, d'abord avec une joie enfantine, puis presque avec désespoir, car c'était impossible, je tombais toujours sur un chemin ou bien un champ, toutes les voies me menaient à des repères connus, quelle que soit la direction que je choisissais.
Читать дальше