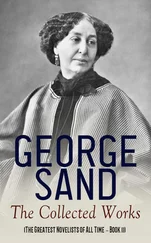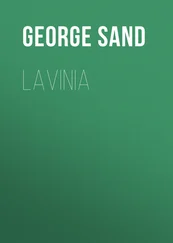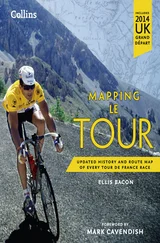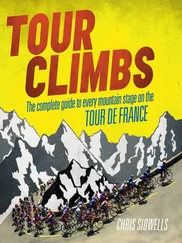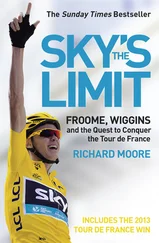– Voilà ce que j’attendais! dit le comte avec son calme imperturbable.
M. Lerebours courut ramasser son fils, la bonne Joséphine devint pâle, la voiture allait toujours.
– S’est-il tué? demanda le comte à son petit-fils qui, du haut du siège, en se retournant, voyait la piteuse figure d’Isidore.
– Il ne s’en porte que mieux! répondit le jeune homme en riant.
Le valet de chambre et le postillon en firent autant, surtout quand ils virent Beauceron, débarrassé de son fardeau et bondissant comme un cabri, passer auprès d’eux et gagner le large au grand galop.
– Arrêtez! dit le comte; cet imbécile est peut-être éclopé de l’aventure.
– Ce n’est rien, ce n’est rien! s’empressa de crier M. Lerebours en voyant la voiture arrêtée; il ne faut pas que M. le comte se retarde.
– Mais si fait! dit le comte, il doit être moulu , et d’ailleurs le voilà à pied; car, au train dont va le cheval, il aura gagné l’écurie avant son maître. Allons, mon fils va rentrer dans la voiture, et le vôtre montera sur le siège.
Isidore tout rouge, tout sali, tout ému, mais s’efforçant de rire et de prendre l’air dégagé, s’excusa; le comte insista avec ce mélange de brusquerie et de bonté qui était le fond de son caractère.
– Allons, allons, montez! dit-il d’un ton absolu, vous nous faites perdre du temps.
Il fallut obéir. Raoul de Villepreux entra dans la berline, et Isidore monta sur le siège d’où il eut le loisir de voir courir son cheval dans le lointain. Tout en répondant, comme il pouvait, aux condoléances malignes du valet de chambre, il jetait à la dérobée un regard inquiet dans la voiture. Il s’aperçut alors que mademoiselle de Villepreux se cachait le visage dans son mouchoir. Avait-elle été épouvantée de sa chute au point d’avoir des attaques de nerfs? On l’eût dit à l’agitation de toute sa personne, jusqu’alors si roide et si calme. Le fait est qu’elle avait été prise d’un fou-rire en le voyant reparaître, et, comme il arrive aux personnes habituellement sérieuses, sa gaieté était convulsive, inextinguible. Le jeune Raoul, qui, malgré sa nonchalance et le peu de ressort de son esprit, était persifleur de sang-froid comme toute sa famille, entretenait l’hilarité de sa sœur par une suite de remarques plaisantes sur la manière ridicule dont Isidore avait fait le plongeon. Le parler lent et monotone de Raoul rendait ces réflexions plus comiques encore. La sensible marquise n’y put tenir, malgré l’effroi qu’elle avait eu d’abord, et le rire s’empara d’elle comme de sa cousine. Le comte, voyant ces trois enfants en joie, renchérit sur les plaisanteries de son petit-fils avec un flegme diabolique. Isidore n’entendait rien, mais il voyait rire Yseult qui, renversée au fond de la voiture, n’avait plus la force de s’en cacher. Il en fut si amèrement blessé, que dès cet instant il jura de l’en punir, et une haine implacable contre cette jeune personne s’alluma dans son âme vindicative et basse.
Cependant Pierre Huguenin marchait toujours vers Blois par la traverse, tantôt sur la lisière des bois inclinés au flanc des collines, tantôt dans les sillons bordés de hauts épis. Quelquefois il s’asseyait au bord d’un ruisseau, pour laver et rafraîchir ses pieds brûlants, ou à l’ombre d’un grand chêne, au coin d’une prairie, pour prendre son repas modeste et solitaire. Il était excellent piéton et ne redoutait ni la chaleur ni la fatigue; et pourtant il abrégeait avec peine ces haltes délicieuses au sein d’une solitude agreste et poétique.
Il ne fallait pas plus de deux journées de marche au jeune menuisier pour se rendre à Blois. Il passa la nuit à Celles, dans une auberge de rouliers, et le lendemain, dès la pointe du jour, il se remit en route. La clarté du matin était encore incertaine et pâle, lorsqu’il vit venir à lui un homme de haute taille, ayant comme lui une blouse et un sac de voyage; mais à sa longue canne, il reconnut qu’il n’était pas de la même société que lui, qui n’en portait qu’une courte et légère. Il se confirma dans cette pensée, en voyant cet homme s’arrêter à une vingtaine de pas devant lui, et se mettre dans l’attitude menaçante du topage . – Tope, coterie ! quelle vocation ? s’écria l’étranger d’une voix de stentor. À cette interpellation, Pierre, à qui les lois de sa Société défendaient le topage , s’abstint de répondre, et continua de marcher droit à son adversaire; car, sans nul doute, la rencontre allait être fâcheuse pour l’un des deux. Telles sont les terribles coutumes du compagnonnage.
L’étranger, voyant que Pierre n’acceptait pas son défi, en conclut également qu’il avait affaire à un ennemi; mais comme il devait se mettre en règle, il n’en continua pas moins son interrogatoire suivant le programme. Compagnon ? cria-t-il en brandissant sa canne. Comme il ne reçut pas de réponse, il continua: Quel côté? quel devoir? Et voyant que Pierre gardait toujours le silence, il se remit en marche, et, en moins d’une minute, ils se trouvèrent en présence.
À voir la force athlétique et l’air impérieux de l’étranger, Pierre comprit qu’il n’y aurait pas eu de salut pour lui-même si la nature ne l’eût doué, aussi bien que son adversaire, d’une taille avantageuse et de membres vigoureux. – Vous n’êtes donc pas ouvrier? lui dit l’étranger d’un ton méprisant dès qu’ils se virent face à face.
– Pardonnez-moi, répondit Pierre.
– En ce cas, vous n’êtes pas compagnon? reprit l’étranger d’un ton plus arrogant encore; pourquoi vous permettez-vous de porter la canne?
– Je suis compagnon, répondit Pierre avec beaucoup de sang-froid, et vous prie de ne pas l’oublier maintenant que vous le savez.
– Qu’entendez-vous par là? avez-vous dessein de m’insulter?
– Nullement, mais j’ai la ferme résolution de vous répondre si vous me provoquez.
– Si vous avez du cœur, pourquoi vous soustrayez-vous au topage?
– J’ai apparemment des raisons pour cela.
– Mais savez-vous que ce n’est pas la manière de répondre? Entre compagnons on se doit la déclaration mutuelle de la profession et de la société. Voyons, ne sauriez-vous me dire à qui j’ai affaire, et faut-il que je vous y contraigne?
– Vous ne sauriez m’y contraindre, et il suffit que vous en montriez l’intention pour que je refuse de vous satisfaire.
L’étranger murmura entre ses dents: – Nous allons voir! et il serra convulsivement sa canne entre ses mains. Mais au moment d’entamer le combat, il s’arrêta, et son front s’obscurcit comme traversé d’un souvenir sinistre. – Écoutez, lui dit-il, il n’est pas besoin de tant dissimuler, je vois que vous êtes un gavot .
– Si vous m’appelez gavot, répondit Pierre, je suis en droit de vous dire que je vous connais pour un dévorant, et telles sont mes idées, que je ne reçois pas plus votre épithète comme une injure que je ne prétends vous injurier en vous donnant l’épithète qui vous convient.
– Vous voulez politiquer, repartit l’étranger, et je vois à votre prudence que vous êtes un vrai fils de Salomon. Eh bien! moi, je me fais gloire d’être du Saint Devoir de Dieu, et par conséquent je suis votre supérieur et votre ancien; vous me devez le respect, et vous allez faire acte de soumission. À cette condition les choses se passeront tranquillement entre nous.
– Je ne vous ferai aucune soumission, répondit Pierre, fussiez-vous maître Jacques en personne.
– Tu blasphèmes! s’écria l’étranger; en ce cas tu n’appartiens à aucune société constituée. Tu n’as pas de Devoir , ou bien tu es un révolté, un indépendant, un Renard de liberté , ce qu’il y a de plus méprisable au monde.
Читать дальше