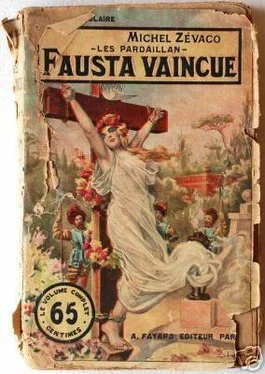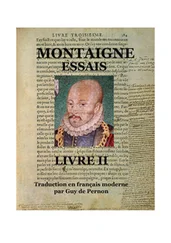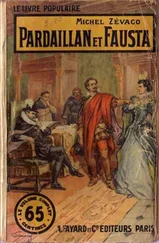Le roi sortit, le contempla un instant, et murmura:
– Comme il est grand!… Mort, il paraît plus grand que lorsqu’il vivait…
Puis, Henri III eut un sourire qui tordit ses lèvres pâles. Brusquement, il posa son pied sur la tête du cadavre et dit:
– Maintenant, je suis seul roi de France!…
Il y avait seize ans, dit un historien avec une sorte de sombre et vengeresse mélancolie, il y avait seize ans, le duc de Guise avait, lui aussi, posé son pied sur la tête sanglante d’un cadavre…
Cependant, des cris, des hurlements éclataient partout dans le château. Le bruit de la mort du duc se répandait en quelques instants. Les guisards, frappés de terreur, affolés par ce coup imprévu, attaqués par les gens du roi, fuyaient de toutes parts. Des troupes s’élançaient pour saisir le duc de Mayenne, le cardinal de Guise, le vieux cardinal de Bourbon et les principaux de la Ligue. Le tocsin se mit à sonner. En quelques minutes, la ville fut pleine de tumulte, de coups d’arquebuse, de plaintes et d’imprécations. On vit passer des bandes affolées de ligueurs qui fuyaient vers les portes…
Et Catherine de Médicis râlait dans son lit, agonisante, comme si elle n’eût attendu que ce dernier coup de son effroyable génie pour mourir…
Pardaillan, avons-nous dit, avait remonté l’escalier. Sans se soucier du tumulte qui se déchaînait dans le château, il montait sans hâte, et bientôt il parvint à la chambre que grâce à la recommandation du brave Crillon, Ruggieri lui avait donnée dans son propre appartement. Tout droit, sans s’arrêter, il alla à la porte qui faisait communiquer cette chambre avec la pièce voisine.
Cette porte était condamnée lorsque Pardaillan avait pris possession de la chambre. Mais sans doute était-il parvenu à l’ouvrir, car il n’eut qu’à la pousser du pied, et il passa dans la pièce voisine. Là, sur le lit, un homme était étendu, bâillonné, garrotté, dans l’impossibilité de faire un mouvement. C’était Maurevert.
Pardaillan délia les jambes d’abord, puis les bras de Maurevert. Puis il lui retira son bâillon. Pâle comme la mort, Maurevert ne bougeait pas.
– Levez-vous, dit Pardaillan.
Maurevert obéit. Il tremblait de tous ses membres. Pardaillan était étrangement calme. Mais sa voix frémissait, et un frisson, par moments, passait sur son visage. Il tira son poignard et le montra à Maurevert.
– Grâce! dit celui-ci d’une voix si faible qu’à peine on l’entendait.
– Donnez-moi le bras, dit Pardaillan.
Et comme Maurevert, dans le vertige de l’épouvante, ne bougeait pas, il lui prit le bras et le mit sous son bras gauche. De la main droite, il tenait son poignard sous son manteau qu’il venait de jeter sur ses épaules.
– Là, dit-il alors. Maintenant, suivez-moi. Et pas un mot, pas un geste! C’est dans votre intérêt.
Et il lui montra la pointe de sa dague. Maurevert fit signe qu’il obéirait. Pardaillan se mit en marche, traînant Maurevert, le serrant contre lui et le soutenant comme un ami bien cher.
Il se mit à descendre, mais cette fois par le grand escalier. Le château était plein de rumeurs sauvages, de hurlements des gens qui poursuivaient, des cris de miséricorde des gens qui étaient poursuivis. Dans ce tumulte, Pardaillan et Maurevert, presque enlacés, passèrent comme des spectres.
Dans la cour carrée, Maurevert eut un commencement de mouvement. Pardaillan s’arrêta et le regarda en face, en souriant. Ce sourire était terrible… Maurevert baissa la tête et poussa un faible gémissement.
– Allons! dit Pardaillan qui se remit en route.
Près du porche, Crillon, l’épée à la main, criait des ordres. Des soldats croisèrent la pique devant Pardaillan.
– Monsieur de Crillon, dit Pardaillan, il faut que je sorte.
Crillon regarda Pardaillan une minute avec une sorte d’effroi et d’étonnement mêlés. Puis il se découvrit et prononça:
– Laissez passer la justice royale!…
Les gardes se rangèrent et présentèrent les armes. Pardaillan franchit le porche, entraînant et soutenant Maurevert…
Sur l’esplanade, à vingt pas du porche, un homme se plaça près de Maurevert et se mit à marcher sans dire un mot. Tous les trois – Maurevert encadré entre Pardaillan et le nouveau venu – franchirent la porte de Russy, passèrent le pont et se mirent à remonter la Loire.
À une lieue environ du pont de Blois, ils s’arrêtèrent devant une masure abandonnée. Deux chevaux tout sellés étaient attachés à un restant de palissade qui avait dû entourer un jardinet attenant à la masure. Pardaillan poussa Maurevert dans l’unique pièce. L’inconnu entra derrière eux et ferma la porte.
– Asseyez-vous, dit Pardaillan à Maurevert en lui désignant un escabeau. Maurevert obéit. Il claquait des dents, et sûrement, il ne restait de vie en lui que ce qui peut en rester au condamné à mort, à trois pas de l’échafaud. Pardaillan lui lia les jambes solidement, et dès lors une lueur d’espoir se fit jour dans l’esprit de Maurevert, car du moment qu’on le liait, c’est qu’on ne devait pas le tuer tout de suite.
– Messire Clément, dit alors Pardaillan, puis-je vraiment compter sur vous?
– Cher ami, dit Jacques Clément, soyez tranquille, et allez sans crainte à vos affaires. Je jure Dieu que vous retrouverez l’homme où vous le laissez.
Pardaillan fit un signe de tête comme pour dire qu’il avait confiance dans ce serment. Il sortit sans jeter un regard à Maurevert et reprit en toute hâte le chemin de Blois. Jacques Clément tira son poignard et s’assit devant Maurevert.
XXXV LE DERNIER GESTE DE FAUSTA
Fausta, dès le matin, avait pris ses dernières dispositions. Elle avait expédié divers courriers et, entre autres, un cavalier chargé de courir au-devant de Farnèse pour lui dire de hâter sa marche sur Paris, car elle ne doutait nullement qu’Alexandre Farnèse ne fût entré en France depuis plusieurs jours déjà.
Puis elle avait tout fait préparer pour son départ le soir même. En effet, elle avait convenu avec Guise qu’aussitôt après le meurtre du roi, c’est-à-dire dans la nuit même, ils marcheraient sur Beaugency, Orléans, et, de là, sur Paris. Ce devait être une marche triomphale, pendant laquelle le duc de Guise devait proclamer ses droits à la couronne.
À Paris devait avoir lieu le couronnement, et Guise devait, dans Notre-Dame, présenter Fausta comme la reine de France.
C’est sur ce grand acte que se concentrait maintenant tout l’effort de Fausta. Tant que Guise ne lui aurait pas mis la couronne sur la tête, elle pouvait craindre qu’il n’essayât d’éluder ses engagements. Pourtant, ce n’était guère possible. Tout, au contraire, laissait présager à Fausta un triomphe définitif après lequel commencerait une série d’autres triomphes.
Ces derniers ordres donnés, ses derniers courriers expédiés, Fausta attendait donc vers huit heures du matin, dans ce grand salon où le cardinal de Bourbon avait célébré son mariage. Elle attendait que Guise vînt lui dire:
– Tout est prêt, madame, ce soir vous serez reine!
Un vague sourire détendait ses lèvres orgueilleuses. Elle souriait à cet avenir splendide qui s’ouvrait devant elle, et elle portait un défi suprême à la destinée.
Tout à coup, des bruits confus parvinrent jusqu’à elle. Et d’abord, elle n’y prêta pas attention, car les bourgeois criaient souvent par les rues. Puis, brusquement, elle se dressa. Des coups d’arquebuses éclataient. Elle entendait des piétinements de chevaux, des cris de terreur, des hurlements de bataille. Une sueur froide pointa à son front. Que se passait-il? Il lui eût été facile de le savoir en envoyant un valet interroger le premier venu dans la rue. Mais Fausta ne voulait pas savoir.
Читать дальше