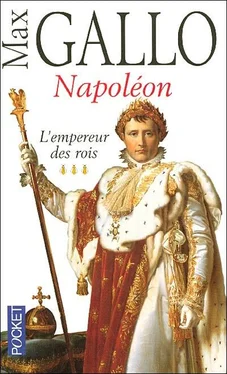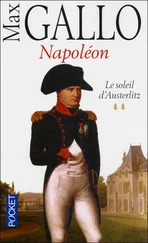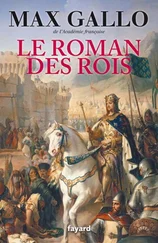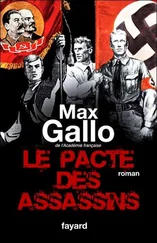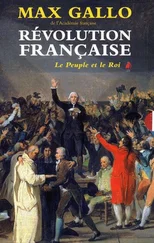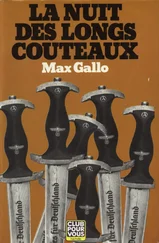Il l'embrasse. Il rentre à Trianon. Et l'inquiétude le reprend. Il faut que Joséphine surmonte l'épreuve. Si elle succombait, quelle blessure pour lui, et quel choc politique ! « L'Empereur égoïste, l'Empereur qui rejette sa vieille épouse et celle-ci dépérit et meurt », dirait-on.
Il écrit :
« Mon amie, je t'ai trouvée aujourd'hui plus faible que tu ne devrais être... Il ne faut pas te laisser aller à une funeste mélancolie ; il faut te trouver contente et surtout soigner ta santé qui m'est si précieuse. Si tu m'es attachée et si tu m'aimes, tu dois te comporter avec force et te placer heureuse. Tu ne peux pas mettre en doute ma constante et tendre amitié, et tu connaîtrais bien mal tous les sentiments que je te porte, si tu supposais que je puis être heureux si tu n'es pas heureuse, et content si tu ne te tranquillises.
« Adieu, mon amie, songe que je le veux.
« Napoléon »
Je dois la soutenir. Si elle coule, je m'enfonce aussi. Mon mariage serait compromis par le scandale et l'écho de sa mort ou simplement de son désespoir .
Elle ne peut pas, elle ne doit pas s'abandonner. J'ai besoin de sa vie, j'ai besoin qu'elle soit heureuse .
Il se répète la phrase qu'elle a murmurée d'une voix calme dans le parc de la Malmaison.
« Il me semble quelquefois, a-t-elle dit, que je suis morte et qu'il ne me reste qu'une sorte de faculté vague de sentir que je ne suis plus. »
Il reçoit d'elle des lettres qui exhalent toutes le même désespoir et le même accablement.
Il ne peut lui en vouloir. Elle s'est soumise. Mais l'irritation le gagne. Il ne lui a pas imposé cette souffrance pour rien.
Il convoque Champagny. A-t-on une réponse du tsar ?
Veut-il, ou non, que j'épouse sa sœur Anne ? Que valent ses excuses ? La mère d'Anne serait réticente ? Prétextes que tout cela. Il faut alors se tourner vers l'Autriche. Que Champagny bavarde avec le nouvel ambassadeur de Vienne à Paris, le prince Charles Schwarzenberg, un prince de valeur qui a sauvé ses hommes à Ulm et combattu à Wagram. Il faut qu'on sache si François I erest disposé à céder sa fille Marie-Louise. À moi, le Corsicain, l'Attila, l'Antéchrist - n'est-ce pas ainsi qu'à Vienne les jeunes duchesses me nomment ?
Il s'impatiente. Il faut obtenir une réponse immédiate, nouer rapidement le lien d'un mariage. Qui peut être sûr de l'avenir ?
Il pense à Joséphine. L'inquiétude est tout à coup si forte qu'il part chasser le cerf, se lançant au galop jusqu'à l'épuisement de son cheval. Il rentre à la nuit, mais Trianon, malgré la présence des officiers de sa maison et des domestiques, est froid et lui semble désert.
Il convoque le général Savary. Qu'il se rende à la Malmaison, qu'il voie Joséphine, qu'il fasse un rapport sur l'état de l'Impératrice.
Savary est revenu porteur d'une lettre de Joséphine. L'Impératrice est abattue, commence-t-il. Napoléon, avec impatience, l'écoute, lit la lettre, puis se met à écrire.
« Je reçois ta lettre, mon amie. Savary me dit que tu pleures toujours : cela n'est pas bien... Je viendrai te voir lorsque tu me diras que tu es raisonnable et que ton courage prend le dessus.
« Demain, toute la journée, j'ai les ministres.
« Adieu, mon amie, je suis triste aujourd'hui ; j'ai besoin de te savoir satisfaite et d'apprendre que tu prends de l'aplomb. Dors bien.
« Napoléon »
Que peut-il faire pour la forcer à vivre, à se redresser ? La voir !
« J'ai bien envie de te voir, mais il faut que je sois sûr que tu es forte et non faible ; je le suis aussi un peu et cela me fait un mal affreux. »
Le lundi 25 décembre, il l'invite à Trianon pour le dîner, mais, dès qu'il la voit, il regrette de l'avoir conviée. Elle a cet air battu de victime qu'il ne supporte pas. Il se sent incapable de parler, assis en face d'elle avec, à sa droite, la reine Hortense et Caroline, reine de Naples.
Parfois il baisse la tête parce que les larmes envahissent ses yeux.
Il a voulu, choisi cela.
Il n'y aura pas d'autre dîner avec Joséphine.
Il quitte Trianon dès le lendemain et rentre aux Tuileries. Il longe les galeries, traverse le salon où se tenait le cercle de l'Impératrice.
Ce palais, sans épouse, est mort.
Il se sent isolé. Il ne peut s'empêcher de lui écrire encore :
« J'ai été fort ennuyé de retrouver les Tuileries, Eugène m'a dit que tu avais été toute triste hier : cela n'est pas bien, mon amie, c'est contraire à ce que tu m'avais promis.
« Je vais dîner seul.
« Adieu, mon amie, porte-toi bien. »
C'est le dernier jour de cette année 1809, un dimanche. Il se rend à l'arc de triomphe du Carrousel pour assister à la parade de la vieille Garde qui défile, acclamée.
Il rentre à 15 heures aux Tuileries. Le soleil de ce 31 décembre illumine les pièces.
Il s'assied à sa table de travail. Il va écrire à Alexandre.
Il faudra que dans les jours qui viennent je sache quel ventre, autrichien ou russe, portera mon fils !
Il dicte la lettre d'une voix saccadée.
« Je laisse Votre Majesté juge, qui est le plus dans le langage de l'alliance et de l'amitié, d'Elle ou de moi. Commencer à se défier, c'est avoir déjà oublié Erfurt et Tilsit. »
La phrase est dure. Mais il ne veut pas la changer. Une confidence en effacera peut-être la rudesse.
« J'ai été un peu en retraite, reprend Napoléon, et vraiment affligé de ce que les intérêts de ma Monarchie m'ont obligé à faire. Votre Majesté connaît tout mon attachement pour l'Impératrice. »
Il signe.
L'année qui commence doit être celle d'une autre vie, d'une autre femme, de ma plus grande gloire. J'aurai quarante et un ans .
32.
Napoléon lit la lettre que vient de lui faire porter Joséphine. Elle se redresse, quoi qu'elle dise. Ce n'est plus le divorce qui la désespère, mais l'état de ses biens !
Il prise, va jusqu'à la fenêtre. Il se sent mieux depuis quelques jours. L'hiver 1810 est vif, mais le temps est clair. Les jours ont recommencé à allonger.
Il reprend la lettre, la parcourt et, penché, il trace quelques lignes.
« Tu es sans confiance en moi, écrit-il, tous les bruits que l'on répand te frappent ; tu aimes plutôt écouter les bavards d'une grande ville que ce que je te dis ; qu'il ne faut pas permettre que l'on te fasse des contes en l'air pour t'affliger.
« Je t'en veux, et si je n'apprends que tu es gaie et contente, j'irai te gronder bien fort.
« Adieu, mon amie.
« Napoléon »
Joséphine est redevenue ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Une femme qui dépense et qui chante comme une cigale mais qui a l'avidité prudente d'une fourmi. Et qui, maintenant qu'elle a accepté le divorce, évalue ce que contient sa cassette. Comptons.
« J'ai travaillé aujourd'hui avec Estève, le trésorier principal de la Couronne. J'ai accordé 100 000 francs pour 1810, pour l'extraordinaire de la Malmaison. Tu peux donc faire planter tant que tu voudras ; tu distribueras cette somme comme tu l'entendras. J'ai chargé Estève de te remettre 200 000 francs. J'ai ordonné que l'on paierait ta parure de rubis, laquelle sera évaluée par l'intendance, car je ne veux pas de voleries de bijoutiers. Ainsi, voilà 400 000 francs que cela me coûte.
« J'ai ordonné que l'on tînt le million que la liste civile te doit pour 1810, à la disposition de ton homme d'affaires, pour payer tes dettes.
« Tu dois trouver dans l'armoire de la Malmaison 5 à 600 000 francs ; tu peux les prendre pour faire ton argenterie et ton linge.
« J'ai ordonné qu'on te fît un très beau service de porcelaine ; l'on prendra tes ordres pour qu'il soit très beau.
« Napoléon »
Читать дальше