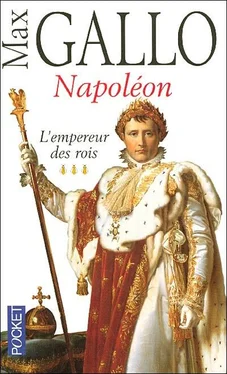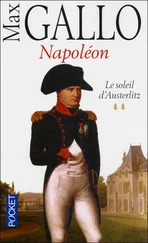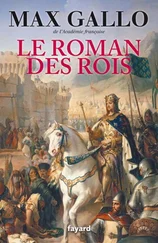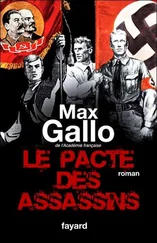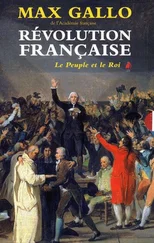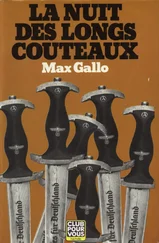- Figurez-vous que cette femme-là pleure toutes les fois qu'elle a une mauvaise digestion, parce qu'elle se croit empoisonnée par ceux qui veulent que je me marie avec quelqu'un d'autre, c'est détestable, dit-il d'un ton impatient à Duroc.
Peut-être pourra-t-il, en Italie, prendre une décision.
Il se souvient brusquement de la sœur d'Augusta de Bavière, Charlotte. Il a organisé le mariage d'Augusta et d'Eugène de Beauharnais. S'il épousait Charlotte ? Il dicte fébrilement une lettre d'invitation au roi et à la reine de Bavière, d'avoir à se trouver à Vérone avec leur fille. Voyons-la !
Puis, le 15 novembre, la veille de son départ pour Milan, il est à nouveau saisi par le doute. Il reprend sa lettre à Jérôme.
« Soyez roi constitutionnel », lui écrit-il.
Lui ne l'est pas. Il a choisi de mêler l'ancien et le nouveau. D'habiller les idées libérales sous les vieux oripeaux des préjugés, dont il a mesuré l'importance.
Et c'est pour cela qu'il a tissé cette trame avec les familles régnantes. Pour cela qu'il va rencontrer le roi et la reine de Bavière à Vérone. Mais que Jérôme ne se méprenne pas :
« Que la majorité de votre Conseil soit composée de non-nobles », écrit-il.
Il sourit, ajoute :
« Sans que personne ne s'aperçoive de cette habituelle bienveillance à maintenir en majorité le tiers état dans tous les emplois. »
Car, s'il est sûr que ce n'est jamais le passé qui l'emporte, il faut ruser. Même lorsqu'on est l'Empereur des rois.
1- Ancien ambassadeur de Russie à Paris, qui a été rappelé à la fin de 1803 sur les plaintes de Bonaparte.
14.
Napoléon commence à fredonner. La voiture vient à peine de quitter la cour du château de Fontainebleau, ce lundi 16 novembre 1807, et il est déjà joyeux. Il retrouve les paroles de cette chanson que souvent les soldats, quand il passe devant eux, avant la bataille, entonnent :
Napoléon est Empereur
V'là ce que c'est que d'avoir du cœur !
C'est le fils aîné de la valeur
Il est l'espérance
Et l'appui d' la France...
Il rit, pince l'oreille de son secrétaire assis dans la berline.
Il se sent rajeuni, débarrassé de ce poids qu'est la présence larmoyante de Joséphine.
Elle n'a pas pu lui donner un fils. Elle a porté ses enfants avant de le rencontrer. Est-ce sa faute à lui ? N'est-il pas légitime qu'il veuille qu'un fils lui succède ? C'est l'exigence de sa dynastie, de sa politique.
Il va résoudre cette question, puisqu'elle est déjà réglée dans sa tête. Sera-ce une princesse allemande, Charlotte de Bavière, ou bien une grande-duchesse russe ?
Il rit à nouveau, reprend le refrain :
Il lui rendra tout' sa splendeur
V'là ce que c'est que d'avoir du cœur !
Il a l'impression d'aller vers une nouvelle jeunesse.
Il se penche. Il aime cette route qui par le Bourbonnais conduit à Lyon, Chambéry, Milan. C'est le chemin de l'Italie, le pays où son destin s'est joué, à Lodi, à Arcole, à Marengo. Là, il a prouvé ce qu'il pouvait devenir. Là, à Campoformio, il a commencé à dessiner une nouvelle carte de l'Europe. Il va à la rencontre de sa jeunesse glorieuse, mais il est devenu empereur et roi, et il va rassembler autour de lui tous ces souverains qu'il a couronnés, qui sont ses vassaux.
Il fredonne :
C'est notre nouveau Charlemagne
Qui fait le bonheur des Français .
Il est heureux d'être seul, enfin, comme un jeune empereur de trente-huit ans auquel tout est promis, tout est permis.
On l'acclame lorsque, le dimanche 22 novembre, il entre dans la cathédrale de Milan pour assister au Te Deum .
Le soir, à la Scala, la salle n'en finit plus de l'applaudir et de crier.
Il regarde les femmes, il fait baisser les yeux des hommes. Il réunit les ministres, il donne des ordres à Eugène de Beauharnais, vice-roi. Il se rend au chevet d'Augusta de Bavière, cette épouse qu'il lui a donnée.
Il marche lentement dans les rues de Milan. Il aime ces acclamations, puis les hommages qu'il reçoit lorsqu'il accorde des audiences. Il se sent plus heureux qu'à Paris. Il est dégagé des liens qui parfois, en France, l'entravent. Ici, il est empereur et roi. Là-bas, Talleyrand, Fouché, Joséphine, ses sœurs se souviennent qu'il n'a été jadis que Bonaparte et qu'ils ont contribué à sa gloire. Joséphine est ce passé. Et il veut vivre l'avenir.
Il lui écrit, quelques lignes qu'il trace à la hâte.
« Je suis ici, mon amie, depuis deux jours. Je suis bien aise de ne pas t'avoir emmenée ; tu aurais horriblement souffert au passage du Mont-Cenis, où une tourmente m'a retenu vingt-quatre heures.
« J'ai trouvé Eugène bien portant : je suis fort content de lui. La princesse Augusta est malade ; j'ai été la voir à Monza ; elle a fait une fausse couche ; elle va mieux.
« Adieu, mon amie.
« Napoléon »
Il pleut sur la vallée du Pô, mais quelle importance ? Il reconnaît ces collines, ces peupliers bordant le lavis des rivières, ces villes, Brescia, Peschiera, Vérone enfin.
La foule se presse le long des routes, elle s'agglutine dans les rues, devant le théâtre de Vérone, où il se rend en compagnie d'Élisa, princesse de Lucques, de Joseph, roi de Naples, du roi et de la reine de Bavière.
Il suffit d'un regard à leur fille. Charlotte est laide. Que n'a-t-il épousé Augusta !
Dans la chambre du château de Stra, proche de Padoue, où il passe la nuit du samedi 28 novembre, il reçoit les dépêches de Paris. Dans les journaux, on évoque encore, de manière détournée, la répudiation de Joséphine.
Il enrage. Qu'on écrive à Maret, son secrétaire d'État, et qu'on fasse partir ce courrier immédiatement :
« Je vois avec peine, par vos bulletins, que l'on continue toujours à parler de choses qui doivent affliger l'Impératrice et qui sont inconvenantes sous tous les points de vue. »
Il ne faut pas que l'on persécute cette femme qu'il aima et qu'il quittera à l'heure qu'il aura choisie.
Il dort mal, irrité. Il donne ses ordres d'une voix cassante. Les acclamations, dans le petit port de Fusine, l'irritent, et il monte, tête baissée, les mains derrière le dos, à bord de la frégate qui doit le conduire à Venise.
Il fait beau. Une brise pousse le navire qui avance entouré de la flottille de l'Adriatique.
Tout à coup, il voit le Grand Canal, la basilique San Giorgio, la douane de mer, et cette multitude d'embarcations, de gondoles fleuries, qui se dirigent vers la frégate. Les cris, les fanfares l'accueillent au moment où il débarque sur la Piazzetta.
Il est 17 heures, le dimanche 29 novembre 1807.
La joie en lui emporte tout. Il s'installe au palazzo Balbi, sur le Grand Canal. Il assiste, de sa fenêtre, au jeu des forces. Il est le souverain de l'une des plus vieilles républiques du monde, le successeur du doge. Il se rend au théâtre de la Fenice, entouré des généraux qui ont avec lui fait la campagne d'Italie. Les rois et les reines l'entourent.
Il veut tout voir, les canaux, les lagunes, les palazzi , la bibliothèque.
Il ordonne qu'on place désormais les sépultures hors de la ville, dans une île, et non dans les églises, où elles risquent de contaminer la ville. Il arpente la piazza San Marco. Il aime ce décor de théâtre. Il veut qu'on l'éclaire.
Debout à la fenêtre du palazzo Balbi, il attend qu'une femme vienne le retrouver, comtesse vénitienne aux longs cheveux qu'il a remarquée au théâtre de la Fenice.
Il la possède. Il possède le monde. Il a le sentiment que rien ne peut lui résister.
Le matin, avant de quitter Venise, il signe les décrets qu'il a pris à Milan et qui renforcent le blocus continental. Puisque l'Angleterre exige des navires neutres qu'ils abordent chez elle avant de toucher l'Europe, il a décidé que ceux qui se plieront à cette loi seront considérés comme anglais, et leurs marchandises de cargaison de bonne prise.
Читать дальше