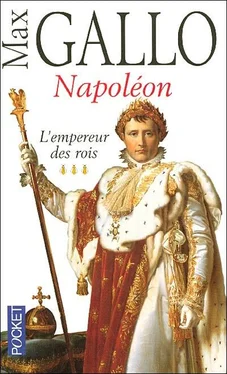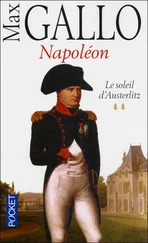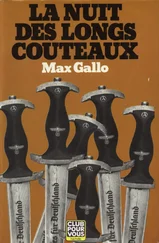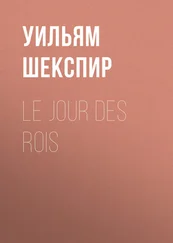Napoléon est assis en face de Kleist. Il veut la paix, dit-il, même avec l'Angleterre. « J'aurais horreur de moi d'être la cause de l'effusion de tant de sang. »
Kleist ne peut dissimuler une expression de joie.
Lui aussi doit imaginer que je suis prêt à céder .
Napoléon se lève, tourne le dos au colonel Kleist.
Si les puissances ne veulent pas la paix, dit-il, « je suis décidé à faire encore pendant dix ans la guerre. Je n'ai que trente-sept ans. J'ai vieilli sous les armes et dans les affaires ».
Telle est ma destinée .
8.
Napoléon, les mains derrière le dos, parcourt les pièces de cette grande demeure entourée d'un parc immense que prolongent les forêts de sapins. Derrière les arbres, il devine la petite localité de Finckenstein, qu'il vient de traverser, arrivant du château d'Osterode par la route de Marienwerder.
Il sent que cette maison lui convient. Les meubles sont peu nombreux, la décoration, composée de tableaux représentant des scènes de batailles et de quelques tapisseries, est austère, bien dans le goût prussien.
Il lui plaît que cette demeure ait été construire par un comte de Finckenstein, gouverneur de Frédéric II, et qu'elle appartienne aujourd'hui au comte Kohna, grand maître de la Maison du roi de Prusse.
Il établira ici son quartier général jusqu'à ce que les hostilités reprennent, dit-il à Duroc.
C'est au grand maréchal du palais de faire appliquer une étiquette stricte, que l'Empereur désire voir respectée par tous.
Napoléon va jusqu'à l'une des fenêtres de la pièce d'angle qu'il a choisie pour cabinet de travail.
Il veut, autour de lui, dit-il, un état-major réduit, mais toute l'infanterie de la Garde. Elle s'installera dans le parc du château. Qu'elle construise des baraques. Il veut de l'ordre. Il veut profiter de cette période d'accalmie avant l'affrontement, inévitable, puisque les troupes de Bennigsen n'ont pas été détruites, pour redonner toutes ses forces à la Grande Armée. Parade tous les jours devant la maison, dans le parc, dit-il. Manœuvres dans la campagne voisine. Il faut faire venir des approvisionnements, acheter des chevaux par milliers en Allemagne, reconstituer les régiments de cavalerie. Il les passera en revue. Il veut tout voir.
Il convoque déjà le chirurgien des armées Percy. Il dit à Duroc et à ses aides de camp qu'il ne tolérera plus que les blessés se traînent sur les routes. Il a, dans les heures qui ont suivi Eylau, abandonné sa voiture pour aider à leur transport. Il faut donner des moyens au service de santé.
Sa tête bouillonne d'idées. Il a hâte de se mettre au travail. Il est à l'aise ici. Il faut que Marie Walewska vienne y séjourner avec lui. Il trouvera, après ces mois sombres, cet hiver de froid et de sang, le calme nécessaire à l'organisation de l'avenir, à la préparation de la bataille qui mettra enfin les Russes et les Prussiens dans l'obligation de conclure la paix. Et, eux vaincus, que pourra l'Angleterre, sinon s'incliner, étranglée par le blocus continental ?
Il est gai, pour la première fois depuis la bataille d'Eylau. Il descend dans le jardin, s'y promène longuement en compagnie de Murat qui vient d'arriver à Finckenstein et qui, comme à son habitude, se pavane dans un uniforme extravagant, bonnet et gilet de fourrure, plumet. Napoléon l'écoute avec bienveillance. Murat a été héroïque et le sera encore. Qu'il entraîne ses régiments et qu'il se prépare.
Le temps est agréable en ce début d'avril 1807. On entend les chants d'oiseaux malgré les coups de masse des sapeurs charpentiers qui ont commencé de bâtir une petite ville de planches en avant de la forêt, pour les cantonnements des régiments - deux de grenadiers, deux de chasseurs et un de fusiliers.
Il chassera dans la forêt. Il respire longuement. Il va faire de Finckenstein le centre, la tête et le cœur de l'Empire.
Il rentre dans le château.
De part et d'autre de la grande porte en bois ouvragé, des grenadiers montent la garde. Il dit à Duroc de s'enquérir au plus vite du lieu où se trouve Marie Walewska afin... Il n'a pas besoin de conclure. Duroc s'incline et s'éloigne.
Dans son cabinet de travail, Napoléon écrit sa première lettre. C'est le jeudi 2 avril 1807.
« Je viens de porter mon quartier général à Finckenstein, dit-il à Joséphine. C'est un pays où le fourrage est abondant et où ma cavalerie peut vivre. Je suis dans un très beau château, qui a des cheminées dans toutes les chambres, ce qui m'est fort agréable, me levant beaucoup la nuit. J'aime voir le feu. Ma santé est parfaite. Le temps est beau, mais encore froid. »
Le matin, il est levé à l'aube. Dans le brouillard, il aperçoit les premiers feux des grenadiers qui s'allument dans le parc. Il a hâte d'être au travail. Il rudoie Constant et Roustam, trop lents pour sa toilette. Les affaires l'attendent, dépêches arrivées de Paris, décrets, règlements à dicter, ordres à renvoyer au maréchal Lefebvre qui dirige le siège de Dantzig où les troupes prussiennes du maréchal Kalkreuth refusent de se rendre.
C'est cela, le plus urgent, faire tomber cette place afin d'avoir le flanc libre pour se porter contre Bennigsen quand il commettra la faute de s'avancer.
Car tel est le plan. Napoléon revoit les cartes. Le maréchal Ney est en avant des lignes françaises, comme un appât. Il reculera afin d'attirer Bennigsen, qu'on enveloppera par les flancs et qu'on détruira comme on a déjà détruit les troupes russes à Austerlitz. Il faut une victoire aussi éclatante pour que le tsar Alexandre I ercomprenne enfin qu'il doit traiter. Et peut-être alors pourra-t-on conclure avec lui une alliance qui partagerait l'Europe en deux zones d'influence. Et qui ferait plier l'Angleterre.
Napoléon hausse la voix. Il dicte une lettre pour Talleyrand. Il vient d'apprendre qu'à Londres un nouveau cabinet s'est constitué autour du duc de Portland et qu'il a rassemblé autour de lui Canning, Castlereagh, Hawkesbury, tous des hommes de Pitt, des partisans de la guerre à outrance. Comment imaginer qu'on puisse traiter avec ces hommes-là ? Il faut les vaincre, donc battre les Russes, puis tenir le continent et faire entendre raison aux Anglais.
Mais qui comprend ces enjeux ? À Paris, on murmure, on rêve de paix, et cette sérénade se fait entendre jusque dans les salons de l'Impératrice.
« Ridicule coterie ! » s'exclame Napoléon.
Il écrit à Fouché, le ministre de la Police générale. Ne devrait-il pas surveiller et empêcher cela ?
« Il faut donner à l'opinion une direction plus ferme..., dit Napoléon. Il n'est pas question de parler sans cesse de paix, c'est le bon moyen de ne pas l'avoir... »
Napoléon froisse les journaux, les jette dans le feu. Ces hommes de lettres parlent et écrivent à tort et à travers, donnent dans leurs articles des informations militaires qui instruisent l'ennemi. Cela est fort bête.
Il se calme.
« L'esprit de parti étant mort, dicte-t-il, je ne puis voir que comme une calamité dix polissons sans talent et sans génie clabauder sans cesse contre les hommes les plus respectables, à tort et à travers. »
Mais qui d'autre que lui analyse clairement la situation ? Talleyrand lui-même, l'habile, le retors prince de Bénévent, s'illusionne sur l'attitude de tel ou tel, de l'Autriche qui offre sa médiation.
Napoléon se tourne vers Caulaincourt, son écuyer. Il l'interroge, insiste jusqu'à ce que Caulaincourt réponde qu'il regrette que « les espérances de paix s'éloignent, Sire ». Et le général Clarke approuve en hochant la tête.
Ils espèrent tous en la paix !
Et qui ne la voudrait ? Mais croient-ils qu'on la désire à Londres, et même à Vienne ? Croient-ils qu'on se détermine en fonction des sentiments ?
Читать дальше