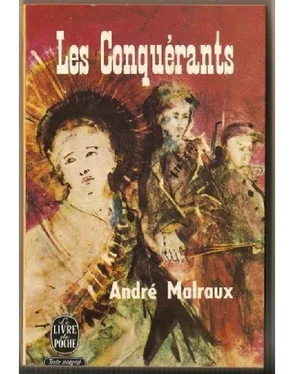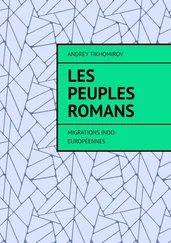- Qu'il est impossible que Tcheng se soit tué.
- Oui, je sais, il disait toujours que jamais il ne pourrait nous jouer ce tour-là. C'est à voir.
- Qu'en penses-tu toi-même ?
- Rien de net encore.
- Et lui ?
- Qui, lui ? Borodine ? Non. Tu as tort de sourire : nous n'y sommes pour rien, j'en suis certain. Même secondairement, même accidentellement. Il était aussi stupéfait que moi.
- Non, mais ?.. Et les tuyaux donnés à Hong ?
- Oh ! cela, c'est une autre affaire. D'après le premier rapport, il n'est nullement certain que Hong y soit pour quelque chose : la garde militaire n'a pas cessé sa faction, et personne n'est entré. Mais peu importe. Nous avons bien autre chose à faire. D'abord, les affiches. Note et traduis ceci :
« N'oublions jamais qu'un homme respecté par toute la Chine, Tcheng-Daï, a été assassiné hier, lâchement, par les agents de nos ennemis .
« Et, pour une autre affiche que l'on devra coller À COTÉ :
« Honte à l'Angleterre, honte aux assassins de Shanghai et de Canton !
« Tu mettras dans le coin de la seconde, en petits caractères : 2o mai-25 juin (l'histoire de Shanghaï et celle de Shameen).
« Bon. On comprendra. Maintenant, le communiqué aux sections : Tcheng-Daï ne s'est pas suicidé, il a été assassiné par les agents anglais. Rien n'empêchera le Bureau politique de faire justice.
« Fleuri, mais court.
- Tu abandonnes les terroristes ?
- Hongkong d'abord. C'est un coup à accrocher le décret !
Il s'assied. Pendant que je traduis, il dessine des oiseaux fantastiques sur le buvard, se lève, marche de long en large, revient au bureau, recommence à dessiner, abandonne encore son crayon, examine avec attention son revolver, et enfin réfléchit, le menton dans ses mains. Je lui remets les deux traductions.
- Tu es tout à fait sûr de tes deux textes ?
- Tout à fait sûr. Dis donc, ça te serait peut-être égal de me dire à quoi ça sert ?
- Ça se voit.
- Pas très bien.
- Ça se colle sur les murs, figure-toi.
Je le regarde, interloqué.
- Mais voyons, avant que ton affiche soit imprimée, tous les Chinois auront lu l'autre ?..
- Non.
- Tu veux les faire arracher ? C'est long.
- Non ! Je les fais recouvrir. Les troupes qui nous suivent seront employées de diverses façons et ne viendront pas dans la ville avant midi. À cinq heures les irréguliers circuleront en tirant des coups de fusil. La police est prévenue. Les bourgeois n'oseront pas sortir pendant plusieurs heures. Les autres ne savent pas lire. D'ailleurs presque toutes leurs affiches seront recouvertes avant trois heures. Demain - ou plutôt aujourd'hui : il est une heure - à huit heures, il y en aura cinq mille des nôtres, sur les murs. Nous en tirerons cent mille sous forme de papillons. Vingt ou cinquante affiches que nous aurons oublié de recouvrir ne pourront rien contre cela, d'autant plus qu'elles ne seront pas connues avant les nôtres !
- Et s'ils profitaient de cette mort pour tenter quelque chose ?
- Rien à faire. C'est trop tôt, ils n'ont presque pas de troupes ; eux-mêmes n'oseront pas. Quant au peuple, à supposer qu'il ne nous crût pas sans réserves, il hésiterait. On ne fait pas un mouvement populaire avec des hésitants. Non, ça va.
- S'il ne s'est pas tué...
- S'il s'était tué, nous aurions bien d'autres choses contre nous !
-... il faut admettre que ce sont ceux qui bénéficient de l'affiche bleue qui l'ont « suicidé » ?
- Ceux qui ont fait l'affiche sont dans la même position que nous. Ils ont reçu leurs renseignements plus tôt, voilà tout. Et ils les ont utilisés le plus vite possible. Nous aussi, nous faisons des affiches. Oh ! nous saurons bientôt à quoi nous en tenir ! Mais, pour le moment il faut parer au plus pressé. Il se pourrait fort bien que cette mort fût une affaire...
Nous descendons presque en courant.
- Et Borodine ?
- Je l'ai vu en passant. Malade. Chacun son tour. Je me demande si l'on n'a pas tenté de l'empoisonner. Ses boys sont sûrs, et, de plus...
La phrase est coupée net. Descendant très vite derrière moi, il a manqué une marche et a pu, juste à temps, saisir les barreaux de la rampe. Il s'arrête une seconde, reprend sa respiration, rejette ses cheveux en arrière et recommence à descendre aussi vite qu'il le faisait avant sa chute, en parlant :
- Et de plus, surveillés...
L'automobile.
- À l'imprimerie.
Nous posons nos revolvers sur la banquette, à portée de la main. La ville semble fort calme... À peine notre course nous laisse-t-elle distinguer, comme des raies, les lumières électriques que nous dépassons, et, plus loin, les échoppes closes de planches mal jointes qui laissent passer une faible clarté. Pas de lune, pas de maisons découpées. La vie est collée au sol : quinquets, marchands ambulants, gargotes, lampes à la flamme droite dans la nuit chaude et sans air, ombres rapides, silhouettes immobiles, phonographes, phonographes... Au loin, pourtant, des coups de fusil.
Voici l'imprimerie. Notre imprimerie. Un long hangar... À l'intérieur, la lumière est si intense que nous sommes d'abord obligés de fermer les yeux. Les ouvriers qui travaillent là sont tous du Parti, et choisis ; néanmoins, cette nuit, les portes sont gardées militairement. Les soldats attendaient notre arrivée. Un lieutenant très jeune - un cadet - vient prendre les ordres de Garine. Ne laisser entrer ni sortir personne. Le travail commencé est suspendu. Je tends les deux traductions au directeur de l'imprimerie - un Chinois - qui les découpe avec soin en lignes verticales et donne une ligne à chaque compositeur.
« Corrige, me dit Garine, et apporte-moi la première feuille tirée. Je serai à la Sûreté. Sinon, tu m'y attendras. Je vais te faire envoyer une auto. »
Les deux textes sont rapidement composés. Le directeur recolle les lignes les unes à côté des autres et me passe le placard d'épreuves ; aucun des ouvriers ne connaît le sens de l'affiche qu'il a contribué à imprimer.
Deux machines sont arrêtées et leurs conducteurs attendent les « formes » que nous allons leur apporter. Peu de fautes. Encore deux minutes pour les corrections. Et les formes sont portées sur la machine, calées à la fois avec les mains et avec les pieds nus.
Je prends la première feuille tirée et pars.
Une auto est là, qui me mène à toute vitesse à la Sûreté. Au loin, quelques coups de feu. À la porte, un cadet m'accueille, puis me conduit au bureau où Garine m'attend, à travers des corridors déserts (éclairés par des ampoules éloignées les unes des autres, entourées de halos), et où le son des pas prend l'ampleur et la netteté des sons nocturnes. Je commence à éprouver une fatigue diffuse mêlée d'exaltation, et à sentir dans ma gorge le goût des nuits blanches : fièvre et alcool...
Un grand bureau bien éclairé. Garine y marche de long en large, le visage exténué, les mains dans ses poches. Contre le mur, un lit de camp chinois en bois découpé sur lequel Nicolaïeff est couché.
- Alors ?
Je lui tends l'affiche :
- Fais attention, l'encre est fraîche : j'en ai plein les mains.
Il hausse les épaules, déploie l'affiche, la regarde et rentre les lèvres comme s'il les rongeait. (Ne pas savoir le cantonais ni les caractères, ou plutôt savoir très mal l'un et les autres, l'exaspère, et il n'a plus le temps d'apprendre).
- Tu es sûr que c'est bien ?
- Sois tranquille. Dis donc, tu sais qu'on commence à se battre dans les rues ?
- À se battre ?
- Enfin, je ne sais pas, mais j'ai entendu tirer en venant.
- Les coups étaient nombreux ?
- Oh ! non, espacés.
- Bon. Alors ça va. Ce sont nos hommes qui commencent à descendre des colleurs d'affiches bleues.
Читать дальше