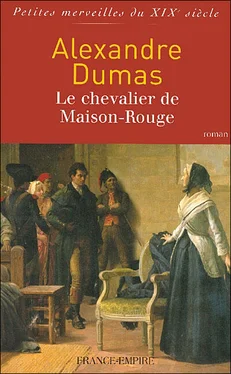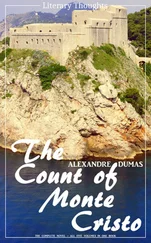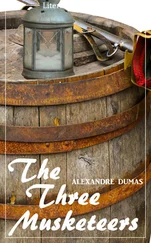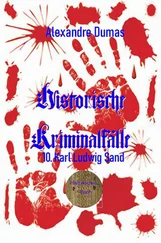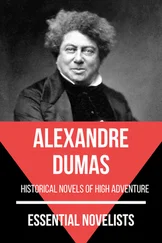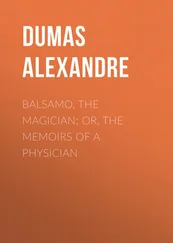– Il n’y a pas de scélérat là-dedans, reprit Dixmer; j’ai besoin de parler à ma femme, et je te demande une carte pour arriver jusqu’à elle.
– Voyons, est-ce donc si nécessaire que tu lui parles?
– Il paraît, puisque je risque ma tête pour y parvenir.
La raison parut plausible au greffier. Dixmer vit qu’il était ébranlé.
– Allons, dit-il, rassure-toi, on n’en saura rien. Que diable! il doit se présenter parfois des cas pareils à celui où je me trouve.
– C’est rare. Il n’y a pas grande concurrence.
– Eh bien, voyons, arrangeons cela autrement.
– Si c’est possible, je ne demande pas mieux.
– C’est on ne peut plus possible. Entre par la porte des condamnés; par cette porte-là, il ne faut pas de carte. Et puis, quand tu auras parlé à ta femme, tu m’appelleras et je te ferai sortir.
– Pas mal! fit Dixmer; malheureusement, il y a une histoire qui court la ville.
– Laquelle?
– L’histoire d’un pauvre bossu qui s’est trompé de porte, et qui, croyant entrer aux archives, est entré dans la salle dont nous parlons. Seulement, comme il y était entré par la porte des condamnés, au lieu d’y entrer par la grande porte; comme il n’avait pas de carte pour faire reconnaître son identité, une fois entré, on n’a pas voulu le laisser sortir. On lui a soutenu que, puisqu’il était entré par la porte des autres condamnés, il était condamné comme les autres. Il a eu beau protester, jurer, appeler, personne ne l’a cru, personne n’est venu à son aide, personne ne l’a fait sortir. De sorte que, malgré ses protestations, ses serments, ses cris, l’exécuteur lui a d’abord coupé les cheveux, et ensuite le cou. L’anecdote est-elle vraie, citoyen greffier? Tu dois le savoir mieux que personne.
– Hélas! oui, elle est vraie! dit le greffier tout tremblant.
– Eh bien, tu vois donc qu’avec de pareils antécédents, je serais un fou d’entrer dans un pareil coupe-gorge.
– Mais puisque je serai là, je te dis!
– Et si l’on t’appelle, si tu es occupé ailleurs, si tu oublies?
Dixmer appuya impitoyablement sur le dernier mot:
– Si tu oublies que je suis là?
– Mais puisque je te promets…
– Non; d’ailleurs, cela te compromettrait: on te verrait me parler; et puis, enfin, cela ne me convient pas.
» Ainsi j’aime mieux cette carte.
– Impossible.
– Alors, cher ami, je parlerai, et nous irons faire un tour ensemble à la place de la Révolution.
Le greffier, ivre, étourdi, à demi mort, signa un laissez-passer pour un citoyen.
Dixmer se jeta dessus et sortit précipitamment pour aller prendre, dans le prétoire, la place où nous l’avons vu.
On sait le reste.
De ce moment, le greffier, pour éviter toute accusation de connivence, alla s’asseoir près de Fouquier-Tinville, laissant la direction de son greffe à son premier commis.
À trois heures dix minutes, Maurice, muni de la carte, traversa une haie de guichetiers et de gendarmes, et arriva sans encombre à la porte fatale.
Quand nous disons fatale, nous exagérons, car il y avait deux portes. La grande porte, par laquelle entraient et sortaient les porteurs de carte; et la porte des condamnés, par laquelle entraient ceux qui ne devaient sortir que pour marcher à l’échafaud.
La pièce dans laquelle venait de pénétrer Maurice était séparée en deux compartiments.
Dans l’un de ces compartiments siégeaient les employés chargés d’enregistrer les noms des arrivants; dans l’autre, meublée seulement de quelques bancs de bois, on déposait à la fois ceux qui venaient d’être arrêtés et ceux qui venaient d’être condamnés; ce qui était à peu près la même chose.
La salle était sombre, éclairée seulement par les vitres d’une cloison prise sur le greffe.
Une femme vêtue de blanc et à demi évanouie gisait dans un coin, adossée au mur.
Un homme était debout devant elle, les bras croisés, secouant de temps en temps la tête et hésitant à lui parler, de peur de lui rendre le sentiment qu’elle paraissait avoir perdu.
Autour de ces deux personnages, on voyait remuer confusément les condamnés, qui sanglotaient ou chantaient des hymnes patriotiques.
D’autres se promenaient à grands pas, comme pour fuir hors de la pensée qui les dévorait.
C’était bien l’antichambre de la mort, et l’ameublement la rendait digne de ce nom.
On voyait des bières, remplies de paille, s’entr’ouvrir comme pour appeler les vivants: c’étaient des lits de repos, des tombeaux provisoires.
Une grande armoire s’élevait dans la paroi opposée au vitrage.
Un prisonnier l’ouvrit par curiosité et recula d’horreur.
Cette armoire renfermait les habits sanglants des suppliciés de la veille, et de longues tresses de cheveux pendaient çà et là: c’étaient les pourboires du bourreau, qui les vendait aux parents, lorsque l’autorité ne lui enjoignait pas de brûler ces chères reliques.
Maurice, palpitant, hors de lui, eut à peine ouvert la porte, qu’il vit tout le tableau d’un coup d’œil.
Il fit trois pas dans la salle et vint tomber aux pieds de Geneviève.
La pauvre femme poussa un cri que Maurice étouffa sur ses lèvres.
Lorin serrait, en pleurant, son ami dans ses bras; c’étaient les premières larmes qu’il eût versées.
Chose étrange! tous ces malheureux assemblés, qui devaient mourir ensemble, regardaient à peine le touchant tableau que leur offraient ces malheureux, leurs semblables.
Chacun avait trop de ses propres émotions pour prendre une part des émotions des autres.
Les trois amis demeurèrent un moment unis dans une étreinte muette, ardente et presque joyeuse.
Lorin se détacha le premier du groupe douloureux.
– Tu es donc condamné aussi? dit-il à Maurice.
– Oui, répondit celui-ci.
– Oh! bonheur! murmura Geneviève.
La joie des gens qui n’ont qu’une heure à vivre ne peut pas même durer autant que leur vie.
Maurice, après avoir contemplé Geneviève avec cet amour ardent et profond qu’il avait dans le cœur, après l’avoir remerciée de cette parole à la fois si égoïste et si tendre qui venait de lui échapper, se tourna vers Lorin:
– Maintenant, dit-il tout en enfermant dans sa main les deux mains de Geneviève, causons.
– Ah! oui, causons, répondit Lorin; mais s’il nous en reste le temps, c’est bien juste. Que veux-tu me dire? Voyons.
– Tu as été arrêté à cause de moi, condamné à cause d’elle, n’ayant rien commis contre les lois; comme Geneviève et moi nous payons notre dette, il ne convient pas qu’on te fasse payer en même temps que nous.
– Je ne comprends pas.
– Lorin, tu es libre.
– Libre, moi? Tu es fou! dit Lorin.
– Non, je ne suis pas fou; je te répète que tu es libre, tiens, voici un laissez-passer. On te demandera qui tu es; tu es employé au greffe des Carmes; tu es venu parler au citoyen greffier du Palais; tu lui as, par curiosité, demandé un laissez-passer pour voir les condamnés; tu les as vus, tu es satisfait et tu t’en vas.
– C’est une plaisanterie, n’est-ce pas?
– Non pas, mon cher ami, voici la carte, profite de l’avantage. Tu n’es pas amoureux, toi; tu n’as pas besoin de mourir pour passer quelques minutes de plus avec la bien-aimée de ton cœur, et ne pas perdre une seconde de ton éternité.
– Eh bien! Maurice, dit Lorin, si l’on peut sortir d’ici, ce que je n’eusse jamais cru, je te jure, pourquoi ne fais-tu pas sauver madame d’abord? Quant à toi, nous aviserons.
– Impossible, dit Maurice avec un affreux serrement de cœur; tiens, tu vois, il y a sur la carte un citoyen, et non une citoyenne; et, d’ailleurs, Geneviève ne voudrait pas sortir en me laissant ici, vivre en sachant que je vais mourir.
Читать дальше