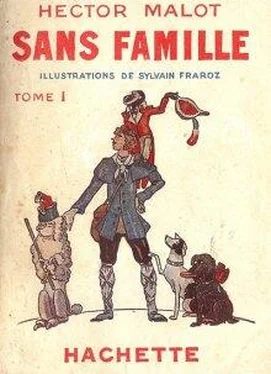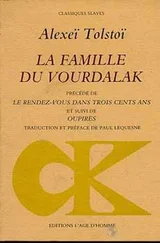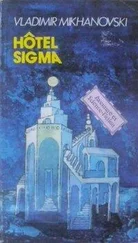Je ne pouvais pas lui expliquer les raisons qui m’avaient obligé, à mon grand regret, de le laisser sur le pont, et, comme je sentais que j’avais, du moins en apparence, des torts envers lui, je le pris dans mes bras, pour lui témoigner mes regrets par quelques caresses.
Tout d’abord il persista dans sa bouderie, mais bientôt, avec sa mobilité d’humeur, il pensa à autre chose, et, par sa pantomime, il m’expliqua que, si je voulais aller me promener avec lui à terre, il me pardonnerait peut-être.
Le marinier que j’avais vu la veille au gouvernail était déjà levé et il s’occupait à nettoyer le pont : il voulut bien mettre la planche à terre, et je pus descendre dans la prairie avec ma troupe.
En jouant avec les chiens et avec Joli-Cœur, en courant, en sautant les fossés, en grimpant aux arbres, le temps passa vite ; quand nous revînmes, les chevaux étaient attelés au bateau et attachés à un peuplier sur le chemin de halage : ils n’attendaient qu’un coup de fouet pour partir.
J’embarquai vite ; quelques minutes après, l’amarre qui retenait le bateau à la rive fut larguée, le marinier prit place au gouvernail, le haleur enfourcha son cheval, la poulie dans laquelle passait la remorque grinça, nous étions en route.
Quel plaisir que le voyage en bateau ! les chevaux trottaient sur le chemin de halage, et, sans que nous sentissions un mouvement, nous glissions légèrement sur l’eau ; les deux rives boisées fuyaient derrière nous, et l’on n’entendait d’autre bruit que celui du remous contre la carène dont le clapotement se mêlait à la sonnerie des grelots que les chevaux portaient à leur cou.
Nous allions, et penché sur le bordage, je regardais les peupliers qui, les racines dans l’herbe fraîche, se dressaient fièrement, agitant dans l’air tranquille du matin leurs feuilles toujours émues ; leur longue file alignée selon la rive, formait un épais rideau vert qui arrêtait les rayons obliques du soleil, et ne laissait venir à nous qu’une douce lumière tamisée par le branchage.
De place en place l’eau se montrait toute noire, comme si elle recouvrait des abîmes insondables ; ailleurs au contraire, elle s’étalait en nappes transparentes qui laissaient voir des cailloux lustrés et des herbes veloutées.
J’étais absorbé dans ma contemplation, lorsque j’entendis prononcer mon nom derrière moi.
Je me retournai vivement : c’était Arthur qu’on apportait sur sa planche ; sa mère était près de lui.
— Vous avez bien dormi ? me demanda Arthur, mieux que dans les champs ?
Je m’approchai et répondis en cherchant des paroles polies que j’adressai à la mère tout autant qu’à l’enfant.
— Et les chiens ? dit-il.
Je les appelai, ainsi que Joli-Cœur ; ils arrivèrent en saluant et Joli-Cœur en faisant des grimaces, comme lorsqu’il prévoyait que nous allions donner une représentation.
Mais il ne fut pas question de représentation, ce matin-là.
Madame Milligan avait installé son fils à l’abri des rayons du soleil ; et elle s’était placée près de lui.
— Voulez-vous emmener les chiens et le singe, me dit-elle, nous avons à travailler.
Je fis ce qui m’était demandé, et je m’en allai avec ma troupe, tout à l’avant.
À quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre ?
Je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon, dont elle suivait le texte dans un livre ouvert.
Étendu sur sa planche, Arthur répétait sans faire un mouvement.
Ou plus justement, il essayait de répéter, car il hésitait terriblement, et ne disait pas trois mots couramment ; encore bien souvent se trompait-il.
Sa mère le reprenait avec douceur, mais en même temps avec fermeté.
— Vous ne savez pas votre fable, dit-elle.
Cela me parut étrange de l’entendre dire vous à son fils, car je ne savais pas alors que les Anglais ne se servent pas du tutoiement.
— Oh ! maman, dit-il d’une voix désolée.
— Vous faites plus de fautes aujourd’hui que vous n’en faisiez hier.
— J’ai tâché d’apprendre.
— Et vous n’avez pas appris.
— Je n’ai pas pu.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas… parce que je n’ai pas pu… Je suis malade.
— Vous n’êtes pas malade de la tête ; je ne consentirai jamais à ce que vous n’appreniez rien, et que, sous prétexte de maladie, vous grandissiez dans l’ignorance.
Elle me paraissait bien sévère, madame Milligan, et cependant elle parlait sans colère et d’une voix tendre.
— Pourquoi me désolez-vous en n’apprenant pas vos leçons ?
— Je ne peux pas, maman, je vous assure que je ne peux pas.
Et Arthur se prit à pleurer.
Mais madame Milligan ne se laissa pas ébranler par ses larmes, bien qu’elle parût touchée et même désolée, comme elle avait dit.
— J’aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi et avec les chiens, continua-t-elle, mais vous ne jouerez que quand vous m’aurez répété votre fable sans faute.
Disant cela, elle donna le livre à Arthur et fit quelques pas, comme pour rentrer dans l’intérieur du bateau, laissant son fils couché sur sa planche.
Il pleurait à sanglots et de ma place j’entendais sa voix entrecoupée.
Comment madame Milligan pouvait-elle être sévère avec ce pauvre petit, qu’elle paraissait aimer si tendrement ? s’il ne pouvait pas apprendre sa leçon, ce n’était pas sa faute, c’était celle de la maladie sans doute.
Elle allait donc disparaître sans lui dire une bonne parole.
Mais elle ne disparut pas ; au lieu d’entrer dans le bateau, elle revint vers son fils.
— Voulez-vous que nous essayions de l’apprendre ensemble ? dit-elle.
— Oh ! oui, maman, ensemble.
Alors elle s’assit près de lui, et reprenant le livre, elle commença à lire doucement la fable, qui s’appelait : Le Loup et le jeune Mouton ; après elle, Arthur répétait les mots et les phrases.
Lorsqu’elle eut lu cette fable trois fois, elle donna le livre à Arthur, en lui disant d’apprendre maintenant tout seul, et elle rentra dans le bateau.
Aussitôt Arthur se mit à lire sa fable, et de ma place où j’étais resté, je le vis remuer les lèvres.
Il était évident qu’il travaillait et qu’il s’appliquait.
Mais cette application ne dura pas longtemps ; bientôt il leva les yeux de dessus son livre, et ses lèvres remuèrent moins vite, puis tout à coup elles s’arrêtèrent complètement.
Il ne lisait plus, et ne répétait plus.
Ses yeux, qui erraient çà et là, rencontrèrent les miens.
De la main je lui fis un signe pour l’engager à revenir à sa leçon.
Il me sourit doucement comme pour me dire qu’il me remerciait de mon avertissement, et ses yeux se fixèrent de nouveau sur son livre.
Mais bientôt ils se relevèrent et allèrent d’une rive à l’autre du canal.
Comme ils ne regardaient pas de mon côté, je me levai et ayant ainsi provoqué son attention, je lui montrai son livre.
Il le reprit d’un air confus.
Malheureusement, deux minutes après, un martin-pêcheur, rapide comme une flèche, traversa le canal à l’avant du bateau, laissant derrière lui un rayon bleu.
Arthur souleva la tête pour le suivre.
Puis quand la vision fut évanouie, il me regarda.
Alors m’adressant la parole :
— Je ne peux pas, dit-il, et cependant je voudrais bien.
Je m’approchai.
— Cette fable n’est pourtant pas bien difficile, lui dis-je.
— Oh ! si, bien difficile, au contraire.
— Elle m’a paru très-facile ; et en écoutant votre maman la lire, il me semble que je l’ai retenue.
Il se mit à sourire d’un air de doute.
Читать дальше