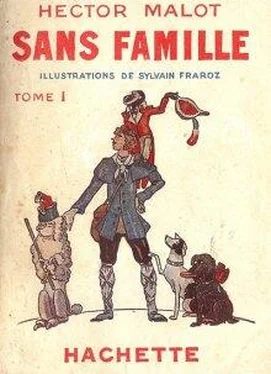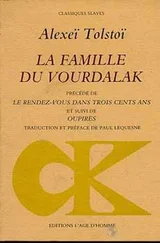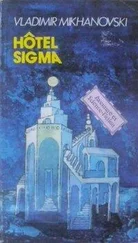À mesure que je parlais, le monsieur prenait des notes et il me regardait d’une façon qui me gênait : il faut dire que son visage était dur, avec quelque chose de fourbe dans le sourire.
— Et quel est ce garçon, dit-il, en désignant Mattia du bout de sa plume de fer, comme s’il voulait lui darder une flèche.
— Un ami, un camarade, un frère.
— Très-bien ; simple connaissance faite sur les grands chemins, n’est-ce pas ?
— Le plus tendre, le plus affectueux des frères.
— Oh ! Je n’en doute pas.
Le moment me parut venu de poser enfin la question qui depuis le commencement de notre entretien m’oppressait.
— Ma famille, monsieur, habite l’Angleterre ?
— Certainement elle habite Londres ; au moins en ce moment.
— Alors je vais la voir ?
— Dans quelques instants vous serez près d’elle. Je vais vous faire conduire.
Il sonna.
— Encore un mot, monsieur, je vous prie : J’ai un père ?
Ce fut à peine si je pus prononcer ce mot.
— Non-seulement un père, mais une mère, des frères, des sœurs.
— Ah ! monsieur.
Mais la porte en s’ouvrant coupa mon effusion : je ne pus que regarder Mattia les yeux pleins de larmes.
Le monsieur s’adressa en anglais à celui qui entrait et je crus comprendre qu’il lui disait de nous conduire.
Je m’étais levé.
— Ah ! j’oubliais, dit le monsieur, votre nom est Driscoll, c’est le nom de votre père.
Malgré sa mauvaise figure je crois que je lui aurais sauté au cou s’il m’en avait donné le temps ; mais de la main il nous montra la porte et nous sortîmes.
Chapitre 13
La famille Driscoll
Le clerc qui devait me conduire chez mes parents était un vieux petit bonhomme ratatiné, parcheminé, ridé, vêtu d’un habit noir râpé et lustré, cravaté de blanc ; lorsque nous fûmes dehors il se frotta les mains frénétiquement en faisant craquer les articulations de ses doigts et de ses poignets, secoua ses jambes comme s’il voulait envoyer au loin ses bottes éculées et levant le nez en l’air, il aspira fortement le brouillard à plusieurs reprises, avec la béatitude d’un homme qui a été enfermé.
— Il trouve que ça sent bon, me dit Mattia en italien.
Le vieux bonhomme nous regarda, et sans nous parler, il nous fît « psit, psit », comme s’il s’était adressé à des chiens, ce qui voulait dire que nous devions marcher sur ses talons et ne pas le perdre.
Nous ne tardâmes pas à nous trouver dans une grande rue encombrée de voitures ; il en arrêta aupassage une dont le cocher au lieu d’être assis sur son siège derrière son cheval, était perché en l’air derrière et tout au haut d’une sorte de capote de cabriolet ; je sus plus tard que cette voiture s’appelait un cab .
Il nous fit monter dans cette voiture qui n’était pas close par devant, et au moyen d’un petit judas ouvert dans la capote il engagea un dialogue avec le cocher ; plusieurs fois le nom de Bethnal-Green fut prononcé et je pensai que c’était le nom du quartier dans lequel demeuraient mes parents ; je savais que green en anglais veut dire vert et cela me donna l’idée que ce quartier devait être planté de beaux arbres, ce qui tout naturellement me fut très-agréable ; cela ne ressemblerait point aux vilaines rues de Londres si sombres et si tristes que nous avions traversées en arrivant ; c’était très-joli une maison dans une grande ville, entourée d’arbres.
La discussion fut assez longue entre notre conducteur et le cocher ; tantôt c’était l’un qui se haussait au judas pour donner des explications, tantôt c’était l’autre qui semblait vouloir se précipiter de son siège par cette étroite ouverture pour dire qu’il ne comprenait absolument rien à ce qu’on lui demandait.
Mattia et moi nous étions tassés dans un coin avec Capi entre mes jambes, et, en écoutant cette discussion, je me disais qu’il était vraiment bien étonnant qu’un cocher ne parût pas connaître un endroit aussi joli que devait l’être Bethnal-Green ; il y avait donc bien des quartiers verts à Londres ? Cela était assez étonnant, car d’après ce que nous avions déjà vu, j’aurais plutôt cru à de la suie.
Nous roulons assez vite dans des rues larges, puis dans des rues étroites, puis dans d’autres rues larges, mais sans presque rien voir autour de nous, tant le brouillard qui nous enveloppe est opaque ; il commence à faire froid, et cependant nous éprouvons un sentiment de gêne dans la respiration comme si nous étouffions. Quand je dis nous, il s’agit de Mattia et de moi, car notre guide paraît au contraire se trouver à son aise ; en tout cas, il respire l’air fortement, la bouche ouverte, en reniflant, comme s’il était pressé d’emmagasiner une grosse provision d’air dans ses poumons, puis, de temps en temps, il continue à faire craquer ses mains et à détirer ses jambes. Est-ce qu’il est resté pendant plusieurs années sans remuer et sans respirer ?
Malgré l’émotion qui m’enfièvre à la pensée que dans quelques instants, dans quelques secondes peut-être, je vais embrasser mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, j’ai grande envie de voir la ville que nous traversons : n’est-ce pas ma ville, ma patrie ?
Mais, j’ai beau ouvrir les yeux, je ne vois rien ou presque rien, si ce n’est les lumières rouges du gaz qui brûlent dans le brouillard, comme dans un épais nuage de fumée ; c’est à peine si on aperçoit les lanternes des voitures que nous croisons, et, de temps en temps nous nous arrêtons court, pour ne pas accrocher ou pour ne pas écraser des gens qui encombrent les rues.
Nous roulons toujours ; il y a déjà bien longtemps que nous sommes sortis de chez Greth and Galley ; cela me confirme dans l’idée que mes parents demeurent à la campagne ; bientôt sans doute nous allons quitter les rues étroites pour courir dans les champs.
Comme nous nous tenons la main, Mattia et moi, cette pensée que je vais retrouver mes parents me fait serrer la sienne ; il me semble qu’il est nécessaire de lui exprimer que je suis son ami, en ce moment même, plus que jamais et pour toujours.
Mais au lieu d’arriver dans la campagne, nous entrons dans des rues plus étroites, et nous entendons le sifflet des locomotives.
Alors je prie Mattia de demander à notre guide si nous n’allons pas enfin arriver chez mes parents ; la réponse de Mattia est désespérante : il prétend que le clerc de Greth and Galley a dit qu’il n’était jamais venu dans ce quartier de voleurs. Sans doute Mattia se trompe, il ne comprend pas ce qu’on lui a répondu. Mais il soutient que thieves, le mot anglais dont le clerc s’est servi, signifie bien voleurs en français, et qu’il en est sûr. Je reste un moment déconcerté, puis je me dis que si le clerc a peur des voleurs, c’est que justement nous allons entrer dans la campagne, et que le mot green qui se trouve après Bethnal, s’applique bien à des arbres et à des prairies. Je communique cette idée à Mattia, et la peur du clerc nous fait beaucoup rire : comme les gens qui ne sont pas sortis des villes sont bêtes !
Mais rien n’annonce la campagne : l’Angleterre n’est donc qu’une ville de pierre et de boue qui s’appelle Londres ? Cette boue nous inonde dans notre voiture, elle jaillit jusque sur nous en plaques noires ; une odeur infecte nous enveloppe depuis assez longtemps déjà ; tout cela indique que nous sommes dans un vilain quartier, le dernier sans doute, avant d’arriver dans les prairies de Bethnal-Green. Il me semble que nous tournons sur nous-mêmes, et de temps en temps notre cocher ralentit sa marche, comme s’il ne savait plus où il est. Tout à coup, il s’arrête enfin brusquement, et notre judas s’ouvre.
Читать дальше