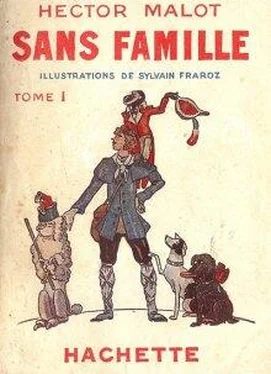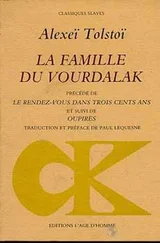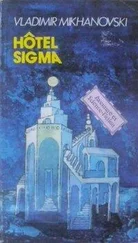Mais il n’y avait pas d’auberge dans ce village, et personne ne voulut recevoir une sorte de mendiant qui traînait avec lui un enfant et trois chiens aussi crottés les uns que les autres.
— On ne loge pas ici, nous disait-on.
Et l’on nous fermait la porte au nez. Nous allions d’une maison à l’autre, sans qu’aucune s’ouvrît.
Faudrait-il donc faire encore, et sans repos, les quatre lieues qui nous séparaient d’Ussel ? La nuit arrivait, la pluie nous glaçait, et pour moi je sentais mes jambes raides comme des barres de bois.
Ah ! la maison de mère Barberin !
Enfin un paysan plus charitable que ses voisins, voulut bien nous ouvrir la porte d’une grange. Mais avant de nous laisser entrer il nous imposa la condition de ne pas avoir de lumière.
— Donnez-moi vos allumettes, dit-il à Vitalis, je vous les rendrai demain, quand vous partirez.
Au moins nous avions un toit pour nous abriter et la pluie ne nous tombait plus sur le corps.
Vitalis était un homme de précaution qui ne se mettait pas en route sans provisions. Dans le sac de soldat qu’il portait sur ses épaules se trouvait une grosse miche de pain qu’il partagea en quatre morceaux.
Alors je vis pour la première fois comment il maintenait l’obéissance et la discipline dans sa troupe.
Pendant que nous errions de porte en porte, cherchant notre gîte, Zerbino était entré dans une maison, et il en était ressorti aussitôt rapidement, portant une croûte dans sa gueule. Vitalis n’avait dit qu’un mot :
— À ce soir, Zerbino.
Je ne pensais plus à ce vol, quand je vis, au moment où notre maître coupait la miche, Zerbino prendre une mine basse.
Nous étions assis sur deux bottes de fougère, Vitalis et moi, à côté l’un de l’autre, Joli-Cœur entre nous deux ; les trois chiens étaient alignés devant nous, Capi et Dolce les yeux attachés sur ceux de leur maître, Zerbino le nez incliné en avant, les oreilles rasées.
— Que le voleur sorte des rangs, dit Vitalis d’une voix de commandement, et qu’il aille dans un coin ; il se couchera sans souper.
Aussitôt Zerbino quitta sa place et marchant en rampant, il alla se cacher dans le coin que la main de son maître lui avait indiqué ; il se fourra tout entier sous un amas de fougère, et nous ne le vîmes plus, mais nous l’entendions souffler plaintivement avec des petits cris étouffés.
Cette exécution accomplie, Vitalis me tendit mon pain, et tout en mangeant le sien, il partagea par petites bouchées entre Joli-Cœur, Capi et Dolce les morceaux qui leur étaient destinés.
Pendant les derniers mois que j’avais vécu auprès de mère Barberin, je n’avais certes pas été gâté ; cependant le changement me parut rude.
Ah ! comme la soupe chaude que mère Barberin nous faisait tous les soirs, m’eût paru bonne, même sans beurre !
Comme le coin du feu m’eût été agréable ; comme je me serais glissé avec bonheur dans mes draps, en remontant les couvertures jusqu’à mon nez !
Mais, hélas ! il ne pouvait être question ni de draps, ni de couverture, et nous devions nous trouver encore bien heureux d’avoir un lit de fougère.
Brisé par la fatigue, les pieds écorchés par mes sabots, je tremblais de froid dans mes vêtements mouillés.
La nuit était venue tout à fait, mais je ne pensais pas à dormir.
— Tes dents claquent, dit Vitalis ; tu as froid ?
— Un peu.
Je l’entendis ouvrir son sac.
— Je n’ai pas une garde-robe bien montée, dit-il, mais voici une chemise sèche et un gilet dans lesquels tu pourras t’envelopper après avoir défait tes vêtements mouillés ; puis tu t’enfonceras sous la fougère, tu ne tarderas pas à te réchauffer et à t’endormir.
Cependant, je ne me réchauffai pas aussi vite que Vitalis le croyait ; longtemps je me tournai et me retournai sur mon lit de fougère, trop endolori, trop malheureux pour pouvoir m’endormir.
Est-ce qu’il en serait maintenant tous les jours ainsi ? marcher sans repos sous la pluie, coucher dans une grange, trembler de froid, n’avoir pour souper qu’un morceau de pain sec, personne pour me plaindre, personne à aimer, plus de mère Barberin ?
Comme je réfléchissais tristement, le cœur gros et les yeux pleins de larmes, je sentis un souffle tiède me passer sur le visage.
J’étendis la main en avant et je rencontrai le poil laineux de Capi.
Il s’était doucement approché de moi, s’avançant avec précaution sur la fougère, et il me sentait ; il reniflait doucement ; son haleine me courait sur la figure et dans les cheveux.
Que voulait-il ?
Il se coucha bientôt sur la fougère, tout près de moi, et délicatement il se mit à me lécher la main.
Tout ému de cette caresse, je me soulevai à demi et l’embrassai sur son nez froid.
Il poussa un petit cri étouffé, puis, vivement, il mit sa patte dans ma main et ne bougea plus.
Alors j’oubliai fatigue et chagrins ; ma gorge contractée se desserra ; je respirai ; je n’étais plus seul : j’avais un ami.
Le lendemain nous nous mîmes en route de bonne heure.
Plus de pluie ; un ciel bleu, et, grâce au vent sec qui avait soufflé pendant la nuit, peu de boue. Les oiseaux chantaient joyeusement dans les buissons du chemin et les chiens gambadaient autour de nous. De temps en temps, Capi se dressait sur ses pattes de derrière et il me lançait au visage deux ou trois aboiements dont je comprenais très-bien la signification.
— Du courage, du courage ! disaient-ils.
Car c’était un chien fort intelligent, qui savait tout comprendre et toujours se faire comprendre. Bien souvent j’ai entendu dire qu’il ne lui manquait que la parole. Mais je n’ai jamais pensé ainsi. Dans sa queue seule il y avait plus d’esprit et d’éloquence que dans la langue ou dans les yeux de bien des gens. En tout cas la parole n’a jamais été utile entre lui et moi ; du premier jour nous nous sommes tout de suite compris.
N’étant jamais sorti de mon village, j’étais curieux de voir une ville.
Mais je dois avouer qu’Ussel ne m’éblouit point. Ses vieilles maisons à tourelles, qui font sans doute le bonheur des archéologues, me laissèrent tout à fait indifférent.
Il est vrai de dire que dans ces maisons ce que je cherchais ce n’était point le pittoresque.
Une idée emplissait ma tête et obscurcissait mes yeux, ou tout au moins ne leur permettait de voir qu’une seule chose : une boutique de cordonnier.
Mes souliers, les souliers promis par Vitalis, l’heure était venue de les chausser.
Où était la bienheureuse boutique qui allait me les fournir ?
C’était cette boutique que je cherchais : le reste, tourelles, ogives, colonnes n’avait aucun intérêt pour moi.
Aussi le seul souvenir qui me reste d’Ussel est-il celui d’une boutique sombre et enfumée située auprès des halles. Il y avait en étalage devant sa devanture des vieux fusils, un habit galonné sur les coutures avec des épaulettes en argent, beaucoup de lampes, et dans des corbeilles de la ferraille, surtout des cadenas et des clefs rouillées.
Il fallait descendre trois marches pour entrer, et alors on se trouvait dans une grande salle, où la lumière du soleil n’avait assurément jamais pénétré depuis que le toit avait été posé sur la maison.
Comment une aussi belle chose que des souliers pouvait-elle se vendre dans un endroit aussi affreux !
Cependant Vitalis savait ce qu’il faisait en venant dans cette boutique, et bientôt j’eus le bonheur de chausser mes pieds dans des souliers ferrés qui pesaient bien dix fois le poids de mes sabots.
La générosité de mon maître ne s’arrêta pas là ; après les souliers, il m’acheta une veste de velours bleu, un pantalon de laine et un chapeau de feutre ; enfin tout ce qu’il m’avait promis.
Читать дальше