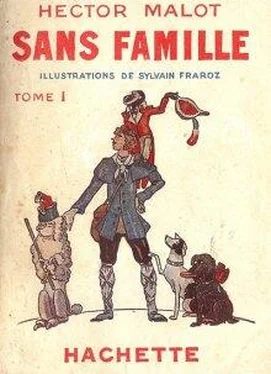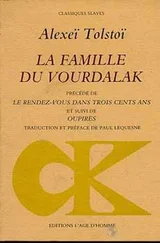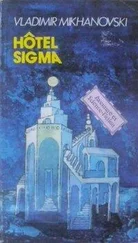Il fallut suivre Vitalis.
Au bout de quelques pas, je tournai la tête.
Nous avions dépassé la crête de la montagne, et je ne vis plus ni notre vallée, ni notre maison ; tout au loin seulement des collines bleuâtres semblaient remonter jusqu’au ciel : mes yeux se perdirent dans des espaces sans bornes.
Pour acheter les enfants quarante francs, il n’en résulte pas nécessairement qu’on est un ogre et qu’on fait provision de chair fraîche afin de la manger.
Vitalis ne voulait pas me manger, et, par une exception rare chez les acheteurs d’enfants, ce n’était pas un méchant homme.
J’en eus bientôt la preuve.
C’était sur la crête même de la montagne qui sépare le bassin de la Loire de celui de la Dordogne qu’il m’avait repris le poignet, et, presque aussitôt nous avions commencé à descendre sur le versant exposé au Midi.
Après avoir marché environ un quart d’heure, il m’abandonna le bras.
— Maintenant, dit-il, chemine doucement près de moi ; mais n’oublie pas que, si tu voulais te sauver, Capi et Zerbino t’auraient bien vite rejoint ; ils ont les dents pointues.
Me sauver, je sentais que c’était maintenant impossible et que par suite il était inutile de le tenter.
Je poussai un soupir.
— Tu as le cœur gros, continua Vitalis, je comprends cela et ne t’en veux pas. Tu peux pleurer librement si tu en as envie. Seulement tâche de sentir que ce n’est pas pour ton malheur que je t’emmène. Que serais-tu devenu ? Tu aurais été très-probablement à l’hospice. Les gens qui t’ont élevé ne sont pas tes père et mère. Ta maman, comme tu dis, a été bonne pour toi et tu l’aimes, tu es désolé de la quitter, tout cela c’est bien ; mais fais réflexion qu’elle n’aurait pas pu te garder malgré son mari. Ce mari, de son côté, n’est peut-être pas aussi dur que tu crois. Il n’a pas de quoi vivre ; il est estropié ; il ne peut plus travailler, et il calcule qu’il ne peut pas se laisser mourir de faim pour te nourrir. Comprends aujourd’hui, mon garçon, que la vie est trop souvent une bataille dans laquelle on ne fait pas ce qu’on veut.
Sans doute c’étaient là des paroles de sagesse, ou tout au moins d’expérience. Mais il y avait un fait qui en ce moment, criait plus fort que toutes les paroles, — la séparation.
Je ne verrais plus celle qui m’avait élevé, qui m’avait caressé, celle que j’aimais, — ma mère.
Et cette pensée me serrait à la gorge, m’étouffait.
Cependant je marchais près de Vitalis, cherchant à me répéter ce qu’il venait de me dire.
Sans doute, tout cela était vrai ; Barberin n’était pas mon père, et il n’y avait pas de raisons qui l’obligeassent à souffrir la misère pour moi : il avait bien voulu me recueillir et m’élever ; si maintenant il me renvoyait, c’était parce qu’il ne pouvait plus me garder. Ce n’était pas de la présente journée que je devais me souvenir en pensant à lui, mais des années passées dans sa maison.
— Réfléchis à ce que je t’ai dit, petit, répétait de temps en temps Vitalis, tu ne seras pas trop malheureux avec moi.
Après avoir descendu une pente assez rapide, nous étions arrivés sur une vaste lande qui s’étendait plate et monotone à perte de vue. Pas de maisons, pas d’arbres. Un plateau couvert de bruyères rousses, avec çà et là des grandes nappes de genêts rabougris qui ondoyaient sous le souffle du vent.
— Tu vois, me dit Vitalis étendant la main sur la lande, qu’il serait inutile de chercher à te sauver, tu serais tout de suite repris par Capi et Zerbino.
Me sauver ! Je n’y pensais plus. Où aller d’ailleurs ? Chez qui ?
Après tout, ce grand vieillard à barbe blanche n’était peut-être pas aussi terrible que je l’avais cru d’abord ; et s’il était mon maître, peut-être ne serait-il pas un maître impitoyable.
Longtemps nous cheminâmes au milieu de tristes solitudes, ne quittant les landes que pour trouver des champs de brandes, et n’apercevant tout autour de nous, aussi loin que le regard s’étendait, que quelques collines arrondies aux sommets stériles.
Je m’étais fait une tout autre idée des voyages, et quand parfois dans mes rêveries enfantines j’avais quitté mon village, ç’avait été pour de belles contrées qui ne ressemblaient en rien à celle que la réalité me montrait.
C’était la première fois que je faisais une pareille marche d’une seule traite et sans me reposer.
Mon maître s’avançait d’un grand pas régulier, portant Joli Cœur sur son épaule ou sur son sac, et autour de lui les chiens trottinaient sans s’écarter.
De temps en temps Vitalis leur disait un mot d’amitié, tantôt en français, tantôt dans une langue que je ne connaissais pas.
Ni lui, ni eux ne paraissaient penser à la fatigue. Mais il n’en était pas de même pour moi. J’étais épuisé. La lassitude physique s’ajoutant au trouble moral, m’avait mis à bout de forces.
Je traînais les jambes et j’avais la plus grande peine à suivre mon maître. Cependant je n’osais pas demander à m’arrêter.
— Ce sont tes sabots qui te fatiguent, me dit-il ; à Ussel je t’achèterai des souliers.
Ce mot me rendit le courage.
En effet, des souliers avaient toujours été ce que j’avais le plus ardemment désiré. Le fils du maire et aussi le fils de l’aubergiste avaient des souliers, de sorte que le dimanche, quand ils arrivaient à la messe, ils glissaient sur les dalles sonores, tandis que nous autres paysans, avec nos sabots, nous faisions un tapage assourdissant.
— Ussel, c’est encore loin ?
— Voilà un cri du cœur, dit Vitalis en riant ; tu as donc bien envie d’avoir des souliers, mon garçon ? Eh bien ! je t’en promets avec des clous dessous. Et je te promets aussi une culotte de velours, une veste et un chapeau. Cela va sécher tes larmes, j’espère, et te donner des jambes pour faire les six lieues qui nous restent.
Des souliers avec des clous dessous ! Je fus ébloui. C’était déjà une chose prodigieuse pour moi que ces souliers, mais quand j’entendis parler de clous, j’oubliai mon chagrin.
Non, bien certainement, mon maître n’était pas un méchant homme.
Est-ce qu’un méchant se serait aperçu que mes sabots me fatiguaient ?
Des souliers, des souliers à clous ! une culotte de velours ! une veste ! un chapeau !
Ah ! si mère Barberin me voyait, comme elle serait contente, comme elle serait fière de moi !
Quel malheur qu’Ussel fut encore si loin !
Malgré les souliers et la culotte de velours qui étaient au bout des six lieues qui nous restaient à faire, il me sembla que je ne pourrais pas marcher si loin.
Heureusement le temps vint à mon aide.
Le ciel, qui avait été bleu depuis notre départ, s’emplit peu à peu de nuages gris, et bientôt il se mit à tomber une pluie fine qui ne cessa plus.
Avec sa peau de mouton, Vitalis était assez bien protégé, et il pouvait abriter Joli-Cœur qui, à la première goutte de pluie, était promptement rentré dans sa cachette. Mais les chiens et moi, qui n’avions rien pour nous couvrir, nous n’avions pas tardé à être mouillés jusqu’à la peau ; encore les chiens pouvaient-ils de temps en temps se secouer, tandis que ce moyen naturel n’étant pas fait pour moi, je devais marcher sous un poids qui m’écrasait et me glaçait.
— T’enrhumes-tu facilement ? me demanda mon maître.
— Je ne sais pas ; je ne me rappelle pas avoir été jamais enrhumé.
— Bien cela, bien ; décidément il y a du bon en toi. Mais je ne veux pas t’exposer inutilement, nous n’irons pas plus loin aujourd’hui. Voilà un village là-bas, nous y coucherons.
Читать дальше