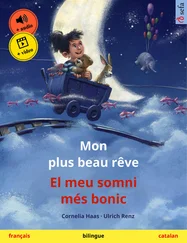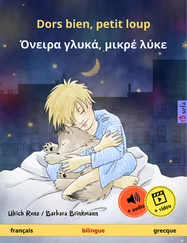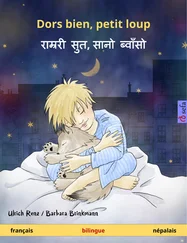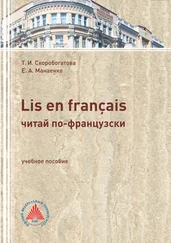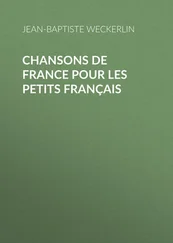La liaison obligatoire chez les apprenant.e.s en lecture.
Concernant la liaison fréquente, les taux de réalisation s’avèrent assez élevés en lecture et beaucoup plus faibles en parole spontanée ( cf. tableau 76). À l’instar des francophones natifs, les apprenant.e.s avancés possèdent donc une certaine compétence socio-stylistique ( cf. tableau 3). À y regarder de plus près, on constate toutefois quelques différences. Ainsi, après la forme verbale impersonnelle c’est , les taux varient-ils entre 43 % et 78 % chez les apprenant.e.s, mais seulement autour de 28 % et 30 % chez les natifs. On peut supposer que cela est dû au fait que la liaison a pendant longtemps été considérée comme obligatoire dans ce contexte ( cf. Delattre 1947 dans la section 2.1.2) et a donc probablement été enseignée comme telle. Après la conjonction quand , les taux reportés par Thomas 2002/2004 et Howard 2005 sont en revanche beaucoup plus faibles que chez les natifs.
| Contexte |
Mastromonaco 1999 |
Thomas 2002, 2004 |
Howard 2005 |
Pustka 2015 |
Detey /Kawaguchi/Kondo 2015 |
| Parole spontanée |
lecture |
Parole spontanée + lecture |
Parole spontanée |
Parole spontanée |
lecture |
| c’est + |
78 % (7/9) |
98 % (48/49) |
66 % (n = 1297) |
--- |
43 % (n = 23) |
--- |
| est + |
--- |
--- |
38 % (n = 16) |
80 %–71,4 % |
| CONJ mono + |
TOUS |
29 % (2/7)7 |
--- |
--- |
0 %–37 % |
puis + mais : 0 % |
--- |
| quand |
--- |
--- |
41 % (n = 64) |
0 %–17 % |
80 % |
--- |
Tab. 7 :
La liaison fréquente chez les apprenant.e.s (parole spontanée et lecture).
En conclusion, les études précédentes montrent que les liaisons obligatoires ne semblent pas poser de problèmes aux apprenant.e.s avancé.e.s mais aux apprenant.e.s moins avancé.e.s. Cependant, même les apprenant.e.s avancé.e.s rencontrent des difficultés face aux liaisons fréquentes et tendent à en réaliser moins que ce qui est relevé chez les locuteurs natifs, et ce notamment en parole spontanée.
Afin d’analyser le comportement de la liaison et du schwa ainsi que les trajectoires d’apprentissage chez les apprenant.e.s de FLE moins avancé.e.s, et ce notamment chez des élèves, largement négligé.e.s jusqu’à présent, le projet de recherche Pro 2F ( cf. section 1) fournit un corpus de grande taille. Celui-ci repose sur la méthodologie du programme de recherche international (Inter-)Phonologie du Français Contemporain (I)PFC ( cf. Durand/Laks/Lyche 2002, www.projet-pfc.net; Detey/Kawaguchi 2008, Racine et al. 2012, http://cblle.tufs.ac.jp/ipfc/). Le projet de recherche Pro 2F reprend cette méthodologie en collectant pour la première fois des données de mineurs qui apprennent le français en contexte scolaire. Il est donc représentatif de la majorité des apprenant.e.s, d’où son impact pour la didactique du FLE.
145 élèves autrichiens, âgés de 12 à 18 ans, ont été enregistrés dans le cadre du projet de recherche Pro 2F. Ces élèves sont issus d’un collège-lycée viennois et ont commencé à l’âge de 12 ans à apprendre le français qui est leur deuxième langue étrangère après l’anglais. Ainsi, les participant.e.s sont des apprenant.e.s débutant.e.s ou intermédiaires se situant selon les programmes scolaires officiellement entre les niveaux A1 et B1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de l’Europe 2001). Tous apprennent le français en prenant appui sur les séries de manuels scolaires autrichiens Bien fait ! (Luner et al. 2014) et Parcours plus (Wlasak-Feik et al. 2016). Il faut souligner ici que ces manuels ne traitent de la prononciation que de manière très marginale contrairement aux manuels utilisés en Allemagne ( cf. section 2.1). Ni la liaison ni le schwa n’y sont mentionnés.
Dans le cadre du projet de recherche Pro 2F, les enregistrements des apprenant.e.s autrichien.ne.s comprennent sept tâches :
la lecture de la liste de mots PFC
la lecture d’une liste de mots spécifique basée sur le projet IPFC et complétée par des contextes pour le schwa et la liaison
la répétition de ces contextes pour le schwa et la liaison sur la base d’un enregistrement d’un présentateur de radio parisien
la lecture du texte PFC
la lecture d’un texte supplémentaire basé sur le manuel scolaire des élèves (niveau A1)
la lecture d’un texte en allemand (« Nordwind und Sonne » ‘La bise et le soleil’) et
un entretien mené par une Française originaire de la France septentrionale.
L’entretien a systématiquement été adapté au niveau des élèves (A1–A2 ou B1) et se basait, d’une part, sur le protocole d’entretien du projet IPFC (questions sur les voyages et le rapport avec la langue française) et, d’autre part, sur les thèmes abordés dans le manuel scolaire utilisé (école, loisirs, famille, etc.). Étant donné que le texte PFC est d’un niveau grammatical et lexical assez élevé, nous avons laissé le choix aux élèves de première année de le lire ou non. En plus des tâches énumérées ci-dessus, les élèves ont rempli un questionnaire socio-démographique (en allemand), basé sur les questionnaires des projets PFC et IPFC. La méthodologie adoptée a auparavant été vérifiée sous l’angle psychologique et juridique par l’inspection scolaire de la ville de Vienne. Les 145 élèves participants ainsi que leurs parents ont signé un consentement de participation. Le travail de terrain s’est déroulé entre novembre 2017 et avril 2018. Les enregistrements se sont faits avec un enregistreur ZOOM H4n (44.1kHz/16 Bit, mono).
3.3 Transcription et codage
Le corpus Pro 2F contient au total 108 heures et 45 minutes de parole enregistrée. Ces enregistrements ont été transcrits orthographiquement sous PRAAT (Boersma/Weenink 2020, www.fon.hum.uva.nl/praat/) suivant les conventions de transcription du projet PFC adaptées aux élèves autrichiens.
En suivant la procédure du projet PFC, nous dupliquons dans PRAAT la tire de transcription pour y intégrer un codage (alpha-)numérique. Les systèmes de codage sont également basés sur ceux du programme PFC, mais adaptés aux besoins du projet Pro 2F ( cf. Kamerhuber/Horvath/Pustka 2020 pour une première version du codage schwa et Heiszenberger et al. 2020 pour le codage liaison). Comme ces changements n’affectent que des variantes supplémentaires observées chez les apprenant.e.s qui ne seront pas traitées par la suite (p. ex. réduction vocalique dans intéressant [ɛ̃təʁɛsɑ̃]/[ɛ̃tʁɛsɑ̃] pour [ɛ̃teʁɛsɑ̃]), nous ne rentrons pas ici dans ces détails méthodologiques.
Dans l’analyse qui suit, nous nous limitons à la question phonologique de la présence ou de l’absence du segment. Nous faisons donc abstraction de la qualité phonétique du schwa ([ə]/[e]/[ɛ]) et de la liaison (notamment [z]/[s]). Afin de nous concentrer sur les contextes à enseigner, nous écartons ici les cas de rupture du mot suivant, d’alternance codique ainsi que d’erreurs de lecture et de grammaire (où la liaison manque particulièrement souvent).
Читать дальше
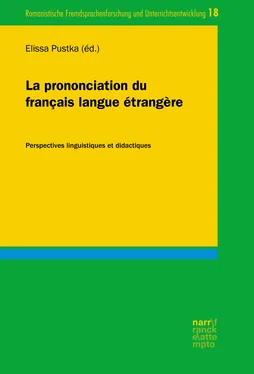
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)