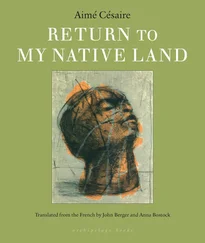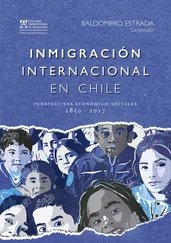Les visites, condoléances et appels téléphoniques commencent. Pere et moi sommes absents. Notre esprit est loin, très loin. Nous nous laissons embrasser et aimer, mais ne ressentons rien. C’est comme si on nous avait retiré tout notre sang. Il ne reste qu’une grande douleur et un cœur qui fait très mal.
C’est samedi. Les magasins sont fermés. Les vitrines sont pleines de roses et de bougies. La commune de Banyoles en est remplie. L’obscurité de la douleur commence à tout envahir. Les rumeurs courent comme un grand nuage noir qui ne cesse de s’étendre. Les amis, les clients, les membres de la famille... tout le monde se réveille dans ce cauchemar. Un jour gris commence pour tous. Banyoles est en deuil. Adrià Roca est mort.
Je n’ai qu’une chose en tête : téléphoner à David, son frère. J’insiste, les heures passent et ce n’est qu’au milieu de la matinée qu’il décroche. Je suis tellement nerveuse que la seule chose qui sort de ma bouche est un cri de douleur : « Adrià est mort, Adrià est mort ! ». Pauvre David ! Il ne sait pas ce qui lui arrive. L’obscurité lui tombe dessus, sur lui et son ami Quim. Ils vivent à Gérone et se mettent tout de suite en route.
Je vois notre douleur reflétée comme dans un miroir sur les visages de nos amis et de nos clients. Ils sont encore bien gravés dans mon cœur. Les membres de l’équipe de Can Pere Roca, les uns à côtés des autres, ne savent comment nous réconforter : certains sont sérieux, d’autres pleurent… Tout est si terrible ! Je ne parviens pas à pleurer. Mes larmes sont restées bloquées à l’intérieur et je me sens comme un bloc de pierre.
On frappe à la porte. Ce sont mes meilleures amies et mes amies d’enfance : Montse, Sussi et Anna. C’est la deuxième fois qu’elles franchissent le pas de la porte pour m’embrasser et me transmettre tout leur amour. La première fois, c’était lors de la mort de ma mère ; j’avais à peine 14 ans. Les revoici face à moi. Je me sens transportée un instant dans le temps. Mes amies sont là, avec leur douleur, la mienne, reflétée sur leur visage. Inutile de parler. Nos regards et nos pleurs disent tout. Notre amour va bien au-delà. Et dans ce contexte, je me demande :
« Pourquoi c’est toujours à moi que ça arrive ? ».
Les visites ne cessent de défiler. La maison ne désemplit pas. La porte reste ouverte. Les gens vont et viennent, les uns après les autres. Ce jour-là, je ne sais pas combien de personnes sont passées par la maison, mais ce que je sais, c’est que les pleurs et les étreintes n’en finissaient pas.
Les jours suivants sont synonymes d’obscurité totale. Pere, David et Quim sont constamment à mes côtés. Bien que leur compagnie et leur amour me servent de coussin, je ne suis pas là. Je n’ai qu’une chose en tête : la douleur d’avoir perdu Adrià, mon fils.

Adrià était une personne comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts. Bien qu’il me manque, maintenant, cette nostalgie s’est adoucie et me permet de parler naturellement de lui en tant que fils, frère ou ami sans tomber dans l’erreur de l’idéaliser ou de le considérer comme un être supérieur. Pour nous, sa famille, c’était Adrià, mais pour ses amis, c’était Rocky, un nom avec lequel il avait été baptisé à la crèche et qui lui allait comme un gant.
Physiquement, il était plutôt normal : pas très grand, stature moyenne, ni gros ni mince. La première chose qui attirait l’attention chez lui, c’étaient certainement ses longs cheveux bruns, plutôt ondulés, toujours décoiffés, qu’il cachait sous ses chères casquettes. Il avait une expression douce et souriante, des yeux vert olive très clairs et brillants.
Son nez, marque incontestable de la famille, était un autre de ses signes distinctifs. C’est ce qu’il avait toujours entendu dire depuis tout petit : « Tu as un nez de patate comme tous les membres de la famille Pericus ». Celui qui en profitait le plus, c’était son frère David, qui adorait le faire enrager. Adrià lui disait : « Et toi, alors ? Meuh… Espèce de vache, va. Toi aussi tu as un gros pif ! ». Et la guerre commençait. Jusqu’à ce que l’un des deux sorte de ses gonds et m’oblige à intervenir en faveur d’Adrià : « David, arrête ! Tu ne vois pas que ton frère est plus petit que toi ? ». Petit à petit, la situation se calmait et redevenait normale. En fait, c’était une manière de dire « je t’aime ».
Quant à ses lèvres, je me suis toujours dit qu’elles lui donnaient beaucoup de charme. Charnues et câlines, il les avait héritées de mon père, ce qui me rendait très orgueilleuse. Je me souviens aussi de ses mains qui, palpeuses et petites, douces et délicates, transmettaient beaucoup de tendresse et de chaleur humaine. Je me rappelle un jour où j’étais triste et pleurais beaucoup. Il était assis à côté de moi, en silence. Il n’a posé aucune question. Il m’a juste pris la main. À travers ce silence et sa présence, il me faisait part de ses sentiments. Il me disait : « Maman, je t’aime. Je suis là, avec toi. Je t’aiderai, tu n’es pas seule ». En me rappelant comment il était, voilà que je me remets à pleurer.
Un autre trait, non physique, qui me rappelle toujours Adrià, c’est son odeur ; l’odeur qu’il dégageait quand il rentrait à la maison après avoir passé l’après-midi au local avec ses amis. Je l’embrassais et je lui disais : « Qui c’est qui t’aime tant ? ». D’un sourire moqueur, il me répondait : « Nina ! » –Nina était sa petite chienne. Je continuais de l’étreindre et lui disais « Je t’aime » en inspirant cette odeur de feu de bois. Ce souvenir, le fait de lui avoir dit tant de fois ces mots magiques de manière aussi vibrante, est resté gravé dans mon cœur et m’a souvent aidée à poursuivre ma route.
Adrià était un garçon spécial et cette manière d’être contribuait à ce que notre relation fût également particulière. C’était un garçon jovial et audacieux, plutôt fainéant et paresseux pendant l’adolescence ; des années au cours desquelles je m’énervais souvent et où son bon caractère, sa tranquillité, son silence, sa discrétion et sa politesse lui permettaient de finir par faire ce qu’il voulait.
À l’école, ce n’était pas un bon étudiant. Il nous a beaucoup tracassés parce qu’il n’y avait pas moyen qu’il prenne goût aux études. Pour lui, l’école était une perte de temps et il n’était pas du tout motivé. Ces années furent très dures pour tout le monde, parce que d’un côté c’était un garçon intelligent, très capable, mais d’un autre côté, nous voyions qu’il se sentait perdu, qu’il ne trouvait pas sa voie, qu’il grandissait et qu’il devenait de plus en plus je-m’en-foutiste. Au magasin, je ne suis parvenue à le faire travailler que deux petites heures le samedi pour qu’il puisse gagner un peu d’argent de poche. À part cela, il ne faisait que paresser, rigoler et manger. Comme il allait habituellement travailler le samedi de 15 à 17 heures, pour lui, c’était l’heure du goûter, l’heure de prendre un Coca-Cola et un sandwich. Son travail consistait à emballer des produits gourmets sous vide comme le fromage, les charcuteries et le pâté. Il adorait ce dernier : Adrià était le roi du Coca-Cola et du pâté. De temps en temps, l’un ou l’autre morceau finissait dans son ventre. Et toujours avec son air fainéant et paresseux, donnant l’impression qu’une jambe devait demander la permission à l’autre pour marcher.
Au cours des dernières années, il aimait les vêtements de style rappeur : pantalons descendus qui laissaient apparaître le caleçon, sweat-shirts épais portant des lettres bi-zarres, et sa casquette, inséparable. Cela me fait penser à une anecdote. Un jour, nous étions allés déjeuner avec tout le personnel de Can Pere Roca à Mieres, un village de la région. Après le repas, au moment de partir, Adrià ne parvenait pas à faire démarrer sa moto et il commença à la pousser en courant à côté. Plus il courait, plus son pantalon descendait. En voyant la scène, nous nous sommes tous mis à rire comme des possédés. Quelle rigolade …
Читать дальше