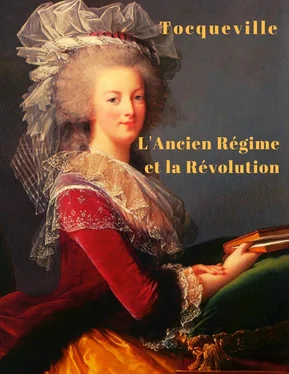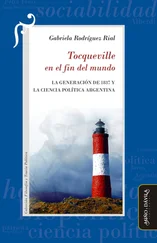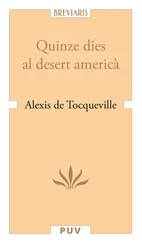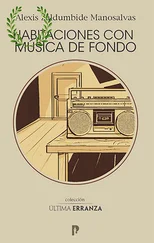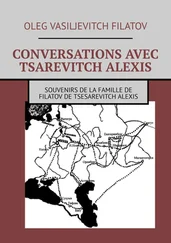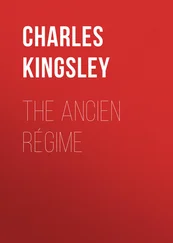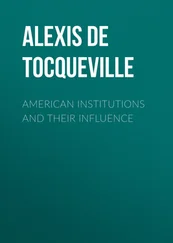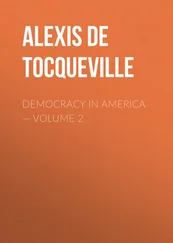Dans l'ancienne société féodale, si le seigneur possédait de grands droits, il avait aussi de grandes charges. C'était à lui à secourir les indigents dans l'intérieur de ses domaines. Nous trouvons une dernière trace de cette vieille législation de l'Europe dans le code prussien de 1795, où il est dit: «Le seigneur doit veiller à ce que les paysans pauvres reçoivent l'éducation. Il doit, autant que possible, procurer des moyens de vivre à ceux de ses vassaux qui n'ont point de terre. Si quelques-uns d'entre eux tombent dans l'indigence, il est obligé de venir à leur secours.»
Aucune loi semblable n'existait plus en France depuis longtemps. Comme on avait ôté au seigneur ses anciens pouvoirs, il s'était soustrait à ses anciennes obligations. Aucune autorité locale, aucun conseil, aucune association provinciale ou paroissiale n'avait pris sa place. Nul n'était plus obligé par la loi à s'occuper des pauvres des campagnes; le gouvernement central avait entrepris hardiment de pourvoir seul à leurs besoins.
Tous les ans le conseil assignait à chaque province, sur le produit général des taxes, certains fonds que l'intendant distribuait en secours dans les paroisses. C'était à lui que devait s'adresser le cultivateur nécessiteux. Dans les temps de disette, c'était l'intendant qui faisait distribuer au peuple du blé ou du riz. Le conseil rendait annuellement des arrêts qui ordonnaient d'établir, dans certains lieux qu'il avait soin d'indiquer lui-même, des ateliers de charité où les paysans les plus pauvres pouvaient travailler moyennant un léger salaire. On doit croire aisément qu'une charité faite de si loin était souvent aveugle ou capricieuse, et toujours très-insuffisante.
Le gouvernement central ne se bornait pas à venir au secours des paysans dans leurs misères; il prétendait leur enseigner l'art de s'enrichir, les y aider et les y forcer au besoin. Dans ce but il faisait distribuer de temps en temps par ses intendants et ses subdélégués de petits écrits sur l'art agricole, fondait des sociétés d'agriculture, promettait des primes, entretenait à grands frais des pépinières dont il distribuait les produits. Il semble qu'il eût été plus efficace d'alléger le poids et de diminuer l'inégalité des charges qui opprimaient alors l'agriculture; mais c'est ce dont on ne voit pas qu'il se soit avisé jamais.
Quelquefois le conseil entendait obliger les particuliers à prospérer, quoi qu'ils en eussent. Les arrêts qui contraignent les artisans à se servir de certaines méthodes et à fabriquer de certains produits sont innombrables; et comme les intendants ne suffisaient pas à surveiller l'application de toutes ces règles, il existait des inspecteurs généraux de l'industrie qui parcouraient les provinces pour y tenir la main.
Il y a des arrêts du conseil qui prohibent certaines cultures dans des terres que ce conseil y déclare peu propres. On en trouve où il ordonne d'arracher des vignes plantées, suivant lui, dans un mauvais sol, tant le gouvernement était déjà passé du rôle de souverain à celui de tuteur.
Comment ce qu'on appelle aujourd'hui la tutelle administrative est une institution de l'ancien régime.
En France, la liberté municipale a survécu à la féodalité. Lorsque déjà les seigneurs n'administraient plus les campagnes, les villes conservaient encore le droit de se gouverner. On en rencontre, jusque vers la fin du dix-septième siècle, qui continuent à former comme de petites républiques démocratiques, où les magistrats sont librement élus par tout le peuple et responsables envers lui, où la vie municipale est publique et active, où la cité se montre encore fière de ses droits et très-jalouse de son indépendance.
Les élections ne furent abolies généralement pour la première fois qu'en 1692. Les fonctions municipales furent alors mises en offices, c'est-à-dire que le roi vendit, dans chaque ville, à quelques habitants, le droit de gouverner perpétuellement tous les autres.
C'était sacrifier, avec la liberté des villes, leur bien-être; car si la mise en office des fonctions publiques a eu souvent d'utiles effets quand il s'est agi des tribunaux, parce que la condition première d'une bonne justice est l'indépendance complète du juge, elle n'a jamais manqué d'être très-funeste toutes les fois qu'il s'est agi de l'administration proprement dite, où on a surtout besoin de rencontrer la responsabilité, la subordination et le zèle. Le gouvernement de l'ancienne monarchie ne s'y trompait pas: il avait grand soin de ne point user pour lui-même du régime qu'il imposait aux villes, et il se gardait bien de mettre en offices les fonctions de subdélégués et d'intendants.
Et ce qui est bien digne de tous les mépris de l'histoire, cette grande révolution fut accomplie sans aucune vue politique. Louis XI avait restreint les libertés municipales parce que leur caractère démocratique lui faisait peur; Louis XIV les détruisit sans les craindre. Ce qui le prouve, c'est qu'il les rendit à toutes les villes qui purent les racheter. En réalité, il voulait moins les abolir qu'en trafiquer, et, s'il les abolit en effet, ce fut pour ainsi dire sans y penser, par pur expédient de finances; et, chose étrange, le même jeu se continue pendant quatre-vingts ans. Sept fois, durant cet espace, on vend aux villes le droit d'élire leurs magistrats, et, quand elles en ont de nouveau goûté la douceur, on le leur reprend pour le leur revendre. Le motif de la mesure est toujours le même, et souvent on l'avoue. «Les nécessités de nos finances,» est-il dit dans le préambule de l'édit de 1722, «nous obligent à chercher les moyens les plus sûrs de les soulager.» Le moyen était sûr, mais ruineux pour ceux sur qui tombait cet étrange impôt. «Je suis frappé de l'énormité des finances qui ont été payées dans tous les temps pour racheter les offices municipaux,» écrit un intendant au contrôleur général en 1764. «Le montant de cette finance employé en ouvrages utiles aurait tourné au profit de la ville, qui, au contraire, n'a senti que le poids de l'autorité et des priviléges de ces offices.» Je n'aperçois pas de trait plus honteux dans toute la physionomie de l'ancien régime.
Il semble difficile de dire aujourd'hui précisément comment se gouvernaient les villes au dix-huitième siècle; car, indépendamment de ce que l'origine des pouvoirs municipaux change sans cesse, comme il vient d'être dit, chaque ville conserve encore quelques lambeaux de son ancienne constitution et a des usages propres. Il n'y a peut-être pas deux villes en France où tout se ressemble absolument; mais c'est là une diversité trompeuse, qui cache la similitude.
En 1764, le gouvernement entreprit de faire une loi générale sur l'administration des villes. Il se fit envoyer par ses intendants des mémoires sur la manière dont les choses se passaient alors dans chacune d'elles. J'ai retrouvé une partie de cette enquête, et j'ai achevé de me convaincre en la lisant que les affaires municipales étaient conduites de la même manière à peu près partout. Les différences ne sont plus que superficielles et apparentes; le fond est partout le même.
Le plus souvent le gouvernement des villes est confié à deux assemblées. Toutes les grandes villes sont dans ce cas et la plupart des petites.
La première assemblée est composée d'officiers municipaux, plus ou moins nombreux suivant les lieux. C'est le pouvoir exécutif de la commune, le corps de ville , comme on disait alors. Ses membres exercent un pouvoir temporaire et sont élus, quand le roi a établi l'élection ou que la ville a pu racheter les offices. Ils remplissent leur charge à perpétuité moyennant finance, lorsque le roi a rétabli les offices et a réussi à les vendre, ce qui n'arrive pas toujours; car cette sorte de marchandise s'avilit de plus en plus à mesure que l'autorité municipale se subordonne davantage au pouvoir central. Dans tous les cas ces officiers municipaux ne reçoivent pas de salaire, mais ils ont toujours des exemptions d'impôts et des priviléges. Point d'ordre hiérarchique parmi eux; l'administration est collective. On ne voit pas de magistrat qui la dirige particulièrement et en réponde. Le maire est le président du corps de la ville, non l'administrateur de la cité.
Читать дальше