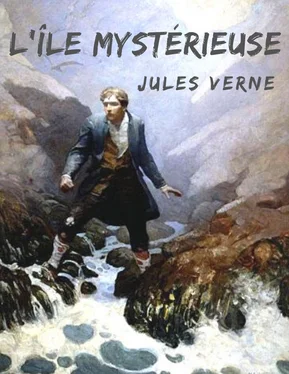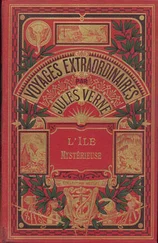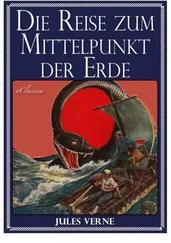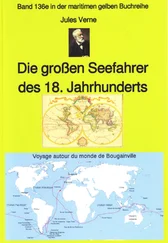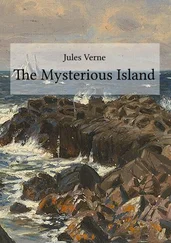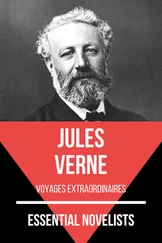Oui ! la terre était là. Là, le salut, provisoirement assuré, du moins. Entre l’îlot et la côte, séparés par un canal large d’un demi-mille, un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit.
Cependant, un des naufragés, ne consultant que son cœur, se précipita aussitôt dans le courant, sans prendre l’avis de ses compagnons, sans même dire un seul mot. C’était Nab. Il avait hâte d’être sur cette côte et de la remonter au nord. Personne n’eût pu le retenir. Pencroff le rappela, mais en vain. Le reporter se disposait à suivre Nab.
Pencroff, allant alors à lui :
« Vous voulez traverser ce canal ? demanda-t-il.
– Oui, répondit Gédéon Spilett.
– Eh bien, attendez, croyez-moi, dit le marin. Nab suffira à porter secours à son maître. Si nous nous engagions dans ce canal, nous risquerions d’être entraînés au large par le courant, qui est d’une violence extrême. Or, si je ne me trompe, c’est un courant de jusant. Voyez, la marée baisse sur le sable. Prenons donc patience, et, à mer basse, il est possible que nous trouvions un passage guéable…
– Vous avez raison, répondit le reporter. Séparons-nous le moins que nous pourrons… »
Pendant ce temps, Nab luttait avec vigueur contre le courant. Il le traversait suivant une direction oblique. On voyait ses noires épaules émerger à chaque coupe. Il dérivait avec une extrême vitesse, mais il gagnait aussi vers la côte. Ce demi-mille qui séparait l’îlot de la terre, il employa plus d’une demi-heure à le franchir, et il n’accosta le rivage qu’à plusieurs milliers de pieds de l’endroit qui faisait face au point d’où il était parti.
Nab prit pied au bas d’une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement ; puis, tout courant, il disparut bientôt derrière une pointe de roches, qui se projetait en mer, à peu près à la hauteur de l’extrémité septentrionale de l’îlot.
Les compagnons de Nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative, et, quand il fut hors de vue, ils reportèrent leurs regards sur cette terre à laquelle ils allaient demander refuge, tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé. C’était un maigre repas, mais, enfin, c’en était un.
La côte opposée formait une vaste baie, terminée, au sud, par une pointe très aiguë, dépourvue de toute végétation et d’un aspect très sauvage. Cette pointe venait se souder au littoral par un dessin assez capricieux et s’arc-boutait à de hautes roches granitiques. Vers le nord, au contraire, la baie, s’évasant, formait une côte plus arrondie, qui courait du sud-ouest au nord-est et finissait par un cap effilé. Entre ces deux points extrêmes, sur lesquels s’appuyait l’arc de la baie, la distance pouvait être de huit milles. À un demi-mille du rivage, l’îlot occupait une étroite bande de mer, et ressemblait à un énorme cétacé, dont il représentait la carcasse très agrandie. Son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille.
Devant l’îlot, le littoral se composait, en premier plan, d’une grève de sable, semée de roches noirâtres, qui, en ce moment, réapparaissaient peu à peu sous la marée descendante. Au deuxième plan, se détachait une sorte de courtine granitique, taillée à pic, couronnée par une capricieuse arête à une hauteur de trois cents pieds au moins. Elle se profilait ainsi sur une longueur de trois milles, et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu’on eût cru taillé de main d’homme. Sur la gauche, au contraire, au-dessus du promontoire, cette espèce de falaise irrégulière, s’égrenant en éclats prismatiques, et faite de roches agglomérées et d’éboulis, s’abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridionale.
Sur le plateau supérieur de la côte, aucun arbre. C’était une table nette, comme celle qui domine Cape-Town, au cap de Bonne-Espérance, mais avec des proportions plus réduites. Du moins, elle apparaissait telle, vue de l’îlot. Toutefois, la verdure ne manquait pas à droite, en arrière du pan coupé. On distinguait facilement la masse confuse de grands arbres, dont l’agglomération se prolongeait au delà des limites du regard. Cette verdure réjouissait l’œil, vivement attristé par les âpres lignes du parement de granit.
Enfin, tout en arrière-plan et au-dessus du plateau, dans la direction du nord-ouest et à une distance de sept milles au moins, resplendissait un sommet blanc, que frappaient les rayons solaires. C’était un chapeau de neiges, coiffant quelque mont éloigné.
On ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent. Mais, à la vue de ces roches convulsionnées qui s’entassaient sur la gauche, un géologue n’eût pas hésité à leur donner une origine volcanique, car elles étaient incontestablement le produit d’un travail plutonien.
Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre, sur laquelle ils allaient peut-être vivre de longues années, sur laquelle ils mourraient même, si elle ne se trouvait pas sur la route des navires !
« Eh bien ! demanda Harbert, que dis-tu, Pencroff ?
– Eh bien, répondit le marin, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout. Nous verrons. Mais voici le jusant qui se fait sentir. Dans trois heures, nous tenterons le passage, et, une fois là, on tâchera de se tirer d’affaire et de retrouver M. Smith ! »
Pencroff ne s’était pas trompé dans ses prévisions. Trois heures plus tard, à mer basse, la plus grande partie des sables, formant le lit du canal, avait découvert. Il ne restait entre l’îlot et la côte qu’un chenal étroit qu’il serait aisé sans doute de franchir.
En effet, vers dix heures, Gédéon Spilett et ses deux compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements, ils les mirent en paquet sur leur tête, et ils s’aventurèrent dans le chenal, dont la profondeur ne dépassait pas cinq pieds. Harbert, pour qui l’eau eût été trop haute, nageait comme un poisson, et il s’en tira à merveille. Tous trois arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé. Là, le soleil les ayant séchés rapidement, ils remirent leurs habits, qu’ils avaient préservés du contact de l’eau, et ils tinrent conseil.
Les lithodomes. – La rivière à son embouchure. – Les « Cheminées ». – Continuation des recherches. – La forêt d’arbres verts. – La provision de combustible. – On attend le reflux. – Du haut de la côte. – Le train de bois. – Le retour au rivage.
Tout d’abord, le reporter dit au marin de l’attendre en cet endroit même, où il le rejoindrait, et, sans perdre un instant, il remonta le littoral, dans la direction qu’avait suivie, quelques heures auparavant, le nègre Nab. Puis il disparut rapidement derrière un angle de la côte, tant il lui tardait d’avoir des nouvelles de l’ingénieur.
Harbert avait voulu l’accompagner.
« Restez, mon garçon, lui avait dit le marin. Nous avons à préparer un campement et à voir s’il est possible de trouver à se mettre sous la dent quelque chose de plus solide que des coquillages. Nos amis auront besoin de se refaire à leur retour. À chacun sa tâche.
– Je suis prêt, Pencroff, répondit Harbert.
– Bon ! reprit le marin, cela ira. Procédons avec méthode. Nous sommes fatigués, nous avons froid, nous avons faim. Il s’agit donc de trouver abri, feu et nourriture. La forêt a du bois, les nids ont des œufs : il reste à chercher la maison.
– Eh bien, répondit Harbert, je chercherai une grotte dans ces roches, et je finirai bien par découvrir quelque trou dans lequel nous pourrons nous fourrer !
Читать дальше