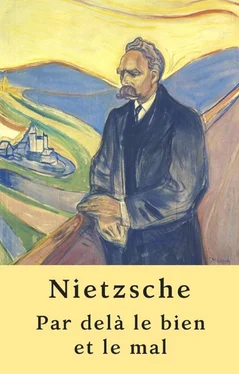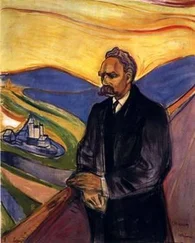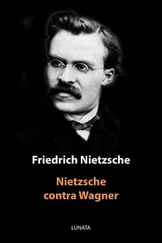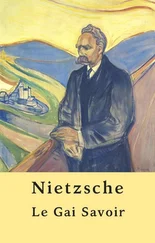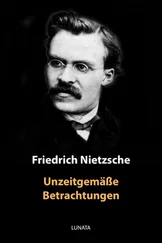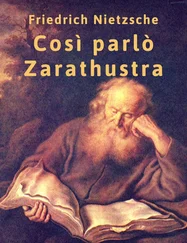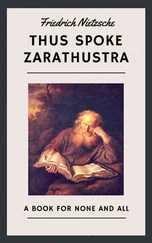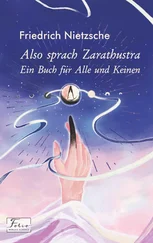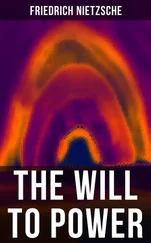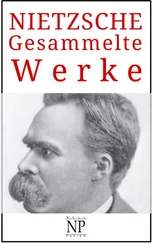29.
C’est affaire d’une toute petite minorité que d’être indépendant, et c’est le privilège des forts. Celui qui s’y essaye, même à bon droit, mais sans y être obligé, prouve par là qu’il est non seulement fort, mais encore audacieux jusqu’à la témérité. Il s’aventure dans un labyrinthe, il multiplie à l’infini les dangers que la vie apporte déjà par elle-même. Et le moindre de ces dangers n’est pas que personne ne voit de ses propres yeux comment il s’égare, où il s’égare, déchiré dans la solitude par quelque souterrain minotaure de la conscience. À supposer qu’un tel homme périsse, ce sera si loin de l’entendement des hommes que ceux-ci ne peuvent ni le sentir, ni le comprendre. Et il n’est pas dans son pouvoir de retourner en arrière ! il ne peut pas non plus revenir à la compassion des hommes !
30.
Nos vues les plus hautes doivent forcément paraître des folies, parfois même des crimes, quand, de façon illicite, elles parviennent aux oreilles de ceux qui n’y sont ni destinés, ni prédestinés. L’exotérisme et l’ésotérisme, — suivant la distinction philosophique en usage chez les Hindous, les Grecs, les Persans et les Musulmans, bref partout où l’on croyait à une hiérarchie et non pas à l’égalité et à des droits égaux — ces deux termes ne se distinguent pas tant parce que l’Exotérique, placé à l’extérieur, voit les choses du dehors, sans les voir, les apprécier, les mesurer et les juger du dedans, mais par le fait qu’il les voit de bas en haut, — tandis que l’Ésotérique les voit de haut en bas. Il y a des hauteurs de l’âme d’où la tragédie même cesse de paraître tragique ; et, toute la misère du monde ramenée à une sorte d’unité, qui donc oserait décider si son aspect forcera nécessairement à la pitié et, par là, à un redoublement de la misère ?… Ce qui sert de nourriture et de réconfort à une espèce d’hommes supérieure doit faire presque l’effet d’un poison sur une espèce très différente et de valeur inférieure. Les vertus de l’homme ordinaire, chez un philosophe, indiqueraient peut-être des vices et des faiblesses. Il serait possible qu’un homme d’espèce supérieure, en admettant qu’il dégénère et aille à sa perte, ne parvînt que par là à posséder les qualités qui obligeraient, dans le monde inférieur où il est descendu, à le vénérer dès lors comme un saint. Il y a des livres qui possèdent, pour l’âme et la santé, une valeur inverse, selon que l’âme inférieure, la force vitale inférieure ou l’âme supérieure et plus puissante s’en servent. Dans le premier cas, ce sont des livres dangereux, corrupteurs, dissolvants, dans le second cas, des appels de hérauts qui invitent les plus braves à revenir à leur propre bravoure. Les livres de tout le monde sont toujours des livres mal odorants : l’odeur des petites gens y demeure attachée. Partout où le peuple mange et boit, même là où il vénère, cela sent mauvais. Il ne faut pas aller à l’église lorsque l’on veut respirer l’air pur. —
31.
Durant les jeunes années on vénère ou on méprise encore, sans cet art de la nuance qui fait le meilleur bénéfice de la vie, et plus tard, il va de soi que l’on paye très cher d’avoir ainsi jugé choses et gens par un oui et un non. Tout est disposé de façon à ce que le goût le plus mauvais, le goût de l’absolu, soit cruellement bafoué et profané jusqu’à ce que l’homme apprenne à mettre un peu d’art dans ses sentiments et que, dans ses tentatives, il donne la préférence à l’artificiel, comme font tous les véritables artistes de la vie. Le penchant à la colère et l’instinct de vénération, qui sont le propre de la jeunesse, semblent n’avoir de repos qu’ils n’aient faussé hommes et choses pour pouvoir s’y exercer. La jeunesse, par elle-même, est déjà quelque chose qui trompe et qui fausse. Plus tard, lorsque la jeune âme, meurtrie par mille désillusions, se trouve enfin pleine de soupçons contre elle-même, encore ardente et sauvage, même dans ses soupçons et ses remords, comme elle se mettra en colère contre elle-même, comme elle se déchirera avec impatience, comme elle se vengera de son long aveuglement, que l’on pourrait croire volontaire, tant elle s’acharne contre lui ! Dans cette période de transition, on se punit soi-même, par la méfiance à l’égard de ses propres sentiments ; on martyrise son enthousiasme par le doute, la bonne conscience vous apparaît déjà comme un danger, au point que l’on pourrait croire que le moi en est irrité et qu’une sincérité plus subtile s’en fatigue. Encore, et avant toute autre chose, on prend parti, par principe, contre la « jeunesse ». — Dix ans plus tard on se rend compte que cela aussi n’a été que — jeunesse !
32.
Durant la plus longue période de l’histoire humaine — on l’appelle les temps préhistoriques — on jugeait de la valeur et de la non-valeur d’un acte d’après ses conséquences. L’acte, par lui-même, entrait tout aussi peu en considération que son origine. Il se passait à peu près ce qui se passe encore aujourd’hui en Chine, où l’honneur ou la honte des enfants remonte aux parents. De même, l’effet rétroactif du succès ou de l’insuccès poussait les hommes à penser bien ou mal d’une action. Appelons cette période la période prémorale de l’humanité. L’impératif « connais-toi toi-même » était alors encore inconnu. Mais, durant les derniers dix mille ans, on en est venu, peu à peu, sur une grande surface du globe, à ne plus considérer les conséquences d’un acte comme décisives au point de vue de la valeur de cet acte, mais seulement son origine. C’est, dans son ensemble, un événement considérable qui a amené un grand affinement du regard et de la mesure, effet inconscient du règne des valeurs aristocratiques et de la croyance à l’ « origine », signe d’une période que l’on peut appeler, au sens plus étroit, la période morale : ainsi s’effectue la première tentative pour arriver à la connaissance de soi-même. Au lieu des conséquences, l’origine. Quel renversement de la perspective ! Certes, renversement obtenu seulement après de longues luttes et des hésitations prolongées ! Il est vrai que, par là, une nouvelle superstition néfaste, une singulière étroitesse de l’interprétation, se mirent à dominer. Car on interpréta l’origine d’un acte, dans le sens le plus précis, comme dérivant d’une intention, on s’entendit pour croire que la valeur d’un acte réside dans la valeur de l’intention. L’intention serait toute l’origine, toute l’histoire d’une action. Sous l’empire de ce préjugé, on se mit à louer et à blâmer, à juger et aussi à philosopher, au point de vue moral, jusqu’à nos jours. — Ne serions-nous pas arrivés, aujourd’hui, à la nécessité de nous éclairer encore une fois au sujet du renversement et du déplacement général des valeurs, grâce à un nouveau retour sur soi-même, à un nouvel approfondissement de l’homme ? Ne serions-nous pas au seuil d’une période qu’il faudrait, avant tout, dénommer négativement période extra morale ? Aussi bien, nous autres immoralistes, soupçonnons-nous aujourd’hui que c’est précisément ce qu’il y a de non-intentionnel dans un acte qui lui prête une valeur décisive, et que tout ce qui y paraît prémédité, tout ce que l’on peut voir, savoir, tout ce qui vient à la « conscience », fait encore partie de sa surface, de sa « peau », qui, comme toute peau, cache bien plus de choses qu’elle n’en révèle. Bref, nous croyons que l’intention n’est qu’un signe et un symptôme qui a besoin d’interprétation, et ce signe possède des sens trop différents pour signifier quelque chose par lui-même. Nous croyons encore que la morale, telle qu’on l’a entendue jusqu’à présent, dans le sens de morale d’intention, a été un préjugé, une chose hâtive et provisoire peut-être, de la nature de l’astrologie et de l’alchimie, en tous les cas quelque chose qui doit être surmonté. Surmonter la morale, en un certain sens même la morale surmontée par elle-même : ce sera la longue et mystérieuse tâche, réservée aux consciences les plus délicates et les plus loyales, mais aussi aux plus méchantes qu’il y ait aujourd’hui, comme à de vivantes pierres de touche de l’âme. —
Читать дальше