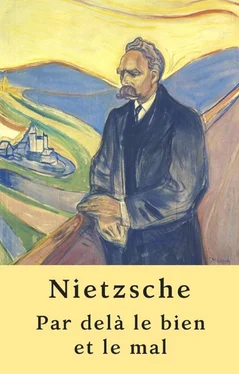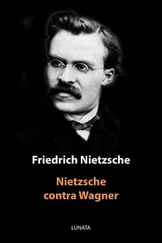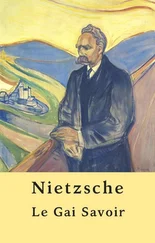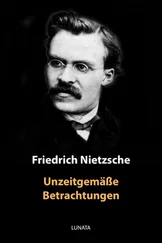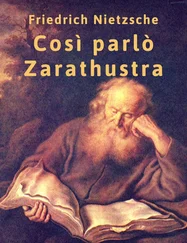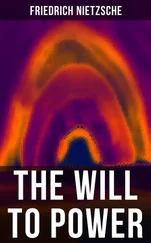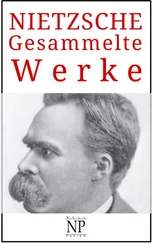33.
Cela ne sert de rien, il faut impitoyablement demander raison à tous les sentiments d’abnégation et de sacrifice pour le prochain, citer en justice toute la morale d’abnégation. Il faut agir de même avec l’esthétique de la « vision désintéressée », sous les auspices de laquelle l’efféminement de l’art cherche aujourd’hui à se créer, d’insidieuse façon, une bonne conscience. Il y a beaucoup trop de séduction et de douceur dans ce sentiment qui veut s’affirmer « pour autrui » et non « pour moi », aussi est-il nécessaire de se méfier doublement et de se demander si ce ne sont pas là simplement des séductions. — Qu’elles plaisent à celui qui les possède et jouit de leurs fruits, et aussi au simple spectateur, — ce n’est pas un argument en leur faveur ; cela invite, tout au contraire, à la méfiance. Soyons donc méfiants.
34.
Quel que soit le point de vue philosophique où l’on se place aujourd’hui, partout le caractère erroné du monde dans lequel nous pensons vivre nous apparaît comme la chose la plus certaine et la plus solide que notre œil puisse saisir. Nous trouvons une raison après l’autre qui voudraient nous induire à des suppositions au sujet du principe trompeur, caché dans « l’essence des choses ». Mais quiconque rend responsable de la fausseté du monde notre mode de penser, c’est-à-dire « l’esprit » — échappatoire honorable pour tout avocat de Dieu, conscient ou inconscient — quiconque considère ce monde, ainsi que l’espace, le temps, la forme, le mouvement, comme faussement inférés , celui-là aurait du moins de bonnes raisons pour apprendre à se méfier, enfin, de la pensée même. La pensée ne nous aurait-elle pas joué jusqu’à présent le plus mauvais tour ? Et quelle garantie aurions-nous de croire qu’elle ne continuera pas à faire ce qu’elle a toujours fait ? Sérieusement, l’innocence des penseurs a quelque chose de touchant qui inspire le respect. Cette innocence permet aux penseurs de se dresser aujourd’hui encore, en face de la conscience, pour lui demander une réponse loyale, pour lui demander, par exemple, si elle est « réelle », pourquoi elle se débarrasse en somme si résolument du monde extérieur, et autres questions de même nature. La croyance en des « certitudes immédiates » est une naïveté morale qui nous fait honneur, à nous autres philosophes. Mais, une fois pour toutes, il nous est interdit d’être des hommes « exclusivement moraux » ! Abstraction faite de la morale, cette croyance est une absurdité qui nous fait peu d’honneur ! Dans la vie civile la méfiance toujours aux aguets peut être la preuve d’un « mauvais caractère » et passer dès lors pour peu habile, mais, lorsque nous sommes entre nous, au delà du monde bourgeois et de ses appréciations, qu’est-ce qui devrait nous empêcher d’être déraisonnables et de nous dire : le philosophe a acquis le droit au « mauvais caractère », étant l’être qui jusqu’à présent a été le plus dupé sur la terre ? Il a aujourd’hui le devoir de se méfier, de regarder toujours de travers, comme s’il voyait des abîmes de suspicion. — On me pardonnera ce tour d’esprit macabre, car j’ai appris moi-même, depuis longtemps, à penser autrement, à avoir une évaluation différente sur le fait de duper quelqu’un et d’être dupé, et je tiens en réserve quelques bonnes bourrades pour la colère aveugle des philosophes qui se défendent d’être dupés. Eh pourquoi pas ! Ce n’est qu’un préjugé moral de croire que la vérité vaut mieux que l’apparence. C’est même la supposition la plus mal fondée qui soit au monde. Qu’on veuille bien se l’avouer, la vie n’existerait pas du tout si elle n’avait pour base des appréciations et des illusions de perspective. Si, avec le vertueux enthousiasme et la balourdise de certains philosophes, on voulait supprimer totalement le « monde des apparences » — en admettant même que vous le puissiez — il y a une chose dont il ne resterait du moins plus rien : de votre « vérité ». Car y a-t-il quelque chose qui nous force à croire qu’il existe une contradiction essentielle entre le « vrai » et le « faux ? » Ne suffit-il pas d’admettre des degrés dans l’apparence, des ombres plus claires et plus obscures en quelque sorte, des tons d’ensemble dans la fiction, — des valeurs différentes, pour parler le langage des peintres ? Pourquoi le monde qui nous concerne ne serait-il pas une fiction ? Et si quelqu’un nous disait : « Mais, la fiction nécessite un auteur » — ne pourrions-nous pas répondre « Pourquoi ? ». Car « nécessiter » n’est-ce pas là aussi une partie de la fiction ? N’est-il donc pas permis d’être quelque peu ironique à l’égard du sujet, comme à l’égard de l’attribut et du complément ? Le philosophe n’aurait-il pas le droit de s’élever contre la foi en la grammaire ? Nous sommes pleins de respect pour les gouvernantes ; mais ne serait-il pas temps que la philosophie abjurât la foi aux gouvernantes ? —
35.
Ô Voltaire ! Ô humanité ! Ô bêtise ! La « vérité », la recherche de la vérité, ce sont là choses délicates ; et si l’homme s’y prend d’une façon humaine, trop humaine, — « il ne cherche le vrai que pour faire le bien », — je parie qu’il ne trouvera rien.
36.
En admettant que rien de réel ne soit « donné », si ce n’est notre monde des désirs et des passions, que nous n’atteignons d’autre « réalité » que celle de nos instincts — car penser n’est qu’un rapport de ces instincts entre eux, — n’est-il pas permis de se demander si ce qui est « donné » ne suffit pas pour rendre intelligible, par ce qui nous ressemble, l’univers nommé mécanique (ou « matériel ») ? Je ne veux pas dire par là qu’il faut entendre l’univers comme une illusion, une « apparence », une « représentation » (au sens de Berkeley ou de Schopenhauer), mais comme ayant une réalité de même ordre que celle de nos passions, comme une forme plus primitive du monde des passions, où tout ce qui, plus tard, dans le processus organique, sera séparé et différencié (et aussi, comme il va de soi, affaibli et efféminé —) est encore lié par une puissante unité, pareil à une façon de vie instinctive où l’ensemble des fonctions organiques, régulation automatique, assimilation, nutrition, sécrétion, circulation, — est systématiquement lié, tel une forme primaire de la vie. — En fin de compte, il est non seulement permis d’entreprendre cette tentative, la conscience de la méthode l’impose même. Ne pas admettre plusieurs sortes de causalité, tant que l’on n’aura pas poussé jusqu’à son extrême limite l’effort pour réussir avec une seule (— jusqu’à l’absurde, soit dit avec votre permission), c’est là une morale de la méthode à quoi l’on ne peut pas se soustraire aujourd’hui. C’est une conséquence « par définition », comme disent les mathématiciens. Il faut se demander enfin si nous reconnaissons la volonté comme agissante , si nous croyons à la causalité de la volonté. S’il en est ainsi — et au fond cette croyance est la croyance à la causalité même — nous devons essayer de considérer hypothétiquement la causalité de la volonté comme la seule. La « volonté » ne peut naturellement agir que sur la « volonté », et non sur la « matière » (sur les « nerfs » par exemple) ; bref, il faut risquer l’hypothèse que, partout où l’on reconnaît des « effets », c’est la volonté qui agit sur la volonté, et aussi que tout processus mécanique, en tant qu’il est animé d’une force agissante, n’est autre chose que la force de volonté, l’effet de la volonté. — En admettant enfin qu’il soit possible d’établir que notre vie instinctive tout entière n’est que le développement et la différenciation d’une seule forme fondamentale de la volonté — je veux dire, conformément à ma thèse, de la volonté de puissance, — en admettant qu’il soit possible de ramener toutes les fonctions organiques à cette volonté de puissance, d’y trouver aussi la solution du problème de la fécondation et de la nutrition — c’est un seul et même problème, — on aurait ainsi acquis le droit de désigner toute force agissante du nom de volonté de puissance . L’univers vu du dedans, l’univers défini et déterminé par son « caractère intelligible », ne serait pas autre chose que la « volonté de puissance ». —
Читать дальше