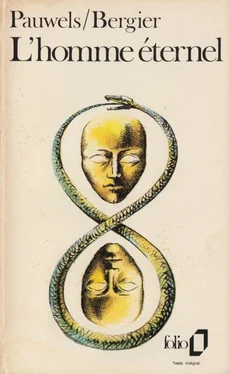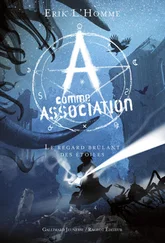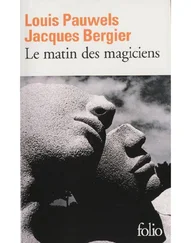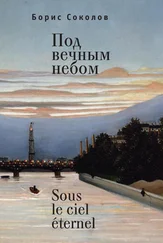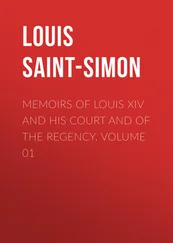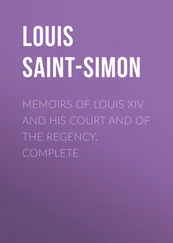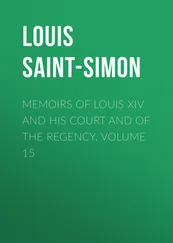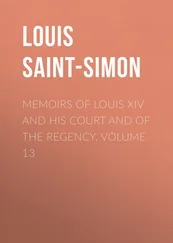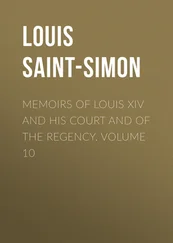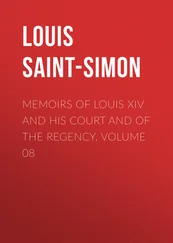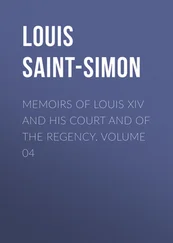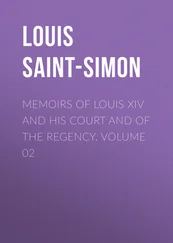Louis Pauwels - L'homme éternel
Здесь есть возможность читать онлайн «Louis Pauwels - L'homme éternel» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, Публицистика, Эзотерика, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:L'homme éternel
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
L'homme éternel: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «L'homme éternel»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
L'homme éternel — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «L'homme éternel», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mais ce qui trouble le plus, ici, d'emblée, c'est le degré de culture et de raffinement que présupposent les trouvailles faites dans ces douze cités.
Chaque ville se composait de maisons en brique démunies de portes. On accédait à l'intérieur par le toit en terrasse à l'aide d'échelles. L'ensemble des logements d'un quartier était disposé en nid d'abeilles et constituait une forteresse protégeant des assaillants éventuels et des crues de la rivière Carsamba. Les édifices s'étaient presque tous effondrés, mais on parvint à reconstituer des fragments de murs. On découvrit qu'ils étaient intérieurement revêtus de fresques. Cependant, les restaurateurs se heurtèrent à un écueil. Une fois livrées à la clarté solaire, les couleurs s'altérèrent. Sans doute étaient-elles à base de pigments minéraux qui se détériorent sous l'action de la lumière. On photographia rapidement les fresques pour en préserver le souvenir intact. (Par la suite, on procéda à divers essais d'englobement pour préserver les teintes. L'acétate de polyvinyle donna satisfaction.)
Ces fresques représentaient des scènes variées : chasses, jeux, cérémonies ou des personnages dans différentes attitudes. La facture était d'un tel réalisme qu'on peut lire les traits dominants des caractères : l'activité débordante qu'une grande souplesse favorisait, l'intelligence astucieuse confinant à la ruse. On reconstitua les modes vestimentaires. Les hommes portaient des chemises de laine, des tuniques et des manteaux d'hiver en peau de léopard, munis de ceintures à boucles en os. Dans l'ourlet des robes féminines, des cercles de cuivre, analogues à ceux de laiton qui conféraient leur rigidité aux crinolines de nos aïeules, empêchaient les jupes de se soulever. Le décolleté, assez audacieux, ne s'apparentait toutefois pas à celui de la Crétoise qui servit de modèle à la statuette baptisée la « Parisienne ». Des bijoux de plomb, métal rarissime à l'époque, ou de cuivre serti de pierres dures taillées ou de pierres précieuses, complétaient les atours. Les nécessaires qui renfermaient des produits de teintes différentes laissent à penser que l'usage du fard n'était pas inconnu et les élégantes, pour vérifier leur maquillage, disposaient de miroirs d'obsidienne dont la monture s'enrobait de plâtre pour éviter qu'elles ne se blessent…
Des animaux figuraient aussi sur ces fresques : oiseaux (plus particulièrement des vautours), léopards et taureaux. Les taureaux l'emportent en nombre. Les symboles abondent dans ces peintures murales : de curieux réseaux de lignes rouges et noires qui se croisent ; puis des rosettes, des mandales, des haches à double tranchant (que l'on retrouve plusieurs millénaires plus tard chez les Scythes, en Thrace, en Crète également), des croix assez nombreuses.
Mais le symbole le plus saisissant et le plus fréquemment représenté à Çatal hüyük est la main humaine. On ne peut manquer d'établir un lien avec celles que peignaient déjà les Aurignaciens plusieurs dizaines de millénaires auparavant sur les parois de leurs cavernes, par exemple à Gargas dans les Hautes-Pyrénées, à Cabrerets dans le Lot, à Castillo près de Santander. Ils utilisaient toutefois un procédé différent car ils appliquaient la peinture au pochoir, entre les mains qui, sans doute posées à plat, apparaissaient en négatif. À Çatal hüyük, elles aussi étaient coloriées. Certes, on ne peut que supputer l'importance qu'on leur accordait exactement. Se pourrait-il qu'à peine sorti de la période glaciaire, l'homme soit déjà accordé à cette partie de son corps dans laquelle, selon les Chiromanciens de tant de contrées de la Mésopotamie à la Chine, se dessinent les traits de son caractère et les événements essentiels de sa vie ? Ou faut-il voir dans les séries de mains qui se jouxtent à Çatal hüyük des indications numéraires, chaque doigt représentant une unité ? Mais quand celles-ci se pressent contre des seins, le symbole devient plus clair dans le sens d'une invocation procréatrice…
Si l'on considère d'une part tous ces symboles, et d'autre part les cachets d'argile cuite retrouvés en très grand nombre, l'absence d'écriture sous quelque forme que ce soit surprend. Des cachets de la dimension d'un timbre-poste existaient dans chaque maison. Ils servaient à marquer des objets de céramique et ils différaient tous les uns des autres, ce qui incite à croire à une propriété privée régie strictement et aussi à une structure sociale basée sur la famille. On pourrait les rapprocher des blasons de notre ère ; mais ils étaient l'apanage des nobles, alors qu'ils sont ici présents dans tous les foyers. On imagine que ces cachets servaient à signer des messages écrits sur des matériaux périssables. Mais comment supposer que nulle trace de ces matériaux n'a subsisté, même très altérée, même sous forme de poussière ? Comment aussi expliquer qu'aucune inscription ne figure sur les fresques mises au jour jusqu'à présent ? Cependant, des accomplissements en tant de domaines ne permettent pas d'admettre que les hommes de Çatal hüyük n'ont possédé aucune forme de graphisme ou de préservation de la parole. Peut-être ne savons-nous pas identifier cette écriture, ou des enregistrements subtils ? Peut-être sommes-nous en présence d'héritiers de l'écriture perdue des origines ? Peut-être l'écriture fut-elle intentionnellement secrète ou interdite ? On peut aussi se demander s'ils n'utilisaient pas une encre cryptographique exclusivement sensible à un révélateur connu des maîtres initiés.
On a retrouvé, dans quarante sanctuaires exhumés, de nombreuses sculptures et divers objets cultuels. Ces éléments permettent de reconstituer, partiellement, la religion des premiers citadins du monde (jusqu'à preuve du contraire).
Les sanctuaires semblent avoir été tous dédiés à la Déesse-Mère. La présence de cette Déesse suggère qu'il existe un lien entre tous les cultes à l'aube de l'humanité. Ne figure-t-elle pas parmi les statuettes de l'ère solutréenne, découvertes à Vilendorf en Autriche, à Brassempouy dans les Landes comme dans la grotte de Grimaldi à Menton ? Ne la retrouve-t-on pas chez le Tchouktchi esquimau ? Là, tantôt elle s'appelle la Mère du Mort, tantôt elle porte d'autres noms selon ses attributions multiples mais dont l'essentielle est la fécondité. En Sibérie également le Chaman ne s'adresse-t-il pas à la Maîtresse de la Terre qui le renvoie à la Mère de l'Univers pour obtenir l'autorisation de prendre au lasso les animaux qui assurent sa subsistance ? Des statuettes représentant la Déesse rudimentairement n'ont-elles pas été exhumées à Jarmo, vieilles de près de neuf mille ans ? À Eshmun en Mésopotamie, comme à Baalbek ne l'adorait-on pas ? En Égypte, elle s'identifie à Maat. En Chaldée, elle existe tantôt mince comme une sylphide, tantôt callipyge. Et n'est-ce pas elle que représentent les mères allaitant leurs enfants dans les figurines en terre cuite de Tell Obeid ? On a cru la reconnaître à Mohenjo-Daro, dans la vallée de l'Indus, et depuis l'époque védique elle occupe une place de choix dans le Panthéon indien. La Reine de l'Eau au Mexique (de l'eau, source de la vie) comme celle de la Fécondité des Minoens, d'abord stéatopyge puis élancée, tantôt nue, tantôt vêtue et parée, s'identifient à elle. Au Louristan, il y a environ cinq mille cinq cents ans, on trouve d'elle diverses représentations. Et en Anatolie quatre mille ans après la disparition de Çatal hüyük elle demeure présente. Les chaînons manquent, mais on est tenté de la retrouver dans le culte de maya, la Mère de Gautana Bouddha comme dans la vénération de Marie, mère de Jésus. Permanence de cette Déesse-Mère de l'univers ?
Dans les statues trouvées à Çatal hüyük elle est exclusivement callipyge. L'une de celles-ci la représente en train d'accoucher d'un taureau (préfiguration du culte de Mithra ?). Des peintures murales indiquent qu'elle avait le pouvoir de ressusciter les défunts. Sa couleur comme celle de la vie était le rouge. Celle de la mort : le noir.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «L'homme éternel»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «L'homme éternel» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «L'homme éternel» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.