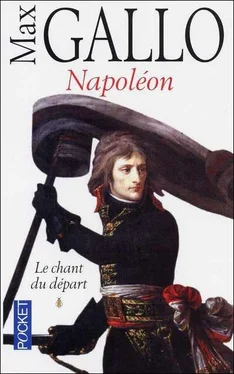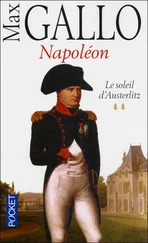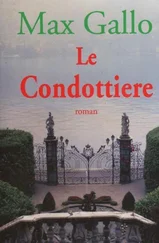Il sait, lui, que les Anglais ne l'intercepteront pas. Il sait que la France est lasse des guerres entre Jacobins et émigrés, qu'elle veut la paix intérieure, qu'elle attend l'homme qui la lui apportera.
Peut-être cet homme est-il déjà en place ?
C'est sa seule inquiétude.
Le 30 septembre, il contemple les reliefs de la côte corse dans le soleil couchant, puis ce sont les parfums du maquis, et bientôt apparaissent la citadelle et les maisons d'Ajaccio.
Le 1 er octobre, la Muiron jette l'ancre et aussitôt surgissent de toutes parts des embarcations.
Comment ont-ils su ?
Ils crient, ils acclament. Personne ne prête attention à l'obligation de la quarantaine. On veut voir Napoléon, le toucher. On l'embrasse. Il distingue, dans la foule qui maintenant se presse sur le quai, sa nourrice, Camille Ilari, vieille femme qui bientôt le serre contre lui. C'est son enfance, si proche et si lointaine, qu'il embrasse. Il apprend que Louis, qu'il avait envoyé en France en 1798, est passé par Ajaccio puis a gagné le continent avec leur mère.
Napoléon se rend à la maison de campagne de Melilli. Il retrouve dans sa mémoire chaque détail, et cependant il n'éprouve pas d'émotion. Cet univers est enfoui en lui comme un décor dont il est sorti et qui ne le concerne plus, alors qu'on l'entoure de prévenances intéressées. « Quel ennui, murmure-t-il. Il me pleut des parents. »
Il demande les derniers journaux qui sont arrivés de France. Il lit avec avidité les nouvelles, mesure que la situation militaire s'est redressée, que Masséna - « son » Masséna - a remporté des victoires en Italie, que le général Brune résiste dans la République batave, mais que la crise politique couve à Paris, où Sieyès mène le jeu.
Il faut quitter la Corse, arriver à temps.
Enfin, le 7 octobre, le vent se lève, on peut appareiller.
Napoléon se tient à la proue jusqu'à ce que la côte française soit en vue.
C'est le moment le plus périlleux de la traversée. L'escadre anglaise croise le long des côtes. Au large de Toulon, on aperçoit des voiles, qui heureusement s'éloignent.
Le 9 octobre au matin, on entre dans le golfe de Saint-Raphaël.
La citadelle de Fréjus ouvre le feu devant l'arrivée de cette division navale inconnue.
De la proue, Napoléon voit la foule qui se précipite sur les quais puis se jette dans les embarcations, rame vers les frégates, crie : « Bonaparte ! »
L'amiral Ganteaume s'approche au moment où la Muiron est envahie.
- Je vous ai conduits où vos destins vous appellent, dit l'amiral.
Des bras soulèvent Napoléon, le portent en triomphe.
- Il est là ! Il est là ! crie-t-on.
Il descend de la frégate. Sur le quai, un cortège se forme.
Qui pense à la quarantaine, au risque de la peste ?
On prépare une voiture.
Puisqu'il est là, c'est bien que la Fortune l'a protégé.
Qui pourrait m'arrêter ?
Neuvième partie
Oui, suivez-moi.
Je suis le dieu du jour.
9 octobre 1799 - 11 novembre 1799
(20 Brumaire An VIII)
36.
Dix-sept mois qu'il a quitté la France ! C'était le printemps, le mois de mai 1798, et c'est l'automne. Le lit de la Durance est envahi de flots boueux. Le temps est à l'orage, et les averses obligent parfois à retenir les chevaux.
À l'époque, il roulait vers Toulon. Joséphine était près de lui, lui donnant tous les signes de l'attachement. Prête, avait-elle dit, à le suivre en Égypte.
Il sait maintenant ce qu'il en est d'elle, du capitaine Charles, de ses amants.
La fureur et l'amertume envahissent Napoléon dès que les rumeurs de la foule, qui, à chaque village, entoure les voitures, crie : « Vive la République ! Vive Bonaparte ! », se sont estompées et qu'il reste seul avec ses pensées.
Voudrait-il oublier, qu'il lui suffit de regarder Eugène de Beauharnais, assis en face de lui, pour se souvenir.
À Avignon, le peuple arrête les voitures. On veut fêter Bonaparte, le victorieux, l'homme de la paix. Il dit quelques mots : « Je ne suis d'aucune coterie, je suis la grande coterie du peuple français. » On l'acclame. On célèbre sa victoire d'Aboukir. La nouvelle est donc parvenue jusqu'ici et, comme il l'avait prévu, le peuple ne retient qu'elle. Il suit des yeux Murat, qui, son cimeterre accroché par des cordons, se pavane, bronzé, raconte sa charge aux officiers de la garnison qui l'entourent. Le Mamelouk Roustam est au centre d'une foule qui le questionne, veut toucher son uniforme. Roustam essaie de fendre ce cercle qui le presse. Lorsqu'il est proche de Napoléon, il réussit à dire que les voitures qui portaient les bagages ont été pillées, dans les environs d'Aix, qu'elles sont immobilisées. Il répète : « Bédouins français ont volé. Bédouins français. »
En entendant ces mots, la foule gronde. Les brigands harcèlent les voyageurs, dévalisent les diligences. Il faut le retour de la paix et de l'ordre. « Le Directoire nous dévalise aussi ! » crie une voix. Tous brigands, tous, reprend-on.
Napoléon s'approche des notables, qui se lamentent, flattés de l'attention qu'il leur porte. Le général Bonaparte sait-il que le Directoire veut décréter un emprunt forcé pour voler les honnêtes gens, ceux qui ont du bien ? Et puis il y a les Chouans, qui tiennent toujours une partie de la Vendée, qui menacent Nantes. Qui peut nous assurer que les émigrés ne vont point rentrer, exiger la restitution des terres qui ont été vendues comme biens nationaux et que nous avons achetées ? Il faut sauver la République, disent-ils.
- Je suis national, dit Napoléon alors qu'il monte dans la voiture.
Il lance depuis le marchepied :
- Il ne faut plus de factions, je n'en souffrirai aucune. Vive la nation !
Les cris de « Vive la République ! Vive Bonaparte ! » l'accompagnent tout au long des rues d'Avignon, et plus tard, tout au long de la route, dans les villages de la vallée du Rhône, il retrouve les mêmes clameurs.
À l'approche de Lyon, il voit aux croisées de toutes les maisons des drapeaux tricolores. Les postillons, aux relais, ont arboré des rubans aux mêmes couleurs.
C'est pour lui.
À Lyon, toutes les maisons sont illuminées et pavoisées. On tire des fusées. La foule est si dense que les voitures doivent rouler au pas.
Il aperçoit, devant la porte de l'hôtel, des grenadiers, et, sur le perron, ses frères Louis et Joseph.
De toutes parts, on crie : « Vive Bonaparte qui vient sauver la patrie ! »
Il salue la foule avec modestie. Il sent que la vague qui le porte est puissante, profonde, mais il doit se garder de tout excès et de toute impatience. Ce qu'il veut, il le sait : accéder au pouvoir. Il vaut mieux que tous ces hommes qui s'y déchirent. Il a trente ans. Il a commandé à des dizaines de milliers d'hommes. Il a affronté avec eux la mort. Il a vaincu. Il va bousculer tous les obstacles. Mais la prudence est nécessaire. Les Barras et les Sieyès sont habiles, retors.
Il s'isole avec Joseph.
Napoléon voudrait d'abord évoquer la situation à Paris, les projets des uns et des autres. Mais ce sont d'autres questions qui viennent à ses lèvres : Joséphine, Joséphine, répète-t-il.
Joseph commence à parler d'une voix sourde, puis s'emporte. Il ne paie plus à Joséphine la rente de quarante mille francs que Napoléon l'avait chargé de lui verser. Elle a ridiculisé le nom des Bonaparte. Elle a vécu avec le capitaine Charles à Malmaison, cette propriété qu'elle a achetée. Elle a continué de voir Barras. On l'a vue chez Gohier, le président du Directoire. Quel homme puissant ne lui prête-t-on pas comme amant ? Elle est couverte de dettes. Elle a favorisé Charles dans ses trafics sur les approvisionnements des armées.
Читать дальше