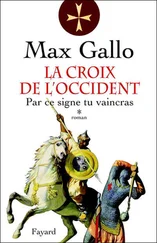Un officier russe, le major Kampov, raconte l'une des nuits de cette offensive, quand les Russes réussissent à encercler des milliers d'Allemands[1].
« Je me rappelle cette nuit fatale du 17 février 1944. Il soufflait un terrible blizzard. Le général Koniev, à bord d'un tank, avançait avec nous dans le "corridor", battu par l'artillerie. Moi, j'allais à cheval d'un point du corridor à l'autre, porteur d'un ordre du général. Il faisait si noir que je ne distinguais pas les oreilles du cheval. Je parle de cette obscurité et du vent car ils jouèrent un rôle important dans la bataille... C'est cette nuit-là que les Allemands, ayant perdu tout espoir d'être secourus, décidèrent de faire un ultime effort pour percer.
« Ils venaient de passer une soirée délirante à l'abri dans les maisons d'un gros village dont ils avaient chassé les habitants. Les quelques vaches qui restaient au village avaient été abattues et dévorées avec une frénésie de cannibale. Un tonneau de choux marinés découvert dans une hutte fut littéralement dépecé. Depuis l'encerclement, ils étaient à court de vivres. Et ils avaient beaucoup bu... »
Les Allemands quittent ce village sous les bombardements déments de l'artillerie et de l'aviation russes.
Ils achèvent leurs blessés d'une balle dans la nuque. Ils mettent le feu aux voitures d'ambulance pleines de morts.
Puis commence la marche, dans la nuit et le vent, au fond des ravins afin de ne pas être vus des Russes.
Illusion ! Les Russes les observent, les suivent, les attendent à la sortie des ravins.
« Spectacle étrange, continue le major Kampov, que ces deux colonnes allemandes formées en triangle et essayant de briser l'encerclement. Elles ressemblaient à deux énormes essaims. En tête et sur les flancs, ils avaient mis les SS de la division Viking et de la division belge Wallonie, reconnaissables à leurs uniformes gris perle. Ces SS étaient encore en bonne condition physique. À l'intérieur du triangle, il y avait la troupe ordinaire : une horde épuisée avec, en son centre, un petit noyau d'officiers d'élite, qui avaient l'air assez bien nourris. Ainsi ces deux colonnes avançaient, chacune dans un ravin. Les deux ravins convergeaient. Les Allemands s'étaient mis en marche à 4 heures, il faisait encore complètement noir. Nous savions d'où ils venaient et où ils allaient. Nous avions préparé cinq lignes : deux d'infanterie, une d'artillerie, puis deux lignes de chars et de cavalerie. Nous les avons laissés passer à travers les deux premières sans tirer un seul coup de feu. Croyant nous avoir "possédés" et avoir franchi nos lignes de défense, les Allemands se mirent à pousser des hourras frénétiques et à tirer en l'air avec leurs pistolets et leurs mitraillettes. À présent, ils avaient émergé des ravins, et avançaient en terrain découvert.
« Alors, ça se déclencha : à 6 heures du matin environ, nos chars et notre cavalerie surgirent à l'improviste et foncèrent droit sur le plus épais des deux colonnes. Ce qui suivit n'est pas facile à décrire. Les Allemands débandèrent dans toutes les directions. Et pendant deux heures nos tanks les pourchassèrent à travers la plaine, les écrasant par milliers. Rivalisant avec les blindés, notre cavalerie allait les cueillir dans les ravins où les chars avaient difficilement accès. Les tanks faisaient rarement usage de leurs canons pour ne pas atteindre nos cavaliers : ceux-ci hachaient les Allemands au sabre, faisant un massacre comme on n'en avait jamais vu encore. On n'avait pas le temps de faire des prisonniers. Le carnage ne cessa que faute de victimes. Plus de 20 000 Allemands furent tués sur un petit espace. J'ai vu Stalingrad, mais c'était la première fois que je voyais un pareil massacre sur un terrain aussi réduit. À 9 heures, c'était fini. Il resta 8 000 Allemands vivants, qui se rendirent ce jour-là et les jours suivants. Presque tous avaient pu fuir loin du lieu du carnage. Ils étaient cachés dans les bois ou dans les ravins. »
« Pas le temps de faire des prisonniers », dit sans remords le major Kampov. Et plusieurs SS ont choisi de se suicider, évitant l'exécution ou la longue agonie que vont connaître ceux des Allemands qui se sont rendus après la bataille. Car les camps russes sont des lieux de mort comme le sont les camps allemands pour les prisonniers russes.
Koniev, qu'on appelle « le général qui ne recule jamais », poursuit après cette victoire de Korsun son offensive, en dépit de la boue, des « routes mortes ».
Mais les chars T34 et les camions américains Studebaker triomphent de la boue.
Et Koniev s'enfonce en Ukraine, laissant derrière lui la plaine jonchée de casques allemands. Les corps ont été entassés dans des fosses à même la terre, comme pour les dépouilles des soldats russes.
« Si on avait voulu les inhumer individuellement, dit le major Kampov, il nous aurait fallu une armée de fossoyeurs. »

3.
L'« armée des fossoyeurs », contrairement à ce que pense le major Kampov, existe dans l'Europe occupée par les nazis.
En janvier 1944, c'est une immense troupe constituée par les Allemands, dès qu'ils sont entrés en Pologne en septembre 1939.
Les Einsatzgruppen ont choisi parmi les Juifs qu'ils allaient abattre d'une balle dans la nuque ceux qui devaient creuser les fosses.
Et ceux-là seraient tués les premiers ou les derniers, c'était selon la fantaisie ou les habitudes de l'officier SS qui commandait l'opération.
Les Sonderkommandos des camps d'extermination qui recueillaient les corps encore chauds sortis des chambres à gaz, à Treblinka, faisaient partie de cette armée de fossoyeurs.
Elle était présente dans les villes et les villages d'Europe, de la Bretagne à l'Ukraine, de la Flandre à la Grèce, en Yougoslavie et en Italie, là où la Résistance a créé des maquis, organise des attentats, des sabotages.
Partout, des fosses étaient creusées.
Et les Allemands, méthodiques, en avaient relevé l'emplacement.
En ce début de l'année 1944, parce que l'armée Rouge avance, pénètre en Biélorussie, en Ukraine, et bientôt en Pologne, les nazis constituent des « brigades de la mort ».
Composées de déportés, elles déterrent les victimes des Einsatzgruppen.
Il faut effacer les traces des massacres.
On brûle les corps décomposés en de grands bûchers qu'on arrose d'huile et d'essence pour que le feu dévore ces hommes, ces femmes, ces enfants, et les martyrise une seconde fois.
Puis on répand leurs cendres comme on sème.
Et on tue et enfouit les membres des « brigades de la mort ».
Dans certains pays, on fait appel à des fossoyeurs de métier.
Ils inhument les centaines d'otages que les Allemands fusillent après chaque attentat.
En France, l'occupant laisse parfois les miliciens de Joseph Darnand constituer des cours martiales qui condamnent à mort en quelques minutes.
On abandonne les corps torturés sur le bord d'une route, dans un hangar dont les murs sont criblés de balles.
Souvent, on ignore le nom de ces martyrs, dépouillés de leurs papiers d'identité.
Aucun pays n'échappe, en 1944, à cette barbarie.
Elle règne en Italie du Nord, dans la vallée du Pô, sur les rives du lac de Côme ou de Garde.
Là, autour de Mussolini, les fascistes ont organisé, à Salò, une République Sociale que surveillent les SS du général Wolf.
Les partisans de cet État fantoche, ces Repubblichini, veulent un Grand Procès de la Vengeance afin d'envoyer à la mort les dignitaires du régime fasciste qui ont obtenu, le 24 juillet 1943, la démission de Mussolini et provoqué ainsi la fin de l'État fasciste.
Читать дальше