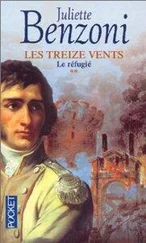Comme dans un mauvais rêve, Marianne aperçut des fenêtres grillées, des portes blasonnées, des murs lépreux parfois, mais aussi des ponts gracieux sous lesquels la gondole glissait comme un fantôme.
Enfin, il y eut au bord d’un petit quai, dans une rouge muraille crêtée de lierre noir, le linteau fleuronné d’un petit portail de pierre entre deux barbares lanternes de fer forgé.
Le frêle bateau s’arrêta. Marianne comprit que, cette fois, c’était bien là le but du voyage et son cœur manqua un battement... Elle était, à nouveau, chez le prince Sant’Anna.
Mais, cette fois, aucun serviteur ne l’attendait sur le perron verdi dont les marches plongeaient dans l’eau, ni dans l’étroit jardin où, autour d’un puits ciselé comme un coffret, une végétation drue semblait jaillir des antiques pierres elles-mêmes. Personne non plus sur le bel escalier rampant vers les minces colonnettes d’une galerie gothique derrière laquelle les bleus et les rouges d’un vitrail éclairé brillaient comme des joyaux. Sans cette lumière, on eût pu s’imaginer que ce palais était vide...
Pourtant, en escaladant les marches de pierre, Marianne, curieusement, retrouva d’un seul coup tout son courage et toute sa combativité. Il en allait toujours ainsi pour elle : la proximité immédiate du danger la galvanisait et lui rendait un équilibre que l’attente et l’incertitude lui enlevaient. Et elle savait, elle sentait, dans son instinct quasi animal, qu’une menace était cachée derrière les grâces de cette demeure d’un autre âge... ne fût-ce que le souvenir effrayant de Lucinda, la Sorcière, dont, selon toute probabilité, elle avait été autrefois la maison.
Si Marianne se souvenait bien de ce que lui avait dit Eleonora, c’était là le palais Soranzo, la maison natale de la terrible princesse. Et la jeune femme se prépara à lutter !
La somptuosité du vestibule qui s’ouvrit devant elle lui coupa le souffle. De grands fanaux dorés, magnifiquement ouvragés et provenant visiblement d’anciennes galères, faisaient chatoyer les marbres multicolores d’un dallage, fleuri comme un jardin persan, et les ors d’un plafond à longues poutres enluminées. Le long des murs, couverts d’une série de grands portraits, d’imposants bancs de bois armoriés alternaient avec des consoles de porphyre où se gonflaient les voiles des caravelles en réduction. Quant aux portraits, ils montraient tous des hommes ou des femmes vêtus avec une incroyable magnificence. Il y avait même ceux de deux doges en grand costume, le corno d’or en tête, l’orgueil sur le visage...
La vocation maritime de cette galerie était évidente et Marianne éblouie se surprit à penser que Jason, ou Surcouf, eussent aimé peut-être cette maison vouée à la mer. Malheureusement, elle était silencieuse comme une tombe.
Aucun bruit ne s’y faisait entendre, sinon celui des pas des arrivants. Et cela se révéla bientôt si angoissant que Giuseppe lui-même y parut sensible. Il toussota, comme pour se donner du courage, puis, marchant vers une porte à double battant située vers le milieu de la galerie, il chuchota comme dans une église :
— Ma mission s’achève ici, Excellenza ! Puis-je espérer que Madame ne gardera pas un trop mauvais souvenir...
— De ce délicieux voyage ? Mais, mon ami, soyez assuré que je m’en souviendrai toujours avec le plus vif plaisir !... si j’ai le temps de me souvenir de quelque chose ! ajouta-t-elle avec une ironie amère.
Giuseppe ne répondit pas, courba le dos et se retira. Cependant, la porte s’ouvrait en grinçant un peu, mais apparemment, sans le secours d’aucune main humaine.
Dressée au milieu d’une salle aux imposantes dimensions, une table apparut, toute servie et d’un luxe inouï. C’était un véritable parterre d’or : or des assiettes ciselées, des couverts, des gobelets émaillés, des flacons incrustés, du surtout garni d’admirables roses pourpres, et des grands chandeliers dont les branches se déployaient gracieusement, avec leur charge de bougies allumées, au-dessus de cette splendeur presque barbare mais qui centralisait la lumière, laissant dans l’ombre les murs tendus d’anciennes tapisseries et les sculptures précieuses de la grande cheminée.
C’était une table mise pour un repas de fête mais Marianne tressaillit en constatant qu’il n’y avait que deux couverts. Ainsi donc... le prince avait finalement décidé de se montrer. Sinon, quelle autre signification donner à ces deux couverts ? Et elle allait, enfin, se trouver en face de lui, le voir dans sa réalité peut-être atroce ?... Ou bien porterait-il encore son masque blanc en prenant place ici tout à l’heure ?
Malgré sa volonté, la jeune femme sentit l’appréhension lui griffer le cœur. Elle réalisait maintenant que, si sa curiosité naturelle la poussait avec insistance à percer le mystère dont s’entourait son étrange époux, elle avait toujours craint, instinctivement et depuis la nuit ensorcelée, de se trouver en face de lui, seule avec lui ! Et pourtant, cette table fleurie n’annonçait pas des intentions bien redoutables ! C’était une table mise pour séduire... presque une table d’amoureux.
La porte par laquelle Marianne était entrée se referma avec le même grincement. Au même instant une autre porte, étroite et basse celle-là, s’ouvrit au flanc de la cheminée, lentement, très lentement, comme au théâtre dans un drame bien réglé.
Figée sur place, les yeux agrandis, les tempes moites et les doigts crispés, Marianne la regarda tourner sur ses gonds comme elle eût regardé la porte d’un tombeau sur le point de livrer passage à un spectre.
Une silhouette brillante apparut à contre-jour, trop loin de la table pour être bien visible, éclairée seulement de dos par la lumière de la pièce voisine : celle d’un homme corpulent, vêtu d’une longue robe tissée d’or. Mais Marianne vit tout de suite que ce n’était pas la forme élégante du maître d’Ilderim. Celle-là était plus courte, plus lourde, moins noble. Elle pénétra dans l’immense salle à manger et la jeune femme, incrédule et indignée, regarda Matteo Damiani, vêtu comme un doge, s’approcher du foyer lumineux de la table.
Il souriait...
Les mains enfouies dans les larges manches de sa dalmatique, l’intendant et homme de confiance du prince Sant’Anna vint, d’un pas solennel, jusqu’à l’une des grandes chaises rouges qui marquaient les places à table, posa sur le dossier une main couverte de bagues et désigna l’autre d’un geste qui se voulait noble et courtois. Le sourire qu’il arborait paraissait appliqué sur son visage à la manière d’un masque.
— Asseyez-vous, je vous en prie, et soupons ! Ce long voyage a dû vous fatiguer.
Un instant, Marianne crut que ses yeux et ses oreilles lui jouaient un mauvais tour, mais elle se convainquit rapidement qu’elle n’était pas aux prises avec un rêve grotesque.
C’était bien Matteo Damiani qui se trouvait là, en face d’elle, le serviteur équivoque et dangereux dont elle avait bien failli devenir la victime au cours d’une nuit affreuse.
C’était la première fois qu’elle le revoyait depuis ce moment affolant où, en transe, il avait marché sur elle, les mains en avant, le meurtre dans ses yeux qui n’avaient plus rien d’humain. Sans l’irruption d’Ilderim et de son tragique cavalier...
Mais, à évoquer ce terrible souvenir, la peur de la jeune femme faillit bien se changer en panique. Il lui fallut faire, sur elle-même, un effort inouï pour non seulement lui résister mais encore réussir à la cacher. Avec un homme de cette sorte, dont elle connaissait l’inquiétant passé, sa seule chance de s’en tirer était justement de cacher la terreur qu’il lui inspirait. S’il s’apercevait qu’elle le craignait, son instinct lui soufflait qu’elle était perdue.
Читать дальше