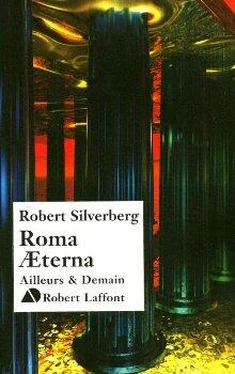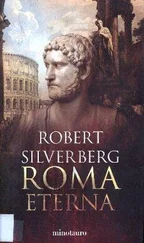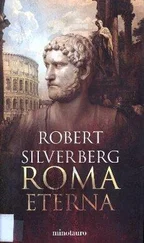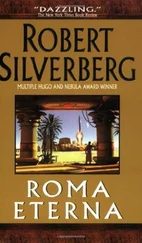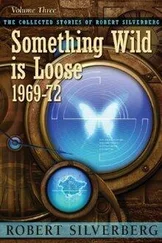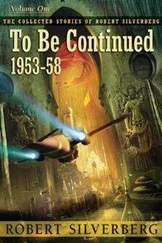« Il y a un problème, dit Friya tandis que nous approchions du pavillon. Je le sens. »
Friya avait toujours eu ce genre d’étranges pressentiments. J’ai lu la peur dans ses yeux et elle me la communiqua aussitôt.
Nous avons avancé prudemment. Il n’y avait aucun signe de Quintus Fabius. En arrivant à la porte, nous avons constaté qu’elle était légèrement entrouverte et hors de ses gonds, comme si on l’avait forcée. Friya me prit par le bras en se tournant vers moi. Je pris une profonde inspiration.
« Attends-moi ici », dis-je, avant d’entrer.
Le spectacle était effarant. On avait mis la maison à sac – meubles brisés, placards renversés, sculptures en miettes. Quelqu’un avait lacéré les tableaux. La collection d’armes et d’armures avait disparu.
J’allais de pièce en pièce, à la recherche de Quintus Fabius. Mais il était introuvable. Il y avait toutefois des traces de sang sur le sol du hall principal, encore frais et poisseux.
Friya attendait devant l’entrée, tremblante, retenant ses larmes.
« Nous arrivons trop tard », dis-je.
Bien entendu, ce n’était pas les garçons du village qui avaient fait cela. Ils n’auraient jamais pu se livrer à un travail aussi poussé. Je compris alors – comme Friya certainement, bien que nous fûmes trop écœurés pour en parler entre nous – que grand-mère avait dû dire à notre père que nous avions trouvé un trésor impérial dans la vieille maison, et que lui, en bon citoyen qu’il était, l’avait répété aux questeurs. Ils avaient mené leur enquête, trouvé Quintus Fabius, reconnu en lui un César, comme l’avait fait Friya. Ainsi mon désir de rapporter un cadeau à ma grand-mère avait scellé le destin du vieil homme. Je suppose qu’il n’aurait guère vécu longtemps, faible comme il était ; mais la culpabilité de ce que j’avais causé malgré moi ne m’a jamais quitté.
Quelques années plus tard, alors que la forêt avait pratiquement disparu, la vieille maison brûla accidentellement. J’étais un jeune homme alors et faisais partie de l’équipe de pompiers qui a éteint le feu. Pendant un bref répit, j’ai posé la question au capitaine des pompiers, un questeur à la retraite nommé Lucentius : « C’était un pavillon de chasse impérial à une époque, non ?
— Il y a bien longtemps, oui. »
Je l’ai observé de près sous les lumières vacillantes de l’incendie. C’était un homme âgé, de la génération de mon père.
J’ai continué prudemment. « Quand j’étais gosse, on racontait qu’un des derniers frères de l’empereur y avait trouvé refuge. Et que les questeurs avaient fini par le retrouver et le tuer. »
Il parut pris au dépourvu. Comme surpris et un peu gêné. « Vous avez entendu parler de ça ?
— Je me demandais s’il y avait du vrai là dedans. Que c’était un César, je veux dire. »
Lucentius détourna le regard. « Ce n’était qu’un clochard, c’est tout, dit-il d’une voix étouffée. Un vieux menteur. Il a sans doute raconté des histoires à dormir debout à de pauvres gosses crédules, mais ce n’était qu’un clochard, un vieux clochard sale et menteur. » Il me lança un regard curieux. Puis il s’éclipsa pour aller hurler après un de ses hommes qui enroulait son tuyau à l’envers.
Un vieux clochard sale, oui. Menteur, je ne crois pas.
Il est toujours resté vivant dans mes pensées jusqu’à aujourd’hui, pauvre vieille relique de l’Empire. Et aujourd’hui que je suis moi-même un vieillard, peut-être du même âge que lui à cette époque, je comprends mieux le sens de ses paroles. Pas lorsqu’il disait que seul un empereur pouvait maintenir la paix, car les Césars n’étaient après tout que des hommes, guère différents des consuls qui les ont remplacés. Mais lorsqu’il soutenait que l’ère de l’Empire avait été une ère de paix, il n’avait peut-être pas tout à fait tort, même si la guerre était un concept qui n’était pas tout à fait inconnu sous l’Empire. Car je comprends aujourd’hui que la guerre peut parfois être une forme de paix : les guerres civiles et les guerres de Réunification furent les combats d’un Empire divisé essayant de rassembler ses morceaux pour retrouver la paix. Ces sujets étaient complexes. La Seconde République n’est pas aussi vertueuse que mon père semblait le croire, ni l’ancien Empire apparemment aussi corrompu. La seule chose qui semble incontestable, c’est que l’hégémonie mondiale de Rome au cours de ces deux mille ans, d’abord sous l’Empire puis sous la République, malgré quelques agitations, nous a évité des troubles plus graves encore. Et si Rome n’avait jamais existé ? Si chaque région avait été libre de faire la guerre à ses voisins dans l’espoir de devenir un empire semblable à celui des Romains ? Imaginez une telle folie ! Mais les dieux nous ont donné les Romains, et les Romains nous ont apporté la paix : une paix certes imparfaite, mais la meilleure peut-être que pouvait espérer un monde imparfait. Du moins est-ce mon avis.
Quoi qu’il en soit, les Césars sont morts, ainsi que tous ceux dont j’ai mentionné le nom au cours de mon récit, même ma petite sœur Friya. Quant à moi, je ne suis qu’un vieil homme de la Seconde République, ressassant le passé en essayant de trouver un sens à tout cela. Je possède toujours l’étrange dague que Quintus Fabius m’avait offerte, à l’aspect barbare avec son étrange lame incurvée rapportée de quelque île de l’Oceanus Pacificus. Je la sors de temps en temps pour l’admirer. Elle brille, reflétant un peu de la splendeur de l’Antiquité sous la lumière de la lampe. Ma vue est trop faible pour discerner le minuscule sceau royal que l’on a gravé sur sa base lorsque le capitaine marchand, de retour des îles des mers du Sud, l’offrit au César de l’époque, quatre ou cinq cents ans plus tôt. Pas plus que je n’arrive à lire les petites lettres, SPQR, gravées sur la lame. À ma connaissance, elles ont tout aussi bien pu avoir été gravées par l’autochtone aux cheveux crépus qui avait façonné cette arme étrange : car lui aussi était un citoyen de l’Empire romain. Comme nous le sommes tous d’une manière ou d’une autre, même aujourd’hui sous la Seconde République. Comme nous le sommes tous.
2723 A. U. C. : Vers la Terre promise
Ils vinrent me chercher à midi, à l’heure d’Apollon, où seul un fou oserait s’aventurer dans le désert. J’étais en plein travail et guère disposé à me faire kidnapper. Mais j’avais autant de chances de leur faire entendre raison que d’inverser le cours du Nil. Ce n’était pas des hommes que l’on pouvait raisonner. Une lueur métallique se lisait dans leur regard et leurs mâchoires étaient serrées dans cette expression constipée que les fanatiques affectionnent. En plastronnant dans mon minuscule bureau encombré, bousculant les piles de livres et feuilletant le manuscrit de mon récit quasi achevé de la chute de l’Empire romain, ils ressemblaient à deux immenses forces irrésistibles, aussi lointaines et terrifiantes que des dieux de l’ancienne Egypte. Je me sentais complètement impuissant face à eux.
Le plus grand et le plus âgé se faisait appeler Eléazar. Mais pour moi, il était Horus, à cause de son grand nez de faucon. Il ressemblait à un Égyptien et portait la tunique en lin blanc des Égyptiens. L’autre, plus trapu et très musclé, avec une tête de babouin digne de Thot, disait s’appeler Leonardo Di Filippo, qui est évidemment un nom romain ; il y avait d’ailleurs en lui un côté huileux très romain. Mais je savais qu’il n’était pas plus romain que moi. Ni l’autre égyptien. Ils parlaient tous deux hébreu, avec une fluidité qu’un étranger ne pouvait avoir. C’était deux Israélites, des hommes de ma propre tribu obscure. Di Filippo avait dû naître d’un père qui n’était pas de notre foi, ou peut-être aimait-il tout simplement prétendre faire partie des maîtres du monde et non d’un peuple oublié de Dieu. Je ne le saurai jamais.
Читать дальше