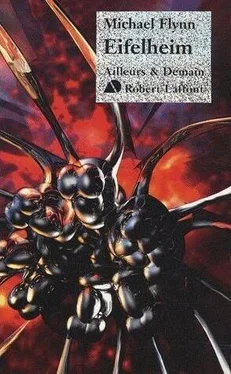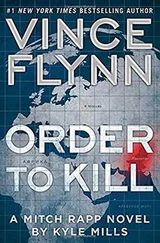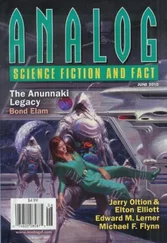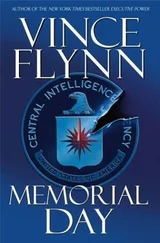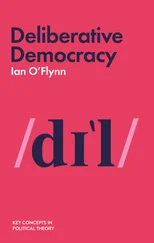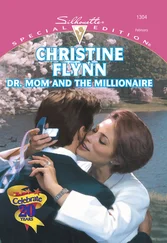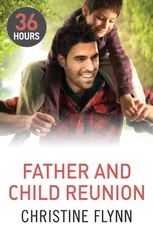— Il paraît qu’il y a des sauterelles par chez vous, lui dit-il. Dommage pour les moissons. Un gars de Sankt Blasien affirme les avoir entendues grésiller sur le Katharinaberg. (Au bout de quelques instants de réflexion, il ajouta :) Il raconte aussi que les moines de chez lui ont chassé un démon. Une hideuse créature qui cherchait à voler des vivres dans leurs réserves. Les moines lui ont tendu un piège durant la nuit et l’ont chassée avec des torches. Le démon a fui vers le Feldberg, mais ces pauvres moines se sont débrouillés pour cramer leur cuisine. (Il se mit à rire de bon cœur.) Ils ont cramé leur cuisine ! Hé ! Vous habitez pas loin du Feldberg. Vous n’avez pas aperçu cette créature, au moins ?
Dietrich secoua la tête.
— Non, nous n’avons rien vu qui lui ressemble.
Le vitrier lui fit un clin d’œil.
— Si vous voulez mon avis, ces moines ont trop bien fêté les vendanges. Moi aussi, je vois des démons quand j’ai trop bu.
Le marché fini, la caravane repartit pour le Hochwald avec des sacs d’or et des rouleaux de tissu, menée par un Everard au sourire satisfait. Dietrich ne l’accompagna pas, car le chaudronnier avait péché par excès d’optimisme.
— Je n’ai pas la filière qu’il faut, insista-t-il. Votre chas est si fin que le fil n’arrête pas de se casser.
L’artisan aurait souhaité que son client se contente d’un fil plus épais, mais celui-ci s’y refusa.
Il n’aimait guère s’attarder, mais, s’ils n’avaient pas leur fil de cuivre, les Krenken ne pourraient jamais partir et il redoutait les conséquences de leur éventuelle découverte. S’ils le retrouvent par hasard, ils auront toujours envie de l’accrocher au bout d’une corde . Il logeait au chapitre de la cathédrale, dînant chaque soir avec Willi et les autres, mais il ne quittait jamais celle-ci par les portes sud et ne s’aventurait jamais sur les berges de la Dreisam, où les cabanes de pêcheurs dominaient un flot que l’automne avait en partie tari. Il priait pour la poissonnière et pour son fils – et aussi pour son homme, si elle s’en était trouvé un –, et il priait aussi pour se rappeler son nom. De temps à autre, il se demandait si elle ne s’était pas moquée de lui, tout simplement. Tout cela s’était déroulé loin du Brisgau. Les murailles de Strasbourg, les sabots des destriers alsaciens, avaient fait disparaître toute trace. Que cette femme ait pu le retrouver ici relevait d’une coïncidence peu plausible. Dieu ne pouvait être cruel à ce point.
Il fallut attendre le jour de la commémoraison de saint Pirmin pour que le fil soit enfin prêt, et Dietrich quitta la ville en compagnie d’un groupe de mineurs en route pour l’Erzkasten, prenant ensuite congé d’eux pour se diriger vers la vallée de Kirchgartner. Là, il tomba sur une caravane en provenance de Bâle, conduite par un juif nommé Samuel de Medina qui était au service du duc Albert.
De Medina lui parut à la fois mielleux et arrogant, mais il était escorté par des hommes d’armes engagés à Fribourg et placés sous le commandement d’un capitaine Habsbourg porteur d’un sauf-conduit signé de la main d’Albert. Ravalant sa fierté, Dietrich s’entretint avec l’intendant du juif, un dénommé Eleazar Abolafia qui, tout comme son maître, s’exprimait dans un espagnol mâtiné d’hébreu.
— Je ne vous interdis pas de nous accompagner, lui dit l’homme d’un air froissé, mais si vous ne pouvez pas suivre le rythme, señor, nous ne vous attendrons pas.
La caravane se mit en route le lendemain matin dans un concert de cliquetis et de grincements, ceux-là émis par les mors des chevaux et ceux-ci par les charrettes. De Medina montait un genet assorti à sa stature tandis qu’Eleazar conduisait une charrette chargée d’un lourd coffre. Deux hommes d’armes à cheval formaient l’avant-garde, deux autres l’arrière-garde. Les autres, qui n’avaient point de montures, se mêlaient aux voyageurs et gardaient l’œil sur la précieuse cargaison. Le groupe se composait d’un marchand chrétien de Bâle, de l’agent d’un négociant en sel viennois et d’un Danois nommé Ansgar, qui portait une pèlerine où étaient cousus les blasons des lieux saints où il s’était rendu. Il venait de Rome et regagnait son pays.
— La peste a quasiment détruit la Ville sainte, dit-il à Dietrich. Nous avons fui dans les collines aux premiers signes d’épidémie et le Ciel a eu pitié de nous. Florence est dévastée, Pise…
— Bordeaux également, intervint Eleazar depuis son perchoir. La peste est apparue sur les quais et Raymond de Bisquale, le maire de la ville, a fait incendier le quartier. C’était… (il compta sur ses doigts) le 2 septembre. Mais le feu s’est répandu dans toute la ville et a détruit le chai de mon maître, ainsi que le château de l’Ombrière où séjournaient les Anglais. La princesse Jeanne devait épouser notre prince. La peste l’avait déjà emportée, m’a-t-on dit, mais le feu a consumé sa dépouille.
Dietrich et le pèlerin se signèrent, et même le juif prit un air chagrin, car la peste tuait indifféremment chrétiens, juifs et Sarrasins.
— Elle n’a pas atteint la Suisse, hasarda Dietrich.
— Non, dit le juif. Bâle était encore épargnée lorsque nous en sommes partis. Et Zurich également – ce qui n’a pas empêché ses habitants de nous en chasser, de crainte que nous ne l’apportions dans ses murs.
— Mais… fit Dietrich, choqué. Le Saint-Père a par deux fois condamné cette pratique.
Eleazar se contenta de hausser les épaules.
Dietrich se laissa distancer par la charrette, se retrouvant en compagnie du marchand bâlois, qui menait par la bride son cheval valaque.
— Ce qu’il ne vous dira pas, murmura-t-il, c’est que les Suisses avaient des raisons d’agir comme ils l’ont fait. Un juif nommé Agimet a avoué avoir empoisonné les puits autour de Genève. Il avait agi sur les ordres des kabbalistes, ainsi que ses complices.
Dietrich se demanda dans quelle mesure cette histoire s’était enjolivée en se transmettant de bouche à oreille. Si la chrétienté avait disposé du parleur à distance des Krenken, elle en aurait été informée dans son ensemble ; cela ne garantissait pas la propagation de la vérité, mais au moins tous entendraient-ils le même mensonge.
— Cet Agimet a-t-il confirmé ses aveux par la suite ?
Le marchand haussa les épaules.
— Non, il n’a cessé de les renier, ce qui prouve bien qu’il mentait ; on l’a donc torturé une seconde fois, ce qui l’a amené à changer d’avis.
Dietrich secoua la tête.
— De telles confessions n’ont rien de convaincant.
Le Bâlois enfourcha sa monture et, dominant Dietrich du haut de sa selle, lui lança :
— Seriez-vous un ami des juifs ?
Dietrich ne répondit point. Le danger était passé, à présent qu’on avait chassé l’air vicié au-delà de Paris ; mais la terreur s’attardait dans les villes épargnées par le mal. La panique se nourrit de rumeurs, le bûcher se nourrit de la panique.
Perdu dans ses pensées, Dietrich se cogna au pèlerin danois qui avait cessé de marcher, et ce fut seulement à ce moment-là qu’il constata que la caravane s’était arrêtée, et que les hommes d’armes censés l’escorter s’étaient joints aux chevaliers brandissant la bannière du faucon qui venaient de l’encercler, l’épée à la main.
Leur capitaine gisait sur le sol, la gorge tranchée. Dietrich se rappela qu’il était arrivé de Bâle avec les juifs, alors que les hommes d’armes avaient été engagés à Fribourg pour veiller sur le coffre. Le mort portait l’aigle des Habsbourg sur son surcot, mais Dietrich n’eut pas le loisir de l’examiner plus avant, car on menait déjà les prisonniers, dociles comme des moutons, vers le sentier conduisant à Falkenstein.
Читать дальше