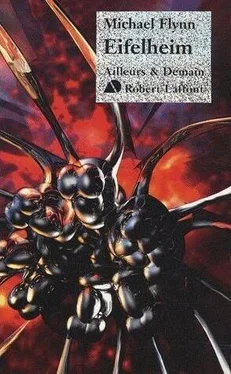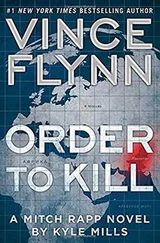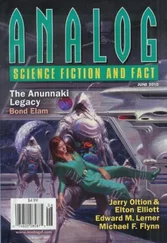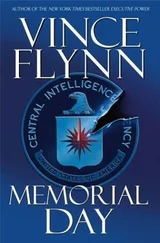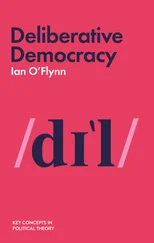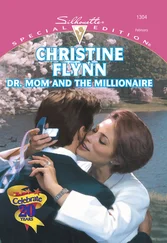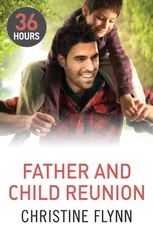Lorsqu’elle eut pris congé, Joachim fit remarquer :
— Elle vous a appelé « mon père ».
— Comme bien d’autres gens, répondit sèchement Dietrich.
— J’ai l’impression que dans sa bouche… cela signifie davantage.
— Ah bon ? Eh bien, elle était ma pupille, si vous voulez le savoir. C’est moi qui l’ai amenée ici alors qu’elle avait dix ans.
— Ach. Vous étiez donc son oncle ? Que sont devenus ses parents ?
Dietrich lui reprit la torche.
— Les Armleder les ont tués. Ils ont brûlé leur maison et tous ses occupants. Seule Theresia a survécu. Je lui ai transmis le savoir que j’avais acquis à Paris et, lorsqu’elle est devenue femme, à l’âge de douze ans, Herr Manfred l’a autorisée à pratiquer son art sur le domaine.
— J’avais toujours pensé…
— Quoi donc ?
— J’avais toujours pensé que leurs griefs étaient fondés. Ceux des Armleder à l’encontre des riches.
Dietrich contempla les flammes de la torche.
— En effet ; mais summum ius, iniuria summa.
Le lundi, Dietrich et Max partirent pour Grosswald afin d’y retrouver Josef le charbonnier et son apprenti, que l’on n’avait pas vus depuis les feux de la Saint-Sixte. La journée s’annonçait chaude, et Dietrich était en nage avant qu’ils aient parcouru la moitié du chemin. Un voile de brume atténuait les feux du soleil, mais cela était à peine sensible. Dans les soles de printemps, où une armée de moissonneurs travaillait sur les terres seigneuriales, Oliver Becker paressait à l’ombre d’un grand chêne, indifférent aux regards sévères de ses pairs.
— Fainéant ! gronda Max lorsque Dietrich eut attiré son attention. Ça se laisse pousser les cheveux comme un jeune Herr. Ça reste assis sur le cul toute la journée pendant que les autres se tapent le boulot, et tout ça parce que ça a les moyens de payer l’amende. En Suisse, tout le monde travaille.
— Ce doit être un pays merveilleux.
Max le gratifia d’un regard soupçonneux.
— Oui. Pas de « mein Herr » chez nous. Quand une question doit être réglée, on rassemble tous les combattants qui votent à main levée, sans qu’un seigneur ait son mot à dire.
— Je croyais que les cantons suisses étaient des fiefs des Habsbourg.
Schweitzer balaya cette objection d’un geste de la main.
— C’est sans doute ce que croit le duc Albert ; mais nous autres montagnards avons une autre opinion… Vous avez l’air pensif, pasteur. Qu’y a-t-il ?
— Je crains que les mains levées de tous ces voisins n’imposent un jour une tyrannie plus pesante que la seule main d’un noble. Quand on a affaire à un seul seigneur, on sait au moins à qui demander des comptes, mais quand la meute tout entière lève la main, qui est le responsable ?
Max partit d’un reniflement.
— Demander des comptes à un seigneur ?
— Il y a quatre ans, les villageois se sont plaints de l’intendant de Manfred lorsqu’il a fermé la sente banale.
— Eh bien, cet Everard…
— Le seigneur doit préserver son honneur. C’est une fiction légale, mais elle a son utilité. Tout comme cette dague passée à votre ceinture. Si elle était plus longue d’un pouce, ce serait une épée, une arme que votre rang ne vous autorise pas à porter.
— On aime bien cette arme en Suisse, dit-il en caressant le pommeau avec un sourire.
— Ce que je veux dire, c’est que Manfred pouvait reprocher à son intendant d’avoir exécuté ses ordres, et que tous auraient fait semblant d’y croire.
Max eut un nouveau geste de la main.
— Le verdict de la bataille de Morgarten était bien plus vigoureux. Ce jour-là, le duc Léopold Habsbourg nous a rendu des comptes, vous pouvez me croire.
Dietrich le fixa du regard.
— Tout ce qui est trop vigoureux produit en guise de fruits des paysans pendus aux branches. Je ne tiens pas à revoir une telle récolte.
— En Suisse, ce sont les paysans qui ont gagné.
— Et cependant vous êtes ici, au service du Herr de Hochwald, qui sert le margrave de Bade et le duc Habsbourg.
À cela, Max ne répondit point.
Ils passèrent le pont qui enjambait le bief et prirent la route conduisant au Bärental, le val de l’Ours. Les jachères se trouvaient sur leur gauche, les soles d’hiver sur leur droite, et la route semblait résulter d’une poussée du sol de part et d’autre, comme une tranchée surélevée. Les haies et les bruyères qui la bordaient, censées protéger les terres arables des bestiaux errants, donnaient également un peu d’ombre aux deux marcheurs ; elles prenaient racine à une telle hauteur qu’on eût dit de véritables arbres. La chaussée, transformée en bourbier par un ruisseau qui se jetait dans le bassin de retenue du moulin, avait un tracé des plus sinueux, dicté par la nature chaotique du terrain. Dietrich s’était souvent demandé quel genre d’endroit était le Bärental pour que les voyageurs fussent si réticents à s’y rendre.
Aux abord de la pâture banale, la route perdait ses allures de tunnel pour se poursuivre à ciel ouvert sur une colline en pente douce, l’un des premiers contreforts du Katharinaberg. À présent que les haies n’étaient plus là pour les protéger, le soleil faisait fortement sentir sa présence. Quelqu’un avait ouvert le portail entre la pâture banale et les soles d’hiver afin que les vaches puissent brouter l’herbe et fertiliser la terre avec leurs bouses.
Depuis le point relativement élevé où ils se trouvaient, un pré à l’herbe constellée de pâquerettes, ils apercevaient la ferme de Heinrich Altenbach, sur la route de Hirschsprung, le Saut-du-Cerf. Plusieurs années auparavant, il avait quitté le domaine pour assécher des marais, dont l’emprise n’était revendiquée par aucun seigneur. Altenbach s’y était bâti un cottage afin de ne plus être contraint de gagner quotidiennement ses champs à pied.
— Tout homme préférerait vivre sur ses terres, je suppose, dit Max lorsque Dietrich attira son attention sur la ferme. À condition qu’il soit aussi propriétaire de ses bêtes et de sa charrue, et qu’il ne souhaite pas les partager avec son voisin. Mais le château lui paraîtrait fort loin si une armée venait à passer par ici, et peut-être que ses voisins refuseraient de lui ouvrir la porte.
À l’autre bout du pré, la forêt luisait d’un doux éclat noir. De fins plumets de fumée blanche montaient parmi les bouleaux, les pins et les chênes. Dietrich et Max s’arrêtèrent à l’ombre d’un chêne solitaire pour boire un peu d’eau à leurs gourdes. Dietrich avait quelques châtaignes dans sa bourse, et il les partagea avec le sergent. Ce dernier étudia les filets de fumée avec une attention extrême, jonglant avec les châtaignes comme s’il s’agissait d’osselets.
— Il est facile de se perdre par ici, commenta Dietrich.
— Ne vous éloignez jamais des coulées, répliqua Max d’un air distrait. Ne vous enfoncez jamais dans les fourrés.
Il pela une châtaigne et la fourra dans sa bouche.
Il faisait plus frais dans la forêt que dans le pré. Le soleil n’y pénétrait que par endroits, mouchetant de lumière coudriers et campanules. Au bout de quelques pas à peine, Dietrich eut l’impression de s’y engloutir. Les bruits venus des champs se firent lointains, puis étouffés, puis disparurent tout à fait. Max et lui s’avançaient parmi les chênes, les mélèzes et les épicéas, faisant bruire sous leurs pieds un tapis de feuilles mortes. Totalement désorienté, Dietrich veilla à rester tout près du sergent.
L’air sentait la cendre et la fumée froide, mais on y percevait aussi un fumet composite, sel, urine et soufre mélangés. Ils foulèrent bientôt une terre brûlée. Des braises luisaient encore dans les troncs fendillés, n’attendant qu’un coup de vent pour engendrer des flammes. Des petits animaux calcinés étaient pris dans les buissons.
Читать дальше