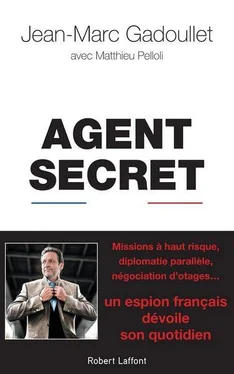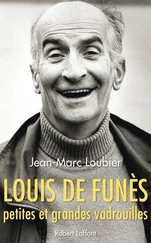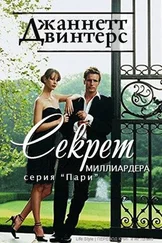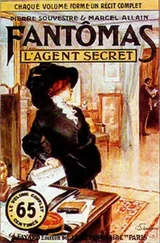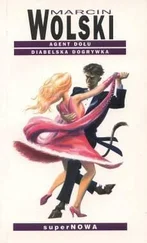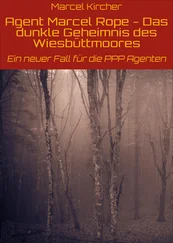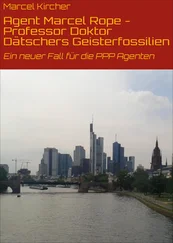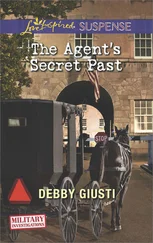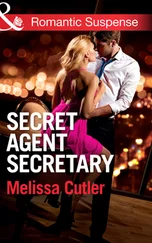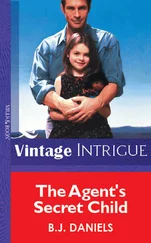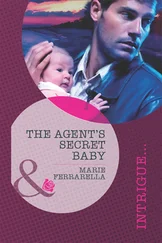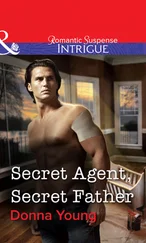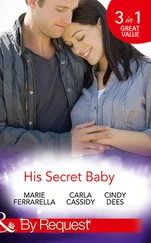L’habit ne fait pas le moine, l’uniforme impeccable fait peut-être le militaire mais pas forcément le soldat. Au CPIS, l’aspect « tout le monde dans le rang », le côté « pas un bout de treillis qui dépasse » rebute beaucoup plus qu’il ne fascine. L’uniformité formelle n’est pas dans notre culture, pas plus que l’obéissance aveugle et soumise. Les légionnaires qui nous rendent visite sont d’ailleurs désarçonnés par ce qui pourrait apparaître au premier abord comme un manque de discipline. Je me souviens de l’un d’eux, très sûr de lui à son arrivée à Perpignan. Son raisonnement était simple : « Je suis officier, issu de la Légion, je suis nécessairement compétent et je vais vous le montrer. » Il a très vite déchanté. « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert », écrivait André Malraux. Au CPIS, il en va de même pour le respect dû à chaque équipier, officiers compris. Il n’est pas gratuitement cousu sur les épaules, en même temps que les galons, que nous ne portons d’ailleurs pas forcément. Nous ne sommes pas constamment au garde-à-vous.
« Mes respects, mon lieutenant », « Mes respects, mon capitaine », « Mes respects, mon colonel ». Nous, nous ne perdons pas notre temps à nous saluer solennellement. Cela ne fonctionne pas comme ça. Il n’y a que des équipiers et des moniteurs combat spécialisé, et quand on se croise, un hochement de tête, un sourire entendu ou un clin d’œil suffit amplement. De plus — les accros à la tradition militaire s’étrangleront définitivement —, nous arborons la plupart du temps des tenues dépareillées. Les couleurs qui jurent, cela n’a jamais inquiété personne à l’intérieur de la citadelle. Une veste de camouflage peut très bien être agrémentée d’un pantalon militaire blanc immaculé pour la haute montagne. Partout ailleurs, l’arlequin se ferait taper sur les doigts et serait bon pour les corvées. Au CPIS, pas une remarque, même pas pour rigoler. Et si le vouvoiement se pratique, il est également fréquent que les équipiers se tutoient tous grades confondus ! Là encore, c’est un choc de culture inaccessible pour certains militaires.
Mauvais garçons mal habillés ? Fortes têtes allergiques à l’autorité ? En réalité, la première impression est trompeuse. Sans que personne ne donne jamais d’ordre, la discipline est absolue. Dans l’entraînement quotidien au tir ou au maniement d’explosifs, lors des exercices de reconnaissance, les équipiers sont extrêmement professionnels. Les premières semaines, je suis saisi par le silence. Mon expérience dans les unités où j’ai fait mes classes est plutôt celle d’un chef en train de s’époumoner au milieu des troupes : « Fais ci, attrape ça, va là-bas. » Ici, le calme est stupéfiant, l’atmosphère presque religieuse.
Lorsqu’un chef fixe un rendez-vous à 8 heures, le lendemain matin, tout le monde se présente à l’heure convenue. Jamais d’absents, jamais de retardataires. Les équipiers s’activent comme autant d’automates parfaitement réglés, chacun sait ce qu’il doit faire. Ils ont tous apporté le matériel nécessaire, rien ne manque. Je regarde, j’apprends, j’évolue entouré de professionnels qui dégagent une impression de sérénité et de grande autonomie. L’action collective s’enclenche, puis un mouvement en appelle naturellement un autre. Personne ne hurle, personne ne roule des mécaniques. Les équipiers sont sûrs de leur force, ils n’ont pas besoin d’en faire étalage. Ils sont affûtés, précis, les automatismes entre eux ont été réglés au micron près par les heures et les heures d’entraînement. Ce sont des soldats redoutables, mais ils ne jouent pas les gros durs. L’ambiance est… à la cool.
L’entraînement physique est quotidien. Tous les matins, sport obligatoire jusqu’à 10 h 30. Nous nous entraînons surtout dans la citadelle, même s’il nous arrive d’aller courir sur le bord de mer. Il y a bien quelques haltères, mais elles font peu d’adeptes. L’objectif est de développer l’endurance, la souplesse, l’adresse, les réflexes, pas d’acquérir un physique d’hercule de foire. La citadelle, l’ancien palais des rois de Majorque, une superbe forteresse de style gothique achevée au tout début du XIV e siècle, est notre refuge. C’est le cœur nerveux du CPIS. Elle abrite nos bureaux administratifs, nos salles logistiques, nos salles de préparation des missions, mais aussi les armureries, quelques stocks de munitions et surtout des matériels de guerre.
Pendant la formation initiale qui dure plus d’un an, je ne rentre pas chez moi le soir, car j’ai laissé ma famille dans les Landes en attendant d’y voir un peu plus clair… Je suis très impliqué tout en restant décontracté. J’ai du temps et je le consacre tout entier à ma préparation. La formation de guerre spéciale comprend trois grands axes qui intègrent constamment, je l’ai dit, les deux esprits Jedburgh et choc : la formation sécurité individuelle et collective qui inscrit les équipiers dans le cadre opérationnel clandestin avec une sensibilité insurrectionnelle ou contre-insurrectionnelle, la formation action armée, et les formations milieux que sont le désert, la jungle et la montagne été comme hiver.
Au bout d’un an et de nombreux écrémages, les équipiers sont capables d’évoluer au sein d’un détachement et prendre le ton opérationnel de la maison : la reconnaissance, l’intervention furtive et le choc, l’action armée en force, y compris en milieux confinés. Les exercices qui visent à former des équipiers de guerre spéciale portent donc très largement sur les armes à feu. La citadelle possède de vastes champs d’entraînement au tir. Nous fabriquons des maquettes d’objectifs avec de vieux pneus, sur lesquelles nous effectuons des phases d’actions qui ont été réalisées dans le passé.
Nous disposons d’armes françaises, mais aussi beaucoup d’étrangères. Au CPIS l’idée est d’avoir entre les mains tous les armements utilisés aux quatre coins du monde et susceptibles d’être récupérés sur le terrain dans un cadre clandestin ou dans un milieu insurrectionnel. M16, kalachnikov, SIG-Sauer, FAL (fusil automatique léger), fusil-mitrailleur, fusil de tireur d’élite, lance-roquettes : je me sens à l’aise avec chacun. Il faut savoir les démonter, les nettoyer et les remonter, de jour comme de nuit. La première année, j’effectue des journées complètes au tir, de midi à minuit, mais aussi de longues sessions nocturnes. Tous les tirs sont effectués à balles réelles, et avec l’équipement de combat, y compris le sac à dos. Il faut pouvoir se plaquer au sol, appuyer son équipier, discriminer la cible… À la fin de chaque séance, j’entends le cliquetis du tapis de cartouches sur lequel je marche. Pendant un an, je tire des milliers et des milliers de balles. Bien sûr, il ne s’agit pas de consommer des munitions pour le plaisir, mais d’acquérir des réflexes, de posséder un niveau d’aisance maximum qui permet de ne jamais oublier. Pour devenir une fine gâchette sans avoir recours aux artifices techniques de type pointeur laser, je ne connais qu’une seule méthode : pratiquer. Cependant les périphériques de l’arme sont très répandus maintenant et il n’est plus très original de s’en procurer.
Sur le terrain, ces heures passées à s’entraîner peuvent vous sauver la vie. Elles sont également indispensables pour évoluer en formation, être un équipier sûr pour son environnement et ses partenaires. En mission, un détachement peut en effet être amené à faire feu dans toutes les conditions. Soit lors d’un assaut, soit lors d’un repli, avec des tirs de rupture de contact. Le groupe doit attaquer ou riposter de façon organisée, sous peine de toucher l’un de ses propres membres. Au bout d’un an, je suis très performant l’arme à la main, comme tous les équipiers, et chacun sait se comporter collectivement dans une opération sans risque de blesser le voisin.
Читать дальше