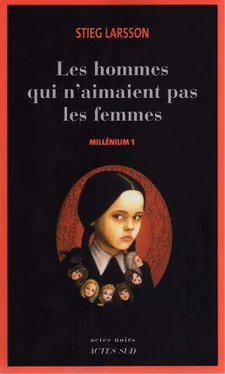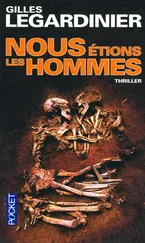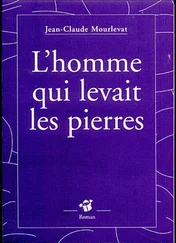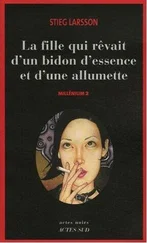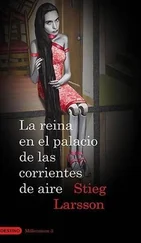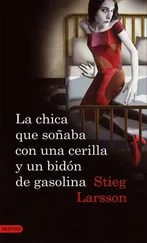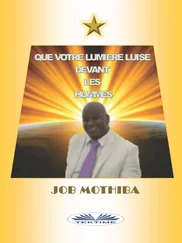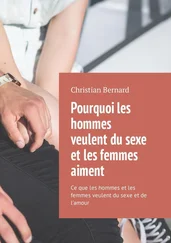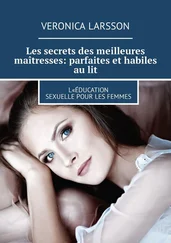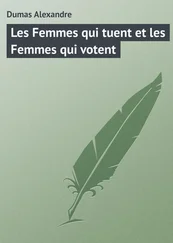Henrik Vanger leva un quatrième doigt.
— Ne reste qu'une seule possibilité vraisemblable, en l'occurrence que Harriet a disparu contre son gré. Quelqu'un lui a fait du mal et s'est débarrassé du corps.
LISBETH SALANDER PASSA le matin du jour de Noël à lire le livre controversé de Mikael Blomkvist sur le journalisme économique. Le livre comportait deux cent dix pages, il était intitulé Les Templiers et sous-titré Le journalisme économique en question. La couverture, au design très tendance, signée Christer Malm, représentait la Bourse de Stockholm. Christer Malm avait travaillé sur Photoshop et il fallait un moment à l'observateur pour se rendre compte que le bâtiment flottait librement dans l'air. Il n'y avait pas de fond. On pouvait difficilement imaginer couverture plus explicite et efficace pour donner le ton de ce qui allait suivre.
Salander constata que Blomkvist était un excellent styliste. Le livre était écrit d'une manière directe et engageante, et même des gens non informés des dédales du journalisme économique pouvaient le lire et en tirer bénéfice. Le ton était mordant et sarcastique, mais surtout convaincant.
Le premier chapitre était une sorte de déclaration de guerre où Blomkvist ne mâchait pas ses mots. Les analystes économiques suédois étaient ces dernières années devenus une équipe de larbins incompétents, imbus de leur propre importance et totalement incapables dé la moindre pensée critique. Mikael tirait cette dernière conclusion en montrant à quel point tant de journalistes économiques se contentaient tout le temps et sans la moindre objection de reproduire les affirmations livrées par les directeurs de société et par des spéculateurs en Bourse — même quand ces affirmations étaient manifestement fallacieuses et erronées. De tels journalistes étaient donc soit si naïfs et crédules qu'il aurait fallu les virer de leurs postes, soit, pire encore, des gens qui trahissaient sciemment leur mission journalistique en omettant de procéder à des examens critiques et de fournir au public une information correcte. Blomkvist écrivait qu'il avait souvent honte d'être qualifié de journaliste économique, puisqu'il risquait d'être confondu avec des personnes qu'il ne considérait même pas comme des journalistes.
Blomkvist comparait les contributions des analystes économiques au travail des journalistes chargés des affaires criminelles ou des correspondants à l'étranger. Il dressait un tableau des protestations qui s'élèveraient si un journaliste juridique d'un grand quotidien se mettait à citer sans la moindre critique les affirmations du procureur, les donnant pour automatiquement véridiques, par exemple dans le procès d'un assassinat, sans se procurer de l'information du côté de la défense et sans interroger la famille de la victime pour se faire une idée de ce qui était plausible et non plausible. Il disait que les mêmes règles devaient s'appliquer aux journalistes économiques.
Le reste du livre constituait la chaîne de preuves renforçant le discours d'introduction. Un long chapitre passait au crible le rapport sur une start-up dans six quotidiens majeurs ainsi que dans Finanstidningen, Dagens Industri et à A-ekonomi à la télé. Il citait et additionnait ce que les reporters avaient dit et écrit avant de comparer avec la situation réelle. Décrivant le développement de l'entreprise, il citait plusieurs fois des questions simples qu'un journaliste sérieux aurait posées mais que la troupe réunie des spécialistes de l'économie avait omis de poser. Bien joué !
Un autre chapitre parlait du lancement de la privatisation de Telia — c'était la partie la plus railleuse et ironique du livre, où quelques correspondants économiques nommément cités étaient littéralement taillés en pièces, parmi eux un certain William Borg, contre qui Mikael semblait particulièrement remonté. Un autre chapitre, vers la fin du livre, comparait le niveau de compétence des journalistes économiques suédois et étrangers. Blomkvist décrivait comment des journalistes sérieux du Financial Times, de l'Economist et de quelques journaux économiques allemands avaient rapporté les mêmes sujets dans leurs pays. La comparaison n'était pas à l'avantage des journalistes suédois. Le dernier chapitre contenait une esquisse de proposition pour redresser cette situation lamentable. La conclusion du livre renvoyait à l'introduction :
Si un reporter au Parlement s'acquittait de sa tâche de la même façon, en soutenant sans la moindre critique chaque motion adoptée, fût-elle totalement insensée, ou si un journaliste politique devait faillir en son jugement d'une façon semblable, alors ce journaliste serait licencié ou au moins muté dans un service où il ou elle ne pourrait pas nuire autant. Dans le monde des journalistes économiques, ce n'est cependant pas la mission journalistique normale qui a cours, à savoir procéder à des examens critiques et faire un rapport objectif des résultats aux lecteurs. Non, ici on célèbre l'escroc qui a le plus réussi. Et c'est ici également qu'est créée la Suède du futur et qu'on sape la dernière confiance qu'on éprouve encore pour les journalistes en tant que corps de métier.
On était loin des boniments. Le ton était âpre et Salander n'avait aucune difficulté à comprendre le débat houleux qui avait suivi aussi bien dans Journalisten, l'organe de la branche, dans certains journaux d'économie et dans les articles de fond et d'économie des quotidiens. Même si seul un nombre restreint de journalistes économiques étaient nommés dans le livre, Lisbeth Salander supposait que la branche était suffisamment petite pour que tout le monde comprenne exactement qui était visé quand les différents journaux étaient cités. Blomkvist s'était fait de sérieux ennemis, ce qui se reflétait aussi dans des douzaines de commentaires qui se réjouissaient méchamment du verdict dans l'affaire Wennerström.
Elle referma le livre et regarda la photo de l'auteur en quatrième de couverture. Mikael Blomkvist était photographié de trois quarts. La frange châtain clair balayait négligemment son front, comme si un souffle de vent était passé juste quand le photographe avait appuyé sur le bouton, ou comme si (plus probable) le graphiste Christer Malm l'avait relooké. Il fixait l'objectif avec un sourire ironique et un regard qui se voulait sans doute charmeur et polisson. Assez bel homme, le gars. Barré pour trois mois de prison.
— Salut, Super Blomkvist, dit-elle à haute voix. On dirait que tu te la joues un peu, non ?
VERS MIDI, LISBETH SALANDER alluma son iBook et ouvrit le programme de courriel Eudora. Elle ne tapa qu'une seule ligne éloquente :
[T'as le temps ?]
Elle signa Wasp et envoya son mail à l'adresse Plague_xyz_666@hotmail.com. Par précaution, elle passa par le programme de cryptage PGP.
Ensuite, elle enfila un jean noir, de grosses chaussures d'hiver, un col roulé chaud, un parka de marin sombre et des gants, un bonnet et un foulard du même jaune pâle. Elle ôta les anneaux de ses sourcils et de la narine, mit un rouge à lèvres rose pâle et s'examina dans le miroir de la salle de bains. Elle ressemblait à n'importe quel promeneur du dimanche et elle estimait que sa tenue était un camouflage de combat honnête pour une expédition derrière les lignes ennemies. Elle prit le métro de Zinkensdamm à Östermalmstorg, puis se dirigea à pied vers Strandvägen. Elle marcha dans l'allée centrale tout en lisant les numéros sur les immeubles. Presque arrivée au pont de Djurgården, elle s'arrêta et contempla la porte qu'elle cherchait. Elle traversa la rue et attendit à quelques mètres de l'entrée.
Elle constata que la plupart des gens qui se promenaient par ce temps frais du lendemain de Noël marchaient sur le quai, et que seules quelques rares personnes utilisaient le trottoir devant les immeubles.
Читать дальше