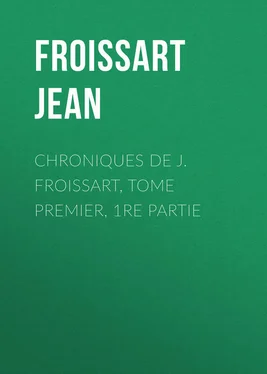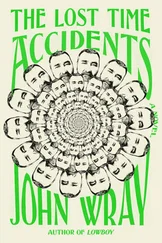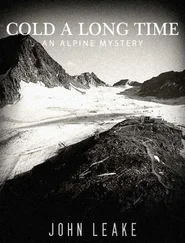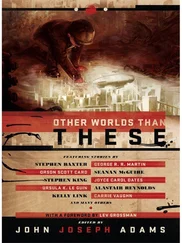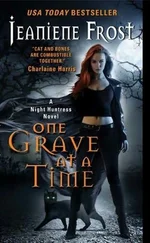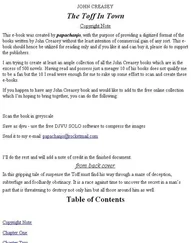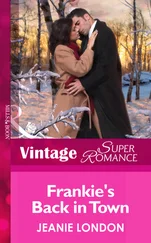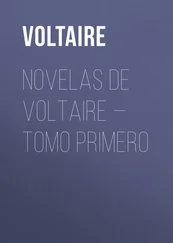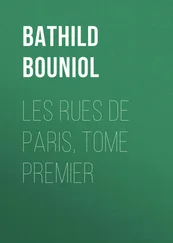Jean Froissart - Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie
Здесь есть возможность читать онлайн «Jean Froissart - Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: foreign_antique, foreign_prose, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Pour toute la partie du premier livre, comprise entre le retour d'Isabelle en Angleterre en 1326 et la reddition de la Rochelle en 1372, les première et seconde rédactions offrent encore çà et là des parties communes; on peut dire néanmoins qu'entre ces deux dates la seconde rédaction est profondément distincte de la première dans le fond aussi bien que dans la forme.
On a vu dans le chapitre précédent que la première rédaction s'est formée successivement et par parties. Il ne semble pas qu'il en ait été ainsi de la seconde; du moins on ne distingue dans le ms. d'Amiens aucune trace de ces lacunes, de ces sutures si visibles dans les exemplaires de la première.
A quelle date a été composée la seconde rédaction? La réponse à cette question a été faite plus haut 74 74 Voyez chap. I, § 1, p. VII à IX .
, mais il importe de reproduire ici textuellement les deux passages des manuscrits d'Amiens et de Valenciennes qui ont dicté cette réponse. On lit dans le ms. d'Amiens: «Et puis fu chils enfez prinche de Gallez et très bons, hardis et entreprendans chevaliers et qui durement et fierement guerria tant qu'il vesqui; mès il mourut dès le vivant le roy son père , ensi comme vous orez en ceste histoire 75 75 P. 349.
.» F o20. Ce passage se retrouve en abrégé dans le ms. de Valenciennes: «… et fist en France et ailleurs moult de beaux fais d'armes, et mourut josne du vivant son père 76 76 P. 349, en note.
.» F o42. Ainsi dès les premiers feuillets des manuscrits d'Amiens et de Valenciennes il est fait mention de la mort du prince de Galles qui eut lieu en 1376: on est forcé d'en conclure que la seconde rédaction n'a pu être composée qu'après cette date.
Rien n'autorise à supposer que le passage dont il s'agit est le résultat d'une interpolation; outre que cette supposition serait gratuite, un détail matériel du manuscrit d'Amiens la rend tout à fait inadmissible. Les premiers feuillets de ce ms. présentent un caractère particulier qui frappe le lecteur: la plupart des noms propres y sont laissés en blanc 77 77 Voyez nos variante, p. 211, 213, 217, etc. Les lacunes du manuscrit d'Amiens ont été comblées à l'aide du texte de Valenciennes.
ou bien ils sont affreusement estropiés. On y lit, par exemple: «Phelippes de Valeur 78 78 P. 211, l. 14.
» pour «Phelippes de Valois.» Ces lacunes ou ces erreurs grossières sont d'autant plus étranges qu'on les rencontre seulement dans les premiers feuillets et que le manuscrit est du reste exécuté avec beaucoup de soin. On parvient à les expliquer en supposant que le copiste avait sous les yeux un brouillon en écriture cursive plus ou moins illisible dont il n'avait pas encore l'habitude quand il a écrit ces premiers feuillets: il a deviné d'abord plutôt qu'il n'a lu les mots ordinaires; les noms propres sont les seuls que le contexte n'aide pas à déchiffrer, c'est pourquoi il les a estropiés ou laissés en blanc; puis, il s'est vite accoutumé à ce grimoire, il en a trouvé la clef, et alors les lacunes et les bévues monstrueuses ont disparu presque entièrement de sa copie. En même temps que ces lacunes attestent chez le copiste le désir de reproduire servilement et scrupuleusement le modèle, elles font supposer que ce modèle était un autographe ou du moins un original en caractères tracés à la hâte sous la dictée de Froissart, car l'écriture des manuscrits de cette époque exécutés à loisir par des scribes proprement dits est généralement plus ou moins posée et dans tous les cas très-lisible.
Cette explication est trop naturelle pour ne s'être pas déjà présentée à l'esprit des érudits qui ont examiné le manuscrit d'Amiens. «Le manuscrit d'Amiens, dit M. Rigollot, a été copié avec beaucoup de scrupule, peut-être sur un manuscrit autographe ; on remarque sur le premier feuillet que plusieurs mots sont restés en blanc, probablement parce que le copiste n'avait pu les lire sur les premières pages de l'original qui auront été plus usées que les autres 79 79 Mémoire sur le manuscrit de Froissart de la ville d'Amiens et en particulier sur le récit de la bataille de Crécy, par M. Rigollot, dans le t. III des Mémoires de la société des antiquaires de Picardie , p. 133, en note.
.» On ne saurait donc attribuer à une interpolation le passage qui mentionne dès les premiers feuillets des manuscrits d'Amiens et de Valenciennes la mort du Prince Noir; d'où il suit, pour le répéter encore une fois, que la seconde rédaction est dans toutes ses parties postérieure à 1376.
Cette date de 1376 nous amène à l'époque où les liens les plus étroits qui unissaient Froissart au pays adoptif de Philippe de Hainaut, à la patrie du Prince Noir, sont désormais rompus; c'est aussi le temps où la France se relève grâce à la sagesse de Charles V, à l'épée de Duguesclin et fait reculer de jour en jour ses envahisseurs. Lorsque l'auteur des Chroniques composa de 1369 à 1373 la partie de sa première rédaction antérieure à ces deux dates, il venait de passer huit années à la cour d'Angleterre; il avait entendu raconter par des chevaliers de cette nation les victoires qui avaient porté si haut la gloire d'Édouard III, notamment celles de Crécy et de Poitiers: enfin le récit même qu'il entreprenait lui était commandé, il a soin de nous le dire dans le prologue, par ce Robert de Namur qui, entré au service du roi son beau-frère depuis le siége de Calais en 1346, combattait encore dans les rangs des Anglais à la chevauchée de Tournehem en 1369. Qui s'étonnerait après cela que Froissart ayant vécu si longtemps dans un pareil milieu et resté soumis à la même influence nous ait donné presque toujours dans sa première rédaction la version anglaise des grands événements de cette période et entre autres du siége de Calais, des batailles de Crécy et de Poitiers! Qui ne comprend que le peintre a pu sans parti pris faire prédominer la couleur anglaise dans ses tableaux! Comme cette couleur se présentait seule sous sa palette, elle est venue pour ainsi dire d'elle-même s'empreindre sur la toile.
Mais après 1376 nous trouvons le curé des Estinnes, le poëte de Wenceslas, le chapelain du comte de Blois placé dans un tout autre milieu, soumis à des influences bien différentes. Wenceslas de Luxembourg, duc de Brabant, était fils de cet héroïque roi de Bohême qui avait voulu, quoique aveugle, se faire tuer à Crécy en combattant pour la France. «Wenceslas, dit excellemment M. Pinchart, quoique d'origine allemande, avait reçu, comme ses prédécesseurs, une éducation toute française. Il introduisit au palais de Bruxelles bien des changements calqués sur la cour des rois de France qu'il avait souvent visitée: entre autres voyages qu'il y fit, Jeanne et lui furent présents au sacre de Charles V à Reims en 1364; ils avaient même pour ce prince une affection telle qu'ils portèrent le deuil à sa mort 80 80 Études sur l'histoire des arts au moyen âge , par Pinchart, p. 17 et 18.
.»
La cour de Gui II de Châtillon était encore plus propre que celle de Wenceslas à dépayser les affections, les préventions de l'ancien clerc de la reine Philippe et à diminuer l'ascendant de ses souvenirs anglais. Champenoise d'origine et chevaleresque entre toutes, l'illustre maison de Châtillon à laquelle appartenait Gui était vraiment deux fois française. Le père de Gui, Louis de Châtillon avait succombé à Crécy sous les coups des Anglais; et sa mère, Jeanne de Hainaut était la fille unique de Jean de Hainaut qui, rallié à la France, s'était tenu constamment aux côtés de Philippe de Valois dans la désastreuse journée du 26 août 1346. Gui lui-même avait été donné en otage au roi d'Angleterre à l'occasion de la mise en liberté du roi Jean; et pour se racheter il avait dû céder par un contrat passé à Londres le 15 juillet 1367 son comté de Soissons à Enguerrand, sire de Coucy. Fait plus tard chevalier pendant une croisade contre les païens de la Prusse, Gui s'était joint en 1370 aux ducs de Berry et d'Anjou et avait pris part en Guyenne à la guerre contre les Anglais; en 1382 enfin il commandait l'arrière-garde de l'armée française à Roosebecke. Écrite certainement après 1376 et probablement de 1376 à la fin de 1383, époque où mourut Wenceslas et où Froissart fut attaché définitivement au service de Gui de Blois, la seconde rédaction a été composée dans le milieu, sous la double influence que nous venons d'indiquer; et si l'auteur ne l'a pas fait précéder d'une dédicace comme il en avait mis une dans le prologue de la première, ne serait-ce point parce qu'il lui répugnait de manifester une préférence entre deux puissants protecteurs dont il avait également à se louer et qui avaient prodigué l'un et l'autre à son œuvre leurs encouragements 81 81 Un extrait des comptes du receveur de Binche, publié par M. Pinchart, constate que, le 25 juillet 1382, le duc de Brabant fit don d'une somme de dix francs valant douze livres dix sous «à messire Jehan Froissard, curet de Lestinnez ou Mont, pour un livre qu'il fist pour monseigneur .» Qui sait si ce livre n'était pas un exemplaire de la seconde rédaction du premier livre?
?
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Chroniques de J. Froissart, Tome Premier, 1re partie» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.