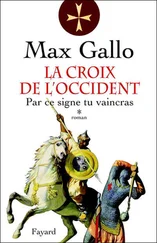Max Gallo - L'âme de la France
Здесь есть возможность читать онлайн «Max Gallo - L'âme de la France» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, fra. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:L'âme de la France
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
L'âme de la France: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «L'âme de la France»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
L'âme de la France — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «L'âme de la France», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
L'âme de la France, c'est dans les paysages de ses terroirs qu'elle gît désormais. On la rencontre au sommet de la roche de Solutré ou sur le mont Beuvray, site de la ville gauloise de Bibracte où Mitterrand avait songé à se faire inhumer, achetant même à cette fin un carré de cette terre, de cette histoire.
Mais l'indépendance, la souveraineté de la nation, que sont-elles devenues ?
Mitterrand enrichit Paris de monuments. Il croit donc à la pérennité de la capitale de la France.
Mais est-elle pour lui un centre d'impulsion politique au rayonnement mondial, ou seulement un lieu de promenades touristiques et gastronomiques dont ce gourmet de la vie sous toutes ses formes était particulièrement friand ?
L'âme de la France ne doit-elle plus être que cela : une mémoire qu'on visite comme un musée ?
Au fond, durant deux septennats, François Mitterrand a fait à son peuple la « pédagogie du renoncement tranquille ».
Et le peuple, de manière instinctive, en s'abstenant aux élections, en changeant de représentants, en votant pour les « irréguliers », a protesté, s'est débattu comme un homme qui refuse les somnifères et ne veut pas renoncer à son âme.
Et qui s'indigne qu'au moment où toutes les nations renaissent on veuille que l'une des plus anciennes et des plus glorieuses s'assoupisse.
72.
De 1995 à 2007, d'un siècle à l'autre, la question de la France est posée.
Comme aux moments les plus cruciaux de son histoire – guerre de Cent Ans ou guerres de Religion, « étrange défaite » de 1940 –, c'est de la survie de son âme qu'il s'agit.
C'est dire que le bilan de la double présidence de Jacques Chirac – 1995-2002-2007 – ou du quinquennat au poste de Premier ministre de Lionel Jospin (1997-2002), dans le cadre de la plus longue période de cohabitation de la V e République, ne saurait se limiter à évaluer les qualités et les faiblesses des deux chefs de l'exécutif, ou à mesurer l'ampleur des problèmes qu'ils ont été conduits à affronter dans un environnement international qui change totalement de visage et pèse sur la France.
En 1995, on imaginait encore, malgré la guerre du Golfe contre l'Irak, un avenir de paix mondiale patronnée par l'hyperpuissance américaine.
En fait, la guerre sous toutes ses formes a rapidement obscurci l'horizon. Bombardement et destruction de villes européennes (Dubrovnik, Sarajevo, puis Belgrade écrasée sous les attaques aériennes de l'OTAN en 1999). Et la France s'est engagée dans ce conflit des Balkans contre ses alliés traditionnels, les Serbes au nom du « droit d'ingérence ».
Elle est aussi concernée, comme toutes les puissances occidentales, par l'attaque réussie contre les États-Unis (World Trade Center, 11 septembre 2001).
« Nous sommes tous américains », affirme le directeur du Monde – et la France s'engage dans la guerre contre l'Afghanistan (2002).
Mais elle conteste l'intervention des États-Unis et de leurs alliés en Irak en 2003.
La posture de Chirac, le discours de son ministre des Affaires étrangères, Villepin, au Conseil de sécurité de l'ONU, semblent réactiver une politique extérieure « gaullienne », la France apparaissant comme le leader des pays qui tentent de conserver un espace de dialogue entre les deux civilisations, musulmane et chrétienne.
Ce n'est néanmoins, dans la politique étrangère française, qu'une séquence, certes majeure, mais contredite par d'autres attitudes. Comme si Chirac, plus opportuniste que déterminé, hésitait à élaborer une voie française.
Il est vrai que son choix a suscité dans les élites françaises des critiques nombreuses. On a dénoncé son « antiaméricanisme ».
Par ailleurs, la radicalisation de la situation mondiale se poursuit : attentats de Madrid et de Londres (2004-2005) ; reprise des violences en Afghanistan ; guerre civile en Irak ; guerre entre Israël et le Hezbollah aux dépens du Liban en 2006 ; ambitions nucléaires de l'Iran ; pourrissement de la question palestinienne.
La France hésite, condamne l'idée d'un choc des civilisations entre l'islamisme et l'Occident.
Chirac craint que cet affrontement ne provoque des tensions – elles existent déjà, mais restent marginales – entre des Français d'origines et de confessions différentes.
La France semble donc incertaine, la situation internationale mettant à l'épreuve sa capacité à résister aux forces extérieures.
L'inquiétude se fait jour de voir renaître des « partis de l'étranger », l'appartenance à telle ou telle communauté apparaissant, pour des raisons religieuses, plus essentielle que la spécificité française.
Ainsi se trouve posée la question de la « communautarisation » de la société nationale.
Or, de 1995 à 1997, de nombreux indices ont montré qu'elle était en cours.
On a vu le Premier ministre Lionel Jospin conclure avec les nationalistes corses des accords de Matignon – un « relevé de conclusions » – sans que ses interlocuteurs aient renoncé à légitimer le recours à la violence et à revendiquer l'indépendance.
En acceptant d'ouvrir des discussions avec eux – pas seulement pour des raisons électorales : la présidentielle de 2002 est proche –, Jospin reconnaît de fait la pertinence de la stratégie nationaliste et la thèse d'une Corse colonisée et exploitée par la France.
Or – toutes les élections le montrent – les nationalistes ne représentent qu'une minorité violente, s'autoproclamant représentative du « peuple corse », tout comme les gauchistes affirmaient naguère qu'ils étaient l'expression de la classe ouvrière.
Cette reconnaissance par le Premier ministre, avec l'assentiment tacite du président de la République, et par toutes les « élites » politiques de ce pays – exception faite de quelques « irréguliers » comme Jean-Pierre Chevènement – est lourde de sens.
Le 6 février 1998, en effet, le préfet de Corse, Claude Érignac, a été tué d'une balle dans la nuque à Ajaccio par des nationalistes.
Toutes les autorités républicaines et la population corse ont condamné ce crime hautement symbolique. Le préfet représente l'État centralisé – napoléonien, mais héritier de la monarchie. L'abattre, c'est, par la lâcheté du crime et par sa signification, atteindre l'État, la France, marquer que l'on veut les « déconstruire ».
Accepter que les porte-parole de ces criminels non repentis négocient à Matignon, c'est capituler, admettre, à terme, la fin de la République une et indivisible.
Ceux qui dirigent l'État entre 1995 et 2007 – qu'ils appartiennent au parti chiraquien ou à la « gauche plurielle » – ont jugé que l'espoir de paix civile valait l'abandon des principes républicains.
D'autres signes jalonnant la marche vers une société française communautarisée se multiplient entre 1995 et 2007.
La création du Conseil français du culte musulman, les nombreuses critiques émises au moment de la loi interdisant le port du voile islamique dans certaines conditions, la création d'associations se définissant par leurs origines (Conseil représentatif des associations noires, Indigènes de la République, etc.) sont, quelles que soient les intentions de leurs initiateurs, la preuve de l'émiettement désiré de l'identité française.
Et déjà surgissent – avivées par la situation internationale – des rivalités entre ces communautés.
C'est bien l'« âme de la France » qui se retrouve ainsi contestée dans l'un de ses aspects essentiels : « l'égalité entre les individus liés personnellement à la nation, sans le “filtre” et la médiation d'une représentation communautaire, éthique ou religieuse ».
Le même processus de « déconstruction nationale » est à l'œuvre dans la plupart des secteurs de la vie politique, économique, sociale et intellectuelle.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «L'âme de la France»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «L'âme de la France» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «L'âme de la France» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.