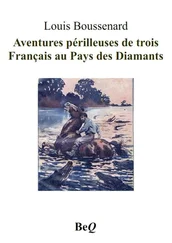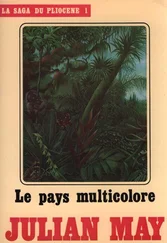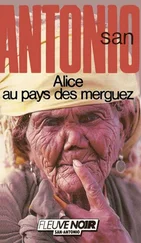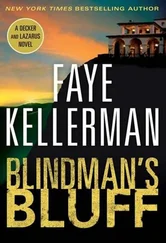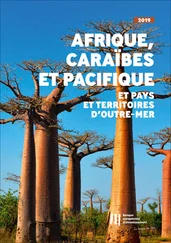L’impasse était muette. On n’entendait que le bruit du gravier qui craquait sous nos chaussures. Les habitants étaient terrés chez eux comme des crapauds au fond de leurs trous. Il n’y avait pas un brin de vent. La nature s’était tue. Au bout du chemin, un taxi attendait, le moteur ronronnant. Francis nous a fait signe de monter. Le chauffeur avait des lunettes de soleil et une balafre sur la joue gauche. Il fumait du chanvre. Francis l’a salué, poing contre poing, à la manière des Rastas. La voiture a démarré, lentement. On avait à peine fait quelques mètres qu’elle s’est arrêtée, à l’entrée du pont Muha. Il y avait là le principal barrage du quartier, tenu par des jeunes du gang des « Sans Défaite ». Derrière une rangée de barbelés qui barraient la route, des pneus brûlaient. Une épaisse fumée noire nous empêchait de discerner ce qui se passait au milieu du pont. Un groupe de jeunes criaient, s’acharnaient à coups de battes de base-ball et de gros cailloux sur une masse noire au sol, inerte. Ils avaient l’air d’y prendre du plaisir. En nous apercevant, quelques membres du gang sont venus à notre rencontre. Francis les appelait tous par leurs prénoms. J’ai reconnu l’homme à la kalachnikov, celui qui était venu nous mettre en joue à la maison. Lorsqu’il nous a vus, Gino et moi, il a dit :
— Qu’est-ce qu’ils foutent là, ces deux blancs ?
— C’est bon, chef, ils sont avec nous, leurs mères sont tutsies, a dit Francis.
L’homme nous a examinés d’un air sceptique, a hésité. Il a passé quelques consignes aux autres et est monté à l’arrière de la voiture, à côté de nous, sa kalachnikov entre les jambes, le chargeur recouvert d’autocollants de Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi.
— Roule, chauffeur ! a-t-il dit en frappant la tôle extérieure de la portière.
Un jeune a retiré les barbelés de la route. La voiture zigzaguait prudemment entre les pierres qui jonchaient le bitume. Les émanations de plastique brûlé nous piquaient les yeux et nous faisaient tousser. Arrivés au niveau du groupe qui s’agitait sur le pont, l’homme à la kalachnikov a ordonné au chauffeur de s’arrêter. Les membres du gang se sont écartés, hilares. Un frisson m’a parcouru. À leurs pieds, sur le goudron chaud, agonisait Attila, le cheval noir des Von Gotzen. Il était à l’endroit même où nous avions aperçu son ombre, une nuit d’orage, étendu sur le sol, les pattes brisées, le corps zébré de plaies sanguinolentes. Les jeunes s’étaient défoulés. Le cheval a relevé la tête et regardé dans ma direction. L’œil qui lui restait me fixait avec insistance. L’homme à la kalachnikov a sorti le canon de son arme par la fenêtre de la voiture, les jeunes se sont dispersés. Il a lancé : « Bassi ! ça suffit ! », et la rafale est partie. J’ai sursauté. Armand a agrippé mon short. La voiture a redémarré sous le regard des jeunes, visiblement déçus de perdre si vite l’attraction de leur journée.
Dans le quartier de Kabondo, le véhicule a bifurqué sur une piste cahoteuse qui longeait la rivière.
— Tu es le fils de l’ambassadeur qui vient d’être tué ? a demandé l’homme à la kalache.
Armand a hoché la tête sans le regarder. Le taxi est arrivé sur un promontoire en latérite qui surplombait la rivière. D’immenses kapokiers entouraient le lieu. Nous sommes descendus de la voiture. D’autres jeunes du quartier se trouvaient là. Des fils de bonne famille que je prenais pour de gentils étudiants étaient armés de bâtons et de pierres. Un homme, salement amoché, gisait au sol. La poussière rouge recouvrait son visage et ses vêtements, se mélangeait au sang coagulé qui coulait d’une plaie sur le haut de son crâne.
L’homme à la kalachnikov, que les autres appelaient Clapton, a pris Armand par le bras et lui a dit :
— Ce Hutu est l’un des assassins de ton père.
Armand n’a pas bougé. Clapton a frappé l’homme le premier et les autres l’ont imité. Les coups pleuvaient. Gino et Francis, poussés par l’excitation, se sont mêlés à la meute. Au même moment, une moto est arrivée à toute allure et deux hommes portant des casques à visière en sont descendus.
— C’est le boss, a dit Clapton, et toute la bande s’est arrêtée de frapper.
Francis s’est tourné vers Armand et moi pour nous annoncer fièrement :
— Eh, les gars, tenez-vous bien, c’est le chef des « Sans Défaite » en personne ! Vous allez halluciner !
Le passager de la moto a retiré son casque et l’a donné au chauffeur. Quand il m’a vu là, parmi les jeunes de son gang, en pleine journée ville morte, à côté de cet homme gémissant à terre, j’imagine qu’il n’en a pas cru ses yeux, Innocent. Il a souri.
— Tiens, Gaby. Content de te voir parmi nous.
Je n’ai pas répondu. J’étais debout, je serrais les dents et les poings.
Ensuite, les jeunes du gang ont attaché l’homme à terre en ligotant ses bras derrière son dos. Il s’est débattu comme il pouvait, ils ont dû s’y mettre à plusieurs pour réussir à l’immobiliser. Dans la confusion, sa carte d’identité a glissé de sa poche, est tombée dans la poussière. Après l’avoir attaché, les hommes l’ont porté dans le taxi. Le chauffeur à la cicatrice a pris un bidon d’essence dans le coffre et en a versé sur les sièges de la voiture et sur le capot avant de fermer les portières. L’homme hurlait sans s’arrêter, terrifié, nous suppliant de l’épargner. Innocent a sorti un briquet de sa poche. J’ai reconnu le Zippo de Jacques, celui qu’on lui avait volé à mon anniversaire, quelque temps avant la guerre, celui en argent avec les cerfs gravés dessus. Innocent a tendu la flamme à Armand.
— Si tu veux venger ton père…
Armand a reculé, avec une grimace affreuse, il disait non de la tête. Alors Clapton s’est approché :
— Chef, laisse plutôt le petit Français nous prouver qu’il est bien avec nous.
Innocent a souri, étonné de ne pas avoir eu l’idée lui-même. Il s’est approché de moi, le Zippo allumé à la main. Mes tempes et mon cœur battaient à tout rompre. J’ai tourné la tête à droite, à gauche, pour trouver de l’aide. J’ai cherché Gino et Francis dans le groupe. En croisant leur regard, j’ai vu qu’ils portaient le même visage de mort que les autres. Innocent a refermé ma main sur le briquet. Il m’a ordonné de le jeter. L’homme qui était dans le taxi me regardait avec intensité. Mes oreilles bourdonnaient. Tout devenait confus. Les jeunes du gang me bousculaient, me frappaient, hurlaient près de mon visage. J’entendais les voix lointaines de Gino et Francis, des cris de fauves, des salves de haine fiévreuse. Clapton parlait de Papa et d’Ana. Je discernais difficilement ses menaces au milieu des appels au meurtre et du brouhaha ambiant. Innocent s’est énervé, a dit que si je ne le faisais pas, il irait lui-même dans l’impasse s’occuper de ma famille. Je voyais l’image paisible de Papa et Ana allongés sur le lit, devant la télévision. L’image de leur innocence, de toutes les innocences de ce monde qui se débattaient à marcher au bord des gouffres. Et j’avais pitié pour elles, pour moi, pour la pureté gâchée par la peur dévorante qui transforme tout en méchanceté, en haine, en mort. En lave. Tout était flou autour de moi, les vociférations s’amplifiaient. L’homme dans le taxi était un cheval presque mort. S’il n’existe aucun sanctuaire sur terre, y en a-t-il un ailleurs ?
J’ai lancé le Zippo et la voiture a pris feu. Un immense brasier s’est élevé vers le ciel, a léché les hautes branches des kapokiers. La fumée s’échappait par-dessus la cime des arbres. Les cris de l’homme déchiraient l’air. J’ai vomi sur mes chaussures, et entendu Gino et Francis me féliciter en me tapotant le dos. Armand pleurait. Il pleurait encore, recroquevillé comme un fœtus dans la poussière, bien après que tout le monde eut quitté le terrain. On s’est retrouvés seuls devant l’épave calcinée. Le lieu était calme, presque serein. La rivière coulait en bas. Il faisait quasiment nuit. J’ai aidé Armand à se relever. Il fallait que l’on rentre chez nous, à l’impasse. Avant de partir, j’ai fouillé la poussière, les cendres. J’ai retrouvé la carte d’identité de l’homme qui venait de mourir. Que j’avais tué.
Читать дальше