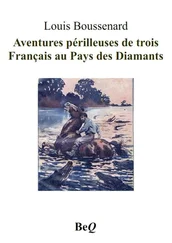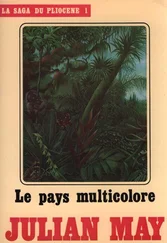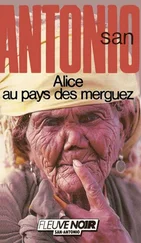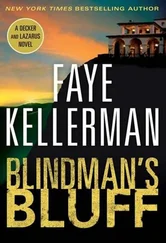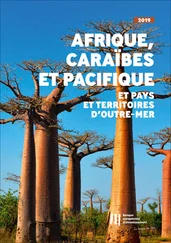Je suis allé trouver Papa pour lui raconter. J’ai menti, exagéré la brutalité de Maman pour le faire réagir. Il était hors de lui, féroce, quand il est allé s’expliquer avec elle. La dispute a dégénéré. Maman a retrouvé une vigueur qu’on pensait disparue. Elle s’est transformée en furie, l’écume aux commissures des lèvres et les yeux exorbités. Elle délirait dans ses propos, nous insultait dans toutes les langues, accusait les Français d’être responsables du génocide. Elle s’est précipitée sur Ana, l’a saisie par les bras, s’est mise à la secouer comme un palmier.
— Tu n’aimes pas ta mère ! Tu préfères ces deux Français, les assassins de ta famille !
Papa a essayé d’arracher Ana des griffes de Maman. Ma sœur était terrorisée. Les ongles de Maman s’enfonçaient dans sa chair, déchiraient sa peau.
— Aide-moi, Gaby ! a crié Papa.
Je ne bougeais pas, pétrifié. Papa a écarté un à un les doigts de Maman. Quand il est parvenu à lui faire lâcher prise, elle s’est retournée, a saisi un cendrier sur la table basse et l’a jeté au visage d’Ana. Son arcade sourcilière s’est ouverte, le sang s’est mis à couler. Il y a eu un moment de flottement, tout s’est embrouillé. Puis Papa a porté Ana dans la voiture, foncé aux urgences. Je me suis échappé de mon côté, et suis parti me réfugier dans le Combi, attendant la nuit pour rentrer à la maison. À mon retour, Maman était partie, disparue. Papa et Jacques ont passé des jours à sillonner la ville pour la retrouver, à appeler sa famille, ses amis, les hôpitaux, les commissariats, les morgues. En vain. Je me sentais coupable d’avoir voulu qu’elle s’en aille. J’étais un lâche, doublé d’un égoïste. J’érigeais mon bonheur en forteresse et ma naïveté en chapelle. Je voulais que la vie me laisse intact alors que Maman, au péril de la sienne, était allée chercher ses proches aux portes de l’Enfer. Elle l’aurait aussi fait pour Ana et moi. Sans hésiter. Je le savais. Je l’aimais. Et maintenant qu’elle avait disparu avec ses blessures, elle nous laissait avec les nôtres.
Cher Christian,
Je t’ai attendu pour les vacances de Pâques. Ton lit était prêt, à côté du mien. Au-dessus, j’avais épinglé quelques images de footballeurs. J’avais fait de la place dans mon placard pour que tu puisses y mettre tes habits et ton ballon. J’étais prêt à t’accueillir.
Tu ne viendras pas.
Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas eu le temps de te dire. Je me rends compte, par exemple, que je ne t’ai jamais parlé de Laure. C’est ma fiancée. Elle ne le sait pas encore. J’ai prévu de lui demander de m’épouser. Très bientôt. Une fois que la paix sera là. Avec Laure, on se parle par lettres. Des lettres envoyées par avion. Des cigognes de papier qui voyagent entre l’Afrique et l’Europe. C’est la première fois que je tombe amoureux d’une fille. C’est une drôle de sensation. Comme une fièvre dans le ventre. Je n’ose pas en parler aux copains, ils se moqueraient de moi. Ils diraient que j’aime un fantôme. Parce que je ne l’ai encore jamais vue, cette fille. Mais je n’ai pas besoin de la rencontrer pour savoir que je l’aime. Nos lettres me suffisent.
J’ai tardé à t’écrire. J’étais trop occupé ces temps-ci à rester un enfant. Les copains m’inquiètent. S’éloignent de moi chaque jour un peu plus. Se chamaillent pour des histoires d’adultes, s’inventent des ennemis et des raisons de se battre. Je comprends mieux pourquoi mon père nous interdisait, à Ana et à moi, de nous mêler de politique. Il a l’air fatigué, Papa. Je le trouve absent. Distant. Il s’est forgé une épaisse cuirasse de fer pour que la méchanceté ricoche sur lui. Alors qu’au fond, je le sais aussi tendre que la pulpe d’une goyave bien mûre.
Maman n’est jamais revenue de chez toi. Elle a laissé son âme dans ton jardin. Elle s’est fissuré le cœur. Elle est devenue folle, comme le monde qui t’a emporté.
J’ai tardé à t’écrire. J’écoutais un florilège de voix me dire tant de choses… Ma radio disait que l’équipe du Nigeria — celle que tu soutenais — a gagné la Coupe d’Afrique des nations. Mon arrière-grand-mère disait que les gens qu’on aime ne meurent pas tant qu’on continue de penser à eux. Mon père disait que le jour où les hommes arrêteront de se faire la guerre, il neigera sous les tropiques. Madame Economopoulos disait que les mots sont plus vrais que la réalité. Ma prof de biologie disait que la terre est ronde. Mes copains disaient qu’il fallait choisir son camp. Ma mère disait que tu dors pour longtemps, avec sur le dos le maillot de foot de ton équipe préférée.
Et toi, Christian, tu ne diras plus jamais rien.
Gaby
Allongée sur le carrelage de la terrasse, ses feutres et ses crayons de couleur éparpillés autour d’elle, Ana dessinait des villes en feu, des soldats en armes, des machettes ensanglantées, des drapeaux déchirés. Une odeur de crêpes emplissait l’air. Prothé cuisinait en écoutant la radio à tue-tête. Le chien dormait paisiblement à mes pieds. Il se réveillait de temps à autre, pour se mordiller frénétiquement la patte. Des mouches vertes tournaient autour de son museau. Assis à la place que Maman aimait occuper sur la terrasse, je lisais L’Enfant et la rivière , un livre prêté par Mme Economopoulos. J’ai entendu la chaîne en fer du portail se détacher. En me levant, j’ai aperçu les cinq hommes remonter l’allée. L’un d’eux avait une kalachnikov. C’est lui qui nous a demandé de sortir de la maison. Il donnait ses ordres du bout de son canon. Prothé a levé les bras en l’air, Ana et moi l’avons imité. Les hommes nous ont ordonné de nous mettre à genoux, les mains derrière la tête.
— Où est le patron ? a demandé l’homme à la kalachnikov.
— Il est en voyage dans le nord du pays, pour quelques jours, a dit Prothé.
Les hommes nous dévisageaient. Ils étaient jeunes. Certains m’étaient familiers. J’avais dû les croiser au kiosque.
— Toi, le Hutu, où est-ce que tu habites ? a continué l’homme en s’adressant à Prothé.
— Sur cette parcelle, depuis un mois, a dit Prothé. J’ai envoyé ma famille au Zaïre, à cause de l’insécurité. Je dors là.
Il a montré la petite baraque en tôle au fond du jardin.
— Nous ne voulons pas de Hutu dans le quartier, a dit l’homme à la kalachnikov. C’est compris ? On vous laisse travailler la journée, mais le soir vous rentrez chez vous.
— Je ne peux pas retourner dans mon quartier, chef, ma maison a été incendiée.
— Ne te plains pas. Tu as de la chance d’être encore en vie. Votre patron est un Français et, comme tous les Français, il préfère les Hutu. Mais ici, ce n’est pas le Rwanda, ils ne vont pas venir faire leur loi. C’est nous qui décidons.
Il s’est avancé vers Prothé et lui a enfoncé le canon de son arme dans la bouche.
— Alors à la fin de la semaine, soit tu quittes le quartier, soit on s’occupe de toi. Quant à vous deux, dites bien à votre père qu’on ne veut pas de vous, les Français, au Burundi. Vous nous avez tués au Rwanda.
Avant de retirer son arme de la bouche de Prothé, l’homme nous a craché dessus. Ensuite, il a fait un signe de tête au reste du groupe et ils ont quitté la parcelle. Nous avons attendu longtemps avant de nous relever. Puis nous nous sommes assis sur les marches de la maison. Prothé ne disait rien. Son regard abattu était planté dans le sol. Ana s’est remise à dessiner, comme si rien ne s’était passé. Au bout d’un moment, elle a levé la tête vers moi :
Читать дальше