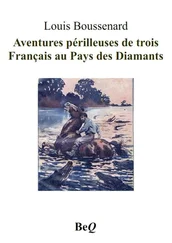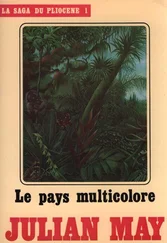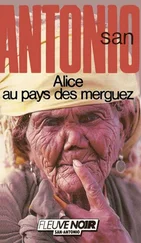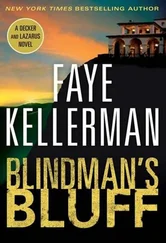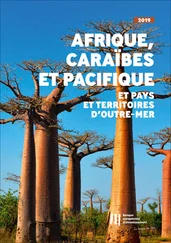— Gaby, pourquoi Maman nous a accusés d’avoir tué notre famille au Rwanda ?
Je n’avais pas de réponse à donner à ma petite sœur. Je n’avais pas d’explications sur la mort des uns et la haine des autres. La guerre, c’était peut-être ça, ne rien comprendre.
Parfois, je pensais à Laure, je voulais lui écrire, et je renonçais. Je ne savais pas quoi lui dire, tout paraissait si confus. J’attendais que les choses s’améliorent un peu, alors je pourrais tout lui raconter dans une longue lettre pour la faire sourire comme avant. Mais pour l’instant, le pays était un zombie qui marchait langue nue sur des cailloux pointus. On apprivoisait l’idée de mourir à tout instant. La mort n’était plus une chose lointaine et abstraite. Elle avait le visage banal du quotidien. Vivre avec cette lucidité terminait de saccager la part d’enfance en soi.
Les opérations ville morte se multipliaient dans Bujumbura. Du crépuscule jusqu’à l’aube, les explosions retentissaient dans le quartier. La nuit rougeoyait de lueurs d’incendies qui montaient en épaisse fumée au-dessus des collines. On était tellement habitués aux rafales et au crépitement des armes automatiques que l’on ne prenait même plus la peine de dormir dans le couloir. Allongé dans mon lit, je pouvais admirer le spectacle des balles traçantes dans le ciel. En d’autres temps, en d’autres lieux, j’aurais pensé voir des étoiles filantes.
Je trouvais le silence bien plus angoissant que le bruit des coups de feu. Le silence fomente des violences à l’arme blanche et des intrusions nocturnes qu’on ne sent pas venir à soi. La peur s’était blottie dans ma moelle épinière, elle n’en bougeait plus. Par moments, je tremblais comme un petit chien mouillé et grelottant de froid. Je restais calfeutré chez moi. Je n’osais plus m’aventurer dans l’impasse. Il m’arrivait parfois de traverser la rue, très rapidement, pour emprunter un nouveau livre à Mme Economopoulos. Puis je revenais aussitôt m’enfoncer dans le bunker de mon imaginaire. Dans mon lit, au fond de mes histoires, je cherchais d’autres réels plus supportables, et les livres, mes amis, repeignaient mes journées de lumière. Je me disais que la guerre finirait bien par passer, un jour, je lèverais les yeux de mes pages, je quitterais mon lit et ma chambre, et Maman serait de retour, dans sa belle robe fleurie, sa tête posée sur l’épaule de Papa, Ana dessinerait à nouveau des maisons en brique rouge avec des cheminées qui fument, des arbres fruitiers dans les jardins et de grands soleils brillants, et les copains viendraient me chercher pour descendre la rivière Muha comme autrefois sur un radeau en tronc de bananier, naviguer jusqu’aux eaux turquoise du lac et finir la journée sur la plage, à rire et jouer comme des enfants.
J’avais beau espérer, le réel s’obstinait à entraver mes rêves. Le monde et sa violence se rapprochaient chaque jour un peu plus. Notre impasse n’était plus le havre de paix que j’avais espéré depuis que les copains avaient décidé qu’il ne fallait pas rester neutre. Et même dans mon lit-bunker, les copains et tous les autres ont fini par me débusquer.
La ville était morte. Les gangs bloquaient les grands axes. La haine était de sortie. Une nouvelle journée noire commençait à Bujumbura. Une de plus. Chacun était sommé de rester chez lui. Reclus. La rumeur disait que la colère était encore montée d’un cran chez les jeunes Tutsi des gangs qui quadrillaient la ville car, la veille, des rebelles hutus avaient brûlé vifs des élèves tutsis dans une station-service, à l’intérieur du pays. Les gangs tutsis avaient décidé de se venger sur tous les Hutu qui oseraient s’aventurer dehors. Papa avait fait des provisions pour plusieurs jours. On se préparait à de longues journées d’attente. J’étais allé chercher mon stock de livres chez Mme Economopoulos et j’étais en train de me verser un grand verre de lait caillé, avant de m’enfouir dans mon lit pour dévorer mes histoires, quand j’ai entendu Gino gratter à la porte de la cuisine.
— Qu’est-ce que tu fais là ? J’ai chuchoté en ouvrant. C’est de la folie de sortir aujourd’hui.
— Arrête de flipper en permanence, Gaby ! Ramène-toi, il s’est passé quelque chose de grave.
Il n’a pas voulu m’en dire plus, alors j’ai enfilé mes chaussures en vitesse. Dans le salon, j’entendais les rires de Papa et Ana qui regardaient des dessins animés. Je me suis glissé dehors sans bruit et j’ai emboîté le pas à Gino qui fonçait comme une flèche. Nous avons pris un raccourci en escaladant la clôture et en coupant par le terrain de football du lycée international. Grâce à une ouverture dans le grillage, nous sommes entrés dans la parcelle de Gino et nous avons traversé son jardin. J’ai entendu l’éternel cliquetis de la machine Olivetti de son père. Nous avons sauté par-dessus le portail, et pris à droite vers le fond de l’impasse. Elle était déserte. On a remonté l’allée. Il n’y avait pas âme qui vive. On est passés devant le kiosque fermé. Puis le cabaret. On a tourné à gauche sur le terrain vague. La végétation avait poussé et, depuis la route, on ne voyait plus le Combi Volkswagen.
Avant d’ouvrir la porte de la planque, j’ai eu comme un mauvais pressentiment, quelque chose me disait de rentrer à la maison, de retourner dans mes livres. Gino ne m’a pas laissé le temps de réfléchir, il a fait coulisser la porte.
Armand était prostré sur le siège poussiéreux du Combi, les vêtements couverts de sang. Des pleurs secouaient violemment sa poitrine. Entre deux spasmes, il poussait un râle aigu. Sourcils froncés, Gino grinçait des dents et de petits soubresauts de colère remuaient ses narines. « Son père est tombé dans une embuscade, hier soir, dans l’impasse. Armand vient de rentrer de l’hôpital. Il a succombé à ses blessures. C’est fini. »
Mes jambes se sont dérobées, je me suis rattrapé comme j’ai pu à l’appui-tête du siège passager. Ma tête tournait. Gino, l’air mauvais, est sorti du Combi et est allé s’asseoir dehors, sur un vieux pneu dans lequel stagnait une eau croupie. Il a caché son visage dans ses mains. Étourdi, j’observais Armand, sanglotant, ses habits maculés du sang de son père. Ce père qu’il craignait autant qu’il le vénérait. Des gens étaient venus l’assassiner dans notre impasse. Dans notre havre de paix. Le peu d’espoir qui me restait venait de s’envoler. Ce pays était un piège mortel. Je me sentais comme un animal affolé au milieu d’un grand feu de brousse. Le dernier verrou avait sauté. La guerre venait de faire irruption chez nous.
— Qui a fait ça ?
Armand m’a lancé un regard hostile.
— Des Hutu, bien sûr ! Qui veux-tu que ce soit ? Ils avaient préparé leur coup. Ils l’attendaient depuis plusieurs heures devant notre portail, avec un panier de légumes. Ils se sont fait passer pour des maraîchers de Bugarama. Ils l’ont poignardé devant la maison, avant de repartir tranquillement, en plaisantant. J’étais là, j’ai tout vu.
Armand s’est remis à sangloter. Gino s’est levé et a balancé des grands coups de poing contre la carrosserie du véhicule. Hors de lui, il a saisi une barre de fer et a pulvérisé le pare-brise et les rétroviseurs du Combi. Je le regardais faire. Hagard.
Francis est arrivé, la mine sombre. Il portait un bandana à la manière de Tupac Shakur. Il a dit :
— Ramenez-vous, ils nous attendent.
Gino et Armand l’ont suivi sans rien dire.
— Où va-t-on ? j’ai demandé.
— On va protéger notre quartier, Gaby, a répondu Armand en essuyant sa morve avec le revers de sa main.
En temps normal, j’aurais rebroussé chemin. Mais la guerre était maintenant chez nous, elle nous menaçait directement. Nous et nos familles. Avec le meurtre du père d’Armand, je n’avais plus le choix. Gino et Francis m’avaient suffisamment reproché de vouloir croire que ces problèmes ne me concernaient pas. Les faits leurs donnaient raison. La mort, sournoise, était venue jusque dans notre impasse. Il n’existe aucun sanctuaire sur terre. Je vivais ici, dans cette ville, dans ce pays. Je ne pouvais plus faire autrement. J’ai avancé avec les copains.
Читать дальше