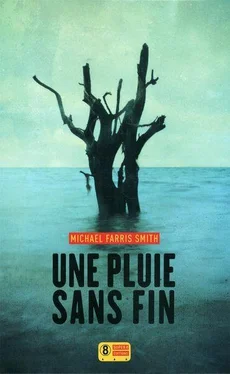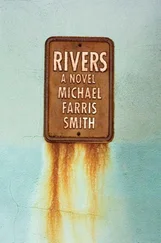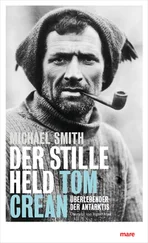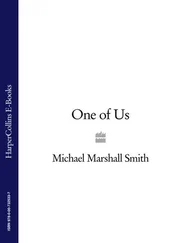Le chien roula sur le dos. Havane apparut au coin de l’église. Quand Cohen la regarda, il vit du même coup des yeux orange, plus loin dans les arbres, derrière l’édifice. De grands yeux qui brillaient à la clarté du feu, parfaitement immobiles dans la nuit. Havane continua à avancer, elle se retrouva juste devant leur propriétaire, mais Cohen ne bougea pas, concentré sur ces lumières jumelles — parce qu’elles trahissaient la présence de quelque chose d’important. Le chien s’assit, conscient peut-être de son malaise, suivit son regard et se mit à grogner. Un grognement bas, prudent.
« Chuuut », murmura Cohen.
Puis, comme le chien grognait toujours, il lui frotta le crâne à tâtons en chuchotant Du calme. Du calme, du calme, ne bouge pas.
Il porta aussi l’autre main à sa ceinture, lentement, pour se saisir de son couteau. Assis, ajouta-t-il, parce que le chien s’était levé, tendu, et que son grognement se muait en gémissement monocorde. C’est bon, c’est bon, mais ne bouge pas.
Havane s’approcha et s’ébroua. Le chien se réfugia derrière la chaise, effrayé.
Les yeux restèrent où ils étaient. Aussi figés que des nœuds dans le bois.
Déjà, l’esprit de Cohen était revenu aux voix de son grand-père et des autres vieillards, en grande discussion dans leur campement au bord du bayou. Ils parlaient de ce qu’ils avaient vu, ils racontaient des histoires magnifiques dans lesquelles il espérait trouver le propriétaire des yeux orange, mais les voix du passé se contentaient de conjurer des images de monstres des marécages et de créatures sanguinaires sans nom qui enlevaient en pleine nuit les enfants dans leur lit. Alors que les prunelles fixées sur lui étaient bien réelles, toutes proches, attentives et pleines d’une patience rare.
Une panthère. Une grosse panthère.
Il déboutonna l’étui du couteau, qu’il tira en se demandant comment s’y prendre pour tuer une panthère ou autre horreur. La stupidité d’une pensée pareille dessina sur ses lèvres un sourire idiot.
Havane s’ébroua, une fois de plus. Il lui jeta un coup d’œil, et quand son regard se reposa sur l’arbre, les yeux avaient disparu. Ils s’étaient évanouis dans la nuit, comme le simple fruit de son imagination. Il expira, inconscient jusque-là d’avoir retenu son souffle, dit au chien de se détendre — pour l’instant —, se leva lentement et contourna l’église en appelant ses deux compagnons. Pas question de dormir près du feu, pas avec cette chose tout près. Ils empruntèrent donc la petite porte de derrière, qui donnait sur la sacristie où il avait trouvé la chasuble, dans un placard rempli de vêtements liturgiques. Il s’y servit à tâtons, avant d’étendre les robes par terre. Le chien se coucha aussitôt dessus, mais Cohen lui ordonna de se relever, en ramassa une, s’en enveloppa, regagna la porte sans décoller la main du mur et la referma. Alors seulement il s’allongea sur son tapis improvisé. Le chien s’y allongea près de lui, pendant que Havane se postait à la fenêtre, les naseaux pressés contre le verre qu’elle embuait de son souffle. Ils allaient avoir froid, ils allaient être courbatus, mais ils étaient en sécurité. Cohen se remit à parler au chien.
Depuis la déclaration de la Limite, ils déboulaient comme les meutes de coyotes descendues des collines, attirées par l’odeur du sang. Certains ressemblaient aux étudiants déchaînés des vacances de printemps : pour eux, s’éclater revenait à brailler et à chanter faux par-dessus une radio tonitruante, en profitant malgré la tempête d’une glacière pleine de bière et d’une bonne petite herbe. Ils s’installaient sur la plage, près d’un casino renversé autour duquel ils commençaient à creuser sans se concerter, sans but réel, chacun de son côté. Les trous résultants n’étaient pas de taille à dissimuler un panier, sans parler d’un coffre rempli de millions de dollars. Ces fêtards ne duraient pas. Il leur fallait des heures, voire des jours pour atteindre la mer, ils n’avaient pas conscience des conditions de vie difficiles qui les attendaient passé la Limite, et ils repartaient aussitôt arrivés, quand leur excitation s’évanouissait ou qu’on tirait au-dessus de leur tête.
D’autres connaissaient le terrain. Ceux-là restaient. Ils connaissaient le vent, le tonnerre, les brèches de la côte, les endroits où les ponts avaient été emportés, l’enfilade de casinos qui s’étirait autrefois sur trente kilomètres de littoral. Ils savaient si les bâtiments étaient toujours là, et, s’ils n’y étaient plus, où ils avaient été.
Ceux-là se différenciaient par leurs outils. Les moins heureux arrivaient à quatre ou cinq dans des remorques-plateaux, avec pelles et pioches. Ils connaissaient la région, ils avaient du courage, mais ils manquaient d’armes, de la force et de l’énergie nécessaires pour creuser vite. Ils se faisaient repérer avant d’avoir progressé, ce qui les obligeait à s’enfuir pour regagner le trou inondé d’où ils s’étaient extirpés.
Les plus heureux — en admettant qu’il y avait bien quelque chose à trouver — avaient des armes, la jeunesse et les véhicules requis pour foncer dans, à travers, au-dessus : des voitures et des camions militaires à quatre roues motrices censés servir à la guerre, équipés de détecteurs de métaux. Leur force physique et leur entraînement leur permettaient de travailler dur, de creuser profond, d’aller vite. Le gouvernement les avait laissés sous la Limite, coincés dans ses avant-postes, Dieu savait pourquoi. Aider ceux qui ne voulaient pas qu’on les aide. Protéger ceux qui ne voulaient pas qu’on les protège. Passer leur temps dans des casemates en parpaings aux poutrelles d’acier, jour après jour, à fuir les tempêtes, à regarder tomber la pluie, à écouter claquer la foudre et gronder le tonnerre, à contempler les murs et le sol. Tout ça pour que le gouvernement conserve son autorité dans la région qu’il avait abandonnée, même si la loi n’y existait plus. Il n’y subsistait que celle de l’instant, chacun faisant au mieux. Ces hommes passaient leur temps dans des casemates, jour après jour, parce qu’ils en avaient reçu l’ordre d’autres hommes, qui vivaient au sec. Depuis, la nervosité les avait gagnés, l’anxiété. Ils saisissaient leur chance de s’occuper à l’extérieur. Ils arrivaient dans leurs voitures et leurs camions, des armes imposantes installées sur le toit ou dépassant des fenêtres ouvertes pour avertir quiconque pouvait bien s’intéresser à la même chose qu’eux : Foutez-nous la paix.
La côte grouillait d’errants en quête d’un unique graal : l’argent enfoui des casinos. Un putain de paquet de pognon. Dans la panique de l’évacuation puis, plus tard, de l’officialisation de la Limite, les rois des machines à sous étaient censés avoir donné l’ordre d’enterrer des coffres pleins de fric à soustraire aux impôts. Moins ils déménageaient d’argent, moins l’État pouvait en taxer. Des camionnettes chargées en pleine nuit de malles dans lesquelles un cadavre aurait tenu à l’aise, mais pleines à ras bord de billets craquants, s’étaient enfoncées dans l’obscurité pour aller confier leur trésor à la terre.
Ces rumeurs ne se laissaient pas facilement dissiper. Quand les journaux et les magazines parlaient des mouvements de fonds des casinos, des banques ou autres institutions financières de la région, ils mentionnaient invariablement l’argent enfoui. Les cadres tirés à quatre épingles avaient beau nier en bloc, il se trouvait toujours un responsable des services ou des tables de jeu, voire une serveuse passée par le bon lit, pour affirmer qu’il ne s’agissait pas de racontars sans fondement. Je les ai vus charger les coffres, Machin m’a dit qu’ils allaient les enterrer, il s’est mis à rire en m’expliquant que c’était complètement primaire mais carrément génial, et non seulement ils ont emporté de gros coffres pour les enterrer, mais les patrons se sont rempli des sacs qu’ils ont planqués le long de la côte pour leurs vieux jours. L’économie s’effondrait, les banques fermaient, beaucoup de casinos ne rouvriraient jamais ailleurs. L’argent seul comptait, et il était là, quelque part.
Читать дальше