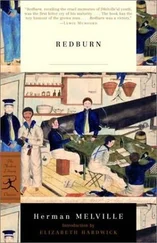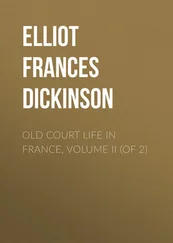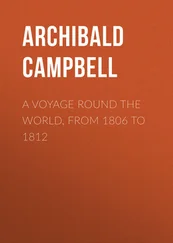Il descendit sur le trottoir. En face de l'arrêt de bus, deux grilles s'ouvraient sur un parc dominé par une maison à tourelles. Admirant l'armature en fer forgé du jardin d'hiver, David songea que la demeure appartenait probablement à une comtesse dont les arrière-grands-parents avaient connu personnellement Monet. Il s'imagina prenant le thé, jouant au billard, ou poussant les jeunes filles sur une balançoire. Mais une inscription, sur la grille, précisait qu'il s'agissait de la résidence
Grand Large, divisée en trente appartements standing.
Cent mètres plus loin, un escalier dévalait vers la mer. Prenant sa valise par la poignée, David descendit les marches et, soudain, un vaste paysage s'ouvrit devant lui. L'escalier débouchait sur une promenade qui dominait la baie du Havre. Instantanément, l'Américain se crut transporté au pays enchanté des impressionnistes. Un peu plus bas, ricochant contre les galets, les flots se balançaient dans un bleu-vert enchanteur. De petits nuages.blancs passaient dans le ciel. Au large, des bateaux se succédaient dans le chenal du port et il suffisait de remplacer les porte-conteneurs par des paquebots, les planches à voile par des barques de pêcheurs pour retrouver le paysage d'autrefois. David reconnut même, émergeant de la ville, un clocher d'église parfaitement visible dans un autre tableau de Monet représentant la plage du Havre.
Quelques demeures anciennes surplombaient la promenade. David se demanda laquelle abritait le fameux jardin de Sainte-Adresse. Il se remit en marche, afin de trouver l'emplacement exact du tableau. Il croisa quelques promeneurs, plusieurs femmes en jogging accompagnées de grands chiens. Plus loin, un ponton en bois s'avançait au-dessus des flots, juste en face du Windsurf, bar moderne où des jeunes gens sirotaient des boissons en écoutant de la musique rythmée. Marchant encore, David remarqua une silhouette arrêtée au milieu de la promenade: un peintre du dimanche.
Emmitouflé dans un ciré vert malgré le beau temps, l'homme tenait un pinceau dans une main, une palette dans l'autre, et semblait réfléchir en regardant la mer. David s'approcha. Il vit le peintre esquisser un geste, lever sa brosse puis se tourner rapidement vers la toile posée sur un chevalet. Le jeune homme observait son allure étrange: cette longue barbe blanche, ce chapeau de pêcheur, ce ciré incongru sous le soleil radieux. L'image éveillait un vague souvenir dans la mémoire de l'Américain – comme s'il avait déjà rencontré le même personnage. Il observait à distance, essayant de se rappeler. Indifférent, le peintre continuait son va-et-vient entre le paysage maritime et la toile. Soudain, concentrant son attention sur cette barbe, David eut un étourdissement. Il ferma les yeux puis les ouvrit de nouveau, sûr de lui. Car l'individu qui se tenait devant lui était – à l'évidence – claude monet en personne.
Aussitôt, tout s'éclaira. Non seulement Claude Monet se trouvait sur la promenade, mais il s'agissait précisément de Monet tel que l'avait peint Renoir dans un tableau où l'on voit le vieux peintre à barbe blanche affublé d'un ciré et d'un chapeau de pêcheur. David se souvenait parfaitement de ce portrait: Monet peint par Renoir se tenait devant lui, en chair et en os, dans la baie du Havre où l'on aperçoit aussi des raffineries et des immeubles en béton armé.
Reprenant son sang-froid, le jeune homme s'approcha du peintre pour le toucher, mais avant même qu'il ne prononce un mot, le père de l'impressionnisme s'adressait à lui solennellement:
– Bonjour, je m'appelle Claude Monet. J'aime la lumière de cette plage et j'essaie de la traduire dans une peinture révolutionnaire que mes ennemis, pour se moquer, appellent «impressionnisme»… À Paris, on me méprise car je n'ai pas d'argent pour vivre. Si quelqu'un voulait bien m'acheter ce tableau, pour quelques centaines de francs. Peut-être qu'il en vaudra mille fois plus un jour…
David resta muet, tandis que l'autre éclatait de rire en ajoutant:
– Je ne plaisante pas!
À ces mots, il tira sur sa barbe postiche, tenue par un élastique. Puis il reprit, l'air furieux:
– Car je suis peintre tout de même! Et j'ai choisi cet endroit pour rappeler aux gens que la peinture ne s'arrête pas à Claude Monet!
Il pointait le doigt vers un panneau surplombant la promenade. Obnubilé par son interlocuteur, David n'avait rien vu. Au-dessus de lui se dressait une immense reproduction agrandie du Jardin à Sainte-Adresse, couverte de Plexiglas. Un souvenir du tableau subsistait dans cette copie délavée par le soleil. Sous la reproduction, un texte informait les passants:
À cet emplacement
se trouvait la villa
où Claude Monet peignit en 1867
son fameux
Jardin à Sainte-Adresse
– Vous comprenez? reprit le jeune artiste qui avait replacé sa barbe de travers. C'est un bon endroit pour présenter mon travail. J'espère obtenir une subvention pour ce concept: «Monet d'hier et Monet d'aujourd'hui»… Qu'en pensez-vous?
David le regarda avec sympathie, heureux d'avoir atteint le premier but de son voyage. Mais le peintre tendait vers lui son pinceau tout noir en poursuivant:
– Je peins le même paysage que Monet, mais dans une version plus dérangeante. Imaginez Monet après la guerre, Monet après le totalitarisme. Que verrait-il, Monet, dans ce paysage hanté par toutes les souffrances du siècle? Il ne verrait rien, Monet. Il verrait le noir, la fin, le néant. Regardez plutôt.
Prononçant ces mots, il saisit son œuvre et tourna vers David une toile entièrement noire, en criant:
– Le Jardin à Sainte-Adresse noir sur fond noir! C'est fort, non?
Cherchant un mot aimable, David finit par prononcer:
– Intéressant!
Et l'autre jubilait en répétant:
– C'est intéressant, n'est-ce pas, intéressant?
Le jeune Américain écoutait à peine. Il récapitulait le déroulement de cette journée bizarre, dans ce pays tout vibrant de culture où il n'avait encore rien vu de vraiment beau, à l'exception des nuages sur la mer et des souvenirs qui guidaient ses pas.
Tout scintille à présent dans une vapeur de plaisir. La lumière poudreuse fait vibrer le zinc sur les toits de Paris. Accoudé au balcon, j'écoute avec ravissement un moteur de mobylette. Habituellement, je trépignerais. Aujourd'hui, j'admire l'obstination de cet apprenti humain casqué qui a trafiqué son pot d'échappement et gâche la vie de tout le quartier, pour se croire sur une moto. Cela me semble délectable et la même béatitude se prolonge dans des détails minuscules: me servir une bière en admirant la mousse épaisse qui se creuse au sommet du verre; me rappeler la tête furieuse du collègue qui, hier, m'a envoyé ses maquettes à la figure quand je lui demandais s'il pourrait modifier la présentation de mon article sur la taxation du carburant.
Rétrospectivement, cette semaine s'avère aimable en déconvenues. Avant-hier, le propriétaire de Taxi Star m'a convoqué dans son bureau. Je pensais qu'il allait me faire une proposition flatteuse; il m'a seulement serré l'épaule en affirmant «compter beaucoup» sur moi. À présent, je suis affalé devant une cassette de Jean-Luc Godard, où de jeunes bourgeois absurdes clament leur amour de Mao. Je me demande si ce film est sérieux et je bâille d'admiration, quand tintinnabule la sonnette de l'appartement. D'ordinaire, cette clochette électronique me plonge dans un état proche de l'angoisse: qui vient me déranger aujourd'hui? Quel démarcheur vais-je devoir éconduire? Quel ami euphorique vient m'imposer son ennuyeuse conversation? Or, aujourd'hui, la même clochette me fait l'effet d'une mélodie touchante et pleine de désir – comme le moteur de mobylette, les klaxons et autres couinements mécaniques par lesquels l'homme moderne exprime sa haine ou sa joie, avec une vitalité de gros bébé.
Читать дальше