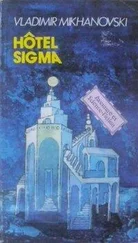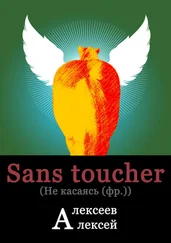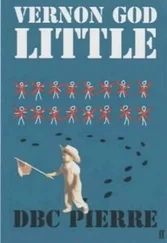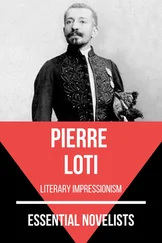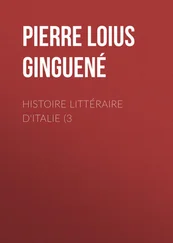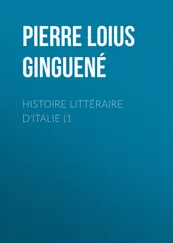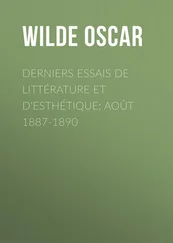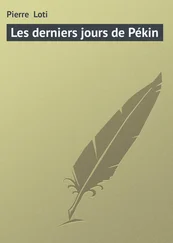À la limite, cette maladie qui consiste à attendre toujours que des livres paraissent est porté [sic] à tel point sur le plan de la marchandise spectaculaire qu'on peut se demander quels désirs s'expriment là. J'ai pas mal travaillé ces temps-ci, sur Hölderlin et Rimbaud. Rouvrir ces dossiers, en termes historiques, l'un qui se déroule, comme par hasard, au moment de la Révolution française, l'autre comme par hasard au moment de la Commune de Paris (ce qui ne veut pas dire qu'il faut réduire Hölderlin à la Révolution française, ni Rimbaud à la Commune de Paris) on se rend compte à quel point les choses ont été recouvertes par des interprétations qui ne tiennent pas debout.
Il ne s'agit pas, dans cet ouvrage, de jouer au pion et de relever les coquilles. Mais l'amusant, dans ce cas précis, c'est que l'auteur d'Éloge de l'infini, cinq pages avant le passage qui précède, consacre un long paragraphe à la coquille. Il déclare qu'il lui accorde beaucoup d'importance, qu'il la considère comme symptomatique, et lui, Philippe Sollers, revendique la plus grande attention aux détails typographiques et orthographiques. On constate, hélas, qu'il se montre moins attentif à la syntaxe et à la cohérence du sens, car une maladie porté [sic] sur un plan, des dossiers qui se déroulent, et rouvrir […] on se rend compte, dans la lignée du char de l'État naviguant sur un volcan cher à Joseph Prudhomme, ce n'est plus Éloge de l'infini, c'est Illustration du bredouillis.
«Mais oui» ou «comment donc» reviennent à tous les détours de phrase (avec l'idée, sans doute, que «comment donc» fait très XVIII e, marquis insolent, etc.), ponctuation un peu radoteuse qui manifeste superbement que ce qui vient d'être dit n'a pas besoin d'être mieux étayé, puisque c'est l'auteur qui le dit. Il suffit de rapprocher un peu n'importe quoi de culturel, présentant une certaine ressemblance. À tous les coups, ça fait de l'effet; Nietzsche et Proust, par exemple: «Le temps perdu, l'éternel retour, le temps retrouvé, ça peut se penser ensemble.» Mais oui. Mais comment donc.
La pensée de Sollers, dans sa dimension historique, consiste à dire qu'il y a eu de grands artistes au xx esiècle, ce qu'on ignore, et donc que le xx esiècle est un grand siècle artistique; penser consiste alors à dresser des listes et à tresser des couronnes à des artistes célèbres:
Le xx esiècle […] a aussi été un très grand siècle de création antimorbide. […] Il suffit de citer certains noms: Proust, Kafka, Joyce, Picasso, Stravinski, Heidegger, Céline, Nabokov. Et bien d'autres: Hemingway, Faulkner, Matisse, Webern, Bataille, Artaud, Breton […].
Gloire à Harnoncourt, Gardiner, William Christie, Herreweghe, Hogwood, Clara Haskil, Martha Argerich, Cecilia Bartoli. Mais gloire aussi à Paul Mac Cartney, dont je revoyais ces jours-ci, à Londres, le concert de 1990: un garçon génial, voilà tout.
C'est passionnant. Ça a bien un petit côté conférence de musée pour université du troisième âge, ou toast pompeux de banquet III eRépublique, mais quelle culture. Quelle sûreté, en outre, quelle audace dans le jugement. Quelle subversion. Mac Cartney? Génial, ce garçon, simplement génial. Et il reste encore beaucoup à apprendre, la richesse de la pensée du Combattant Majeur est inépuisable. À la judicieuse question posée par Les Temps modernes: «Et la contribution de Bataille à l'histoire du xx esiècle?», il répond d'un trait foudroyant: «Éminente… Prodigieuse… Que d'avancées! La part maudite, Le Bleu du ciel… très importants», avant de lever, encore une fois, les questions fondamentales: «Pourquoi Joyce écrit-il Ulysse? Pourquoi Pound écrit-il ses Cantos? Pourquoi Bataille reprend-il l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire? […] pourquoi la musique fait-elle ce qu'elle fait? Pourquoi y a-t-il Stravinski ou le jazz?»
Eh oui, pourquoi?
Mais pourquoi?
L'autre volet de la pensée historique de Sollers consiste, on l'a vu, à jeter en toute occasion l'anathème sur le xix esiècle. Ici, l'audace devient inouïe, car Sollers ne cesse en même temps de faire l'éloge de Rimbaud, Mallarmé, Balzac, Théophile Gautier, Cézanne, Monet, Verlaine, Hugo, Stendhal, Jarry, etc., bref, de tout ce dont se compose l'histoire littéraire du xix esiècle. Le xix esiècle est mauvais, sauf le xix esiècle. Bien sûr, on attendait l'argument suprême: s'il y a eu de grands artistes au xix esiècle c'est en dépit du xix esiècle. Ce n'est pas le xix esiècle qui les a produits, il ne l'a pas fait exprès. S'ils sont grands, c'est contre leur époque. Air connu. L'artiste échappe à son temps, on ne peut pas le réduire à son temps, etc. L'ennui, c'est que cette idée un peu courte est typique du xix esiècle. Sollers démontre brillamment qu'on peut détester le xix esiècle avec des idées du xix esiècle. Se croire rebelle en brandissant de vieux arguments de bourgeois conservateurs. Le Combattant Majeur, qui sait tout, n'y a sans doute pas songé: Le Stupide XIX e siècle est un livre du réactionnaire antisémite Léon Daudet. Il y a des rencontres significatives.
Contre ces caricatures qui se veulent originales, on est obligé de réaffirmer certaines banalités nécessaires: le xix esiècle a fait Rimbaud et Cézanne, comme ils ont fait le xix esiècle. Et le xx e. Si un grand artiste est toujours plus grand que son temps, c'est aussi dans la mesure où il en concentre les contradictions. Ni uniquement en dehors, c'est l'illusion idéaliste de Sollers, ni uniquement dedans, c'est l'illusion positiviste. Parmi les illusions simplificatrices du xix esiècle, Sollers en choisit une contre l'autre. C'est une constante de son mode de pensée: il ne cesse d'illustrer, de manière biaisée, ce qu'il dénonce par ailleurs.
Les errements inhérents à ce genre de pensée caricaturale se manifestent le plus nettement dans les textes consacrés à Mallarmé. On commence par le bon vieux coup de l'incompréhensible et de l'indicible. Encore un héritage d'un certain xix esiècle et de son idéalisme: «Mallarmé, dans la société de son temps, est une énigme.» Bien entendu, pour appuyer cette thèse qui consiste à ne rien dire et à interdire qu'on puisse dire quoi que ce soit, Sollers s'empresse de réduire les explications historiques à leur caricature, la bêtise positiviste, selon laquelle «le poète est un malade maniaque (Baudelaire), un dépravé alcoolique (Verlaine)». Comme si Max Nordau résumait tout éclairage historique possible sur Mallarmé. Sollers fait du réalisme l'«autre face» du positivisme. Il ignore l'existence d'un vieux couple beaucoup plus uni sous l'apparence des chamailleries: l'autre face de l'épaisseur positiviste, c'est le refus idéaliste de tout éclairage historique et de toute explication, fût-elle dépourvue de la prétention de rendre compte de l'œuvre dans son intégralité. Non, Mallarmé n'est pas totalement une énigme en son temps. Il le dépasse si l'on veut, mais il le quintessencie. Dans «Le fantôme de Mallarmé», Sollers reprend l'antienne archiconnue de Mallarmé et le néant, Mallarmé et ses rapports avec les anarchistes, Mallarmé et «la poésie comme bombe à retardement», pour ne rien dire, sinon que personne ne veut en entendre parler, ou que Mallarmé est «le plus dangereux pour l'institution». L'institution se porte très bien, et elle n'a pas le moins du monde souffert de Mallarmé. Qui n'a rien fait sauter du tout. En revanche il a fait publier des milliers de pages de commentaires, dont celles de Sollers, vendues bon marché par Gallimard. Mais ne nous fions pas aux apparences, dit le Combattant Majeur. La société tremble, les banlieues se soulèvent à la lecture du «sonnet en yx», les Maîtres du monde, dans leurs repaires secrets, ourdissent un ténébreux complot visant à kidnapper tous les textes publiés et tous les manuscrits du dangereux terroriste afin de les détruire.
Читать дальше