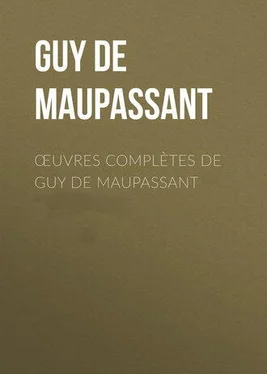« Je le joignis comme il allait à la messe (c’était un dimanche) et je lui donnai cent sous en le dévisageant anxieusement. Il se remit à rire d’une ignoble façon, prit l’argent, puis, gêné de nouveau par mon œil, il s’enfuit après avoir bredouillé un mot à peu près inarticulé, qui voulait dire “merci”, sans doute.
« La journée se passa pour moi dans les mêmes angoisses que la veille. Vers le soir, je fis venir l’hôtelier, et avec beaucoup de précautions, d’habiletés, de finesses, je lui dis que je m’intéressais à ce pauvre être si abandonné de tous et privé de tout, et que je voulais faire quelque chose pour lui.
« Mais l’homme répliqua : “Oh ! N’y songez pas, Monsieur, il ne vaut rien, vous n’en aurez que du désagrément. Moi, je l’emploie à vider l’écurie, et c’est tout ce qu’il peut faire. Pour ça je le nourris et il couche avec les chevaux. Il ne lui en faut pas plus. Si vous avez une vieille culotte, donnez-la-lui, mais elle sera en pièces dans huit jours.”
« Je n’insistai pas, me réservant d’aviser.
« Le gueux rentra le soir horriblement ivre, faillit mettre le feu à la maison, assomma un cheval à coups de pioche, et, en fin de compte, s’endormit dans la boue sous la pluie, grâce à mes largesses.
« On me pria le lendemain de ne plus lui donner d’argent. L’eau-de-vie le rendait furieux, et, dès qu’il avait deux sous en poche, il les buvait. L’aubergiste ajouta : “Lui donner de l’argent, c’est vouloir sa mort.” Cet homme n’en avait jamais eu, absolument jamais, sauf quelques centimes jetés par les voyageurs, et il ne connaissait pas d’autre destination à ce métal que le cabaret.
« Alors je passai des heures dans ma chambre, avec un livre ouvert que je semblais lire, mais ne faisant autre chose que de regarder cette brute, mon fils ! Mon fils ! En tâchant de découvrir s’il avait quelque chose de moi. À force de chercher, je crus reconnaître des lignes semblables dans le front et à la naissance du nez, et je fus bientôt convaincu d’une ressemblance que dissimulaient l’habillement différent et la crinière hideuse de l’homme.
« Mais je ne pouvais demeurer plus longtemps sans devenir suspect, et je partis, le cœur broyé, après avoir laissé à l’aubergiste quelque argent pour adoucir l’existence de son valet.
« Or, depuis six ans, je vis avec cette pensée, cette horrible incertitude, ce doute abominable. Et, chaque année, une force invincible me ramène à Pont-Labbé. Chaque année je me condamne à ce supplice de voir cette brute patauger dans son fumier, de m’imaginer qu’il me ressemble, de chercher, toujours en vain, à lui être secourable. Et chaque année je reviens ici, plus indécis, plus torturé, plus anxieux.
« J’ai essayé de le faire instruire. Il est idiot sans ressource.
« J’ai essayé de lui rendre la vie moins pénible. Il est irrémédiablement ivrogne et emploie à boire tout l’argent qu’on lui donne et il sait fort bien vendre ses habits neufs pour se procurer de l’eau-de-vie.
« J’ai essayé d’apitoyer sur lui son patron pour qu’il le ménageât, en offrant toujours de l’argent. L’aubergiste, étonné à la fin, m’a répondu fort sagement : “Tout ce que vous ferez pour lui, Monsieur, ne servira qu’à le perdre. Il faut le tenir comme un prisonnier. Sitôt qu’il a du temps ou du bien-être, il devient malfaisant. Si vous voulez faire du bien, ça ne manque pas, allez, les enfants abandonnés, mais choisissez-en un qui réponde à votre peine.”
« Que dire à cela ?
« Et si je laissais percer un soupçon des doutes qui me torturent, ce crétin, certes, deviendrait malin pour m’exploiter, me compromettre, me perdre, il me crierait “papa”, comme dans mon rêve.
« Et je me dis que j’ai tué la mère et perdu cet être atrophié, larve d’écurie, éclose et poussée dans le fumier, cet homme qui, élevé comme d’autres, aurait été pareil aux autres.
« Et vous ne vous figurez pas la sensation étrange, confuse et intolérable que j’éprouve en face de lui en songeant que cela est sorti de moi, qu’il tient à moi par ce lien intime qui lie le fils au père, que, grâce aux terribles lois de l’hérédité, il est moi par mille choses, par son sang et par sa chair, et qu’il a jusqu’aux mêmes germes de maladies, aux mêmes ferments de passions.
« Et j’ai sans cesse un inapaisable et douloureux besoin de le voir ; et sa vue me fait horriblement souffrir ; et de ma fenêtre, là-bas, je le regarde pendant des heures remuer et charrier les ordures des bêtes, en me répétant : “C’est mon fils.”
« Et je sens, parfois, d’intolérables envies de l’embrasser. Je n’ai même jamais touché sa main sordide. »
L’académicien se tut. Et son compagnon, l’homme politique, murmura : « Oui, vraiment nous devrions bien nous occuper un peu plus des enfants qui n’ont pas de père. »
Et un souffle de vent traversant le grand arbre jaune secoua ses grappes, enveloppa d’une nuée odorante et fine les deux vieillards qui la respirèrent à longs traits.
Et le sénateur ajouta : « C’est bon vraiment d’avoir vingt-cinq ans, et même de faire des enfants comme ça. »
19 avril 1882
On l’appelait Saint-Antoine, parce qu’il se nommait Antoine, et aussi peut-être parce qu’il était bon vivant, joyeux, farceur, puissant mangeur et fort buveur, et vigoureux trousseur de servantes, bien qu’il eût plus de soixante ans.
C’était un grand paysan du pays de Caux, haut en couleur, gros de poitrine et de ventre, et perché sur de longues jambes qui semblaient trop maigres pour l’ampleur du corps.
Veuf, il vivait seul avec sa bonne et ses deux valets dans sa ferme qu’il dirigeait en madré compère, soigneux de ses intérêts, entendu dans les affaires et dans l’élevage du bétail, et dans la culture de ses terres. Ses deux fils et ses trois filles mariés avec avantage, vivaient aux environs, et venaient, une fois par mois, dîner avec le père. Sa vigueur était célèbre dans tout le pays d’alentour : on disait, en manière de proverbe : « Il est fort comme Saint-Antoine. »
Lorsque arriva l’invasion prussienne, Saint-Antoine, au cabaret, promettait de manger une armée, car il était hâbleur comme un vrai Normand, un peu couard et fanfaron. Il tapait du poing sur la table de bois, qui sautait en faisant danser les tasses et les petits verres, et il criait, la face rouge et l’œil sournois, dans une fausse colère de bon vivant : « Faudra que j’en mange, nom de Dieu ! » Il comptait bien que les Prussiens ne viendraient pas jusqu’à Tanneville ; mais lorsqu’il apprit qu’ils étaient à Rautôt, il ne sortit plus de sa maison, et il guettait sans cesse la route par la petite fenêtre de sa cuisine, s’attendant à tout moment à voir passer des baïonnettes.
Un matin, comme il mangeait la soupe avec ses serviteurs, la porte s’ouvrit, et le maire de la commune, maître Chicot, parut suivi d’un soldat coiffé d’un casque noir à pointe de cuivre. Saint-Antoine se dressa d’un bond ; et tout son monde le regardait, s’attendant à le voir écharper le Prussien ; mais il se contenta de serrer la main du maire qui lui dit : « En v’là un pour toi, Saint-Antoine. Ils sont venus c’te nuit. Fais pas de bêtises surtout, vu qu’ils parlent de fusiller et de brûler tout si seulement il arrive la moindre chose. Te v’là prévenu. Donne-li à manger, il a l’air d’un bon gars. Bonsoir, je vas chez l’s’ autres. Y en a pour tout le monde. » Et il sortit.
Le père Antoine, devenu pâle, regarda son Prussien. C’était un gros garçon à la chair grasse et blanche, aux yeux bleus, au poil blond, barbu jusqu’aux pommettes, qui semblait idiot, timide et bon enfant. Le Normand malin le pénétra tout de suite, et, rassuré, lui fit signe de s’asseoir. Puis il lui demanda : « Voulez-vous de la soupe ? » L’étranger ne comprit pas. Antoine alors eut un coup d’audace, et, lui poussant sous le nez une assiette pleine : « Tiens, avale ça, gros cochon. »
Читать дальше