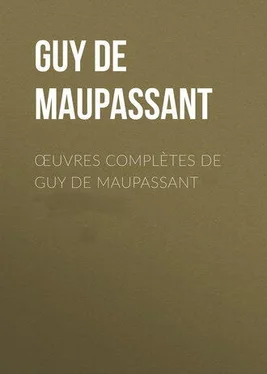Guy de Maupassant - Les sœurs Rondoli (1884)
Здесь есть возможность читать онлайн «Guy de Maupassant - Les sœurs Rondoli (1884)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Les sœurs Rondoli (1884)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Les sœurs Rondoli (1884): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Les sœurs Rondoli (1884)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La plupart des contes ont fait l'objet d'une publication antérieure dans des journaux comme Le Gaulois ou Gil Blas, parfois sous le pseudonyme de Maufrigneuse.
Les sœurs Rondoli (1884) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Les sœurs Rondoli (1884)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
« Et puis, vous savez, quand n’y en aura pu, y en a encore ; n’ vous gênez point. Je n’ suis pas regardant. Pû tôt que ce sera fini, pu que je serai content. »
Et il remonta dans son tilbury.
Il revint quatre jours plus tard. La vieille était devant sa porte, occupée à couper le pain de la soupe.
Il s’approcha, lui dit bonjour, lui parla dans le nez, histoire de sentir son haleine. Et il reconnut un souffle d’alcool. Alors son visage s’éclaira.
« Vous m’offrirez bien un verre de fil ? » dit-il.
Et ils trinquèrent deux ou trois fois.
Mais bientôt le bruit courut dans la contrée que la mère Magloire s’ivrognait toute seule. On la ramassait tantôt dans sa cuisine, tantôt dans sa cour, tantôt dans les chemins des environs, et il fallait la rapporter chez elle, inerte comme un cadavre.
Chicot n’allait plus chez elle, et, quand on lui parlait de la paysanne, il murmurait avec un visage triste :
« C’est-il pas malheureux, à son âge, d’avoir pris c’ t’ habitude-là ? Voyez-vous, quand on est vieux, y a pas de ressource. Ça finira bien par lui jouer un mauvais tour ! »
Ça lui joua un mauvais tour, en effet. Elle mourut l’hiver suivant, vers la Noël, étant tombée, soûle, dans la neige.
Et maître Chicot hérita de la ferme, en déclarant :
« C’te manante, si alle s’était point boissonnée, alle en avait bien pour dix ans de plus. »
7 avril 1884
Lui ?
À Pierre Decourcelle
Mon cher ami, tu n’y comprends rien ? et je le conçois. Tu me crois devenu fou ? Je le suis peut-être un peu, mais non pas pour les raisons que tu supposes.
Oui. Je me marie. Voilà.
Et pourtant mes idées et mes convictions n’ont pas changé. Je considère l’accouplement légal comme une bêtise. Je suis certain que huit maris sur dix sont cocus. Et ils ne méritent pas moins pour avoir eu l’imbécillité d’enchaîner leur vie, de renoncer à l’amour libre, la seule chose gaie et bonne au monde, de couper l’aile à la fantaisie qui nous pousse sans cesse à toutes les femmes, etc., etc. Plus que jamais je me sens incapable d’aimer une femme, parce que j’aimerai toujours trop toutes les autres. Je voudrais avoir mille bras, mille lèvres et mille… tempéraments pour pouvoir étreindre en même temps une armée de ces êtres charmants et sans importance.
Et cependant je me marie.
J’ajoute que je ne connais guère ma femme de demain. Je l’ai vue seulement quatre ou cinq fois. Je sais qu’elle ne me déplaît point ; cela me suffit pour ce que j’en veux faire. Elle est petite, blonde et grasse. Après-demain, je désirerai ardemment une femme grande, brune et mince.
Elle n’est pas riche. Elle appartient à une famille moyenne. C’est une jeune fille comme on en trouve à la grosse, bonnes à marier, sans qualités et sans défauts apparents, dans la bourgeoisie ordinaire. On dit d’elle : « Mlle Lajolle est bien gentille. » On dira demain : « Elle est fort gentille, Mme Raymon. » Elle appartient enfin à la légion des jeunes filles honnêtes « dont on est heureux de faire sa femme » jusqu’au jour où on découvre qu’on préfère justement toutes les autres femmes à celle qu’on a choisie.
Alors pourquoi me marier, diras-tu ?
J’ose à peine t’avouer l’étrange et invraisemblable raison qui me pousse à cet acte insensé.
Je me marie pour n’être pas seul.
Je ne sais comment dire cela, comment me faire comprendre. Tu auras pitié de moi, et tu me mépriseras, tant mon état d’esprit est misérable.
Je ne veux plus être seul, la nuit. Je veux sentir un être près de moi, contre moi, un être qui peut parler, dire quelque chose, n’importe quoi.
Je veux pouvoir briser son sommeil ; lui poser une question quelconque brusquement, une question stupide pour entendre une voix, pour sentir habitée ma demeure, pour sentir une âme en éveil, un raisonnement en travail, pour voir, allumant brusquement ma bougie, une figure humaine à mon côté…, parce que… parce que… (je n’ose pas avouer cette honte)… parce que j’ai peur, tout seul.
Oh ! tu ne me comprends pas encore.
Je n’ai pas peur d’un danger. Un homme entrerait, je le tuerais sans frissonner. Je n’ai pas peur des revenants ; je ne crois pas au surnaturel. Je n’ai pas peur des morts ; je crois à l’anéantissement définitif de chaque être qui disparaît !
Alors !… Oui, alors !… Eh bien ! j’ai peur de moi ! j’ai peur de la peur ; peur des spasmes de mon esprit qui s’affole, peur de cette horrible sensation de la terreur incompréhensible.
Ris si tu veux. Cela est affreux, inguérissable. J’ai peur des murs, des meubles, des objets familiers qui s’animent, pour moi, d’une sorte de vie animale. J’ai peur surtout du trouble horrible de ma pensée, de ma raison qui m’échappe brouillée, dispersée par une mystérieuse et invisible angoisse.
Je sens d’abord une vague inquiétude qui me passe dans l’âme et me fait courir un frisson sur la peau. Je regarde autour de moi. Rien ! Et je voudrais quelque chose ! Quoi ? Quelque chose de compréhensible. Puisque j’ai peur uniquement parce que je ne comprends pas ma peur.
Je parle ! j’ai peur de ma voix. Je marche ! j’ai peur de l’inconnu de derrière la porte, de derrière le rideau, de dans l’armoire, de sous le lit. Et pourtant je sais qu’il n’y a rien nulle part.
Je me retourne brusquement parce que j’ai peur de ce qui est derrière moi, bien qu’il n’y ait rien et que je le sache.
Je m’agite, je sens mon effarement grandir ; et je m’enferme dans ma chambre ; et je m’enfonce dans mon lit, et je me cache sous mes draps ; et blotti, roulé comme une boule, je ferme les yeux désespérément, et je demeure ainsi pendant un temps infini avec cette pensée que ma bougie demeure allumée sur ma table de nuit et qu’il faudrait pourtant l’éteindre. Et je n’ose pas.
N’est-ce pas affreux, d’être ainsi ?
Autrefois, je n’éprouvais rien de cela. Je rentrais tranquillement. J’allais et je venais en mon logis sans que rien troublât la sérénité de mon âme. Si l’on m’avait dit quelle maladie de peur invraisemblable, stupide et terrible, devait me saisir un jour, j’aurais bien ri ; j’ouvrais les portes dans l’ombre avec assurance ; je me couchais lentement sans pousser les verrous, et je ne me relevais jamais au milieu des nuits pour m’assurer que toutes les issues de ma chambre étaient fortement closes.
Cela a commencé l’an dernier d’une singulière façon.
C’était en automne, par un soir humide. Quand ma bonne fut partie, après mon dîner, je me demandai ce que j’allais faire. Je marchai quelque temps à travers ma chambre. Je me sentais las, accablé sans raison, incapable de travailler, sans force même pour lire. Une pluie fine mouillait les vitres ; j’étais triste, tout pénétré par une de ces tristesses sans causes qui vous donnent envie de pleurer, qui vous font désirer de parler à n’importe qui pour secouer la lourdeur de notre pensée.
Je me sentais seul. Mon logis me paraissait vide comme il n’avait jamais été. Une solitude infinie et navrante m’entourait. Que faire ? Je m’assis. Alors une impatience nerveuse me courut dans les jambes. Je me relevai, et je me remis à marcher. J’avais peut-être aussi un peu de fièvre, car mes mains, que je tenais rejointes derrière mon dos, comme on fait souvent quand on se promène avec lenteur, se brûlaient l’une à l’autre, et je le remarquai. Puis soudain un frisson de froid me courut dans le dos. Je pensai que l’humidité du dehors entrait chez moi, et l’idée de faire du feu me vint. J’en allumai ; c’était la première fois de l’année. Et je m’assis de nouveau en regardant la flamme. Mais bientôt l’impossibilité de rester en place me fit encore me relever, et je sentis qu’il fallait m’en aller, me secouer, trouver un ami.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Les sœurs Rondoli (1884)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Les sœurs Rondoli (1884)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Les sœurs Rondoli (1884)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.