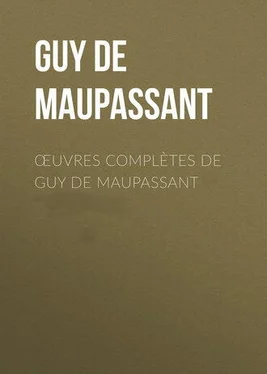Guy de Maupassant - Toine (1885)
Здесь есть возможность читать онлайн «Guy de Maupassant - Toine (1885)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Toine (1885)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Toine (1885): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Toine (1885)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La plupart des contes ont fait l'objet d'une publication antérieure dans des journaux comme Gil Blas, parfois sous le pseudonyme de Maufrigneuse.
Toine (1885) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Toine (1885)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Il ne répondit pas.
Après quelques jours encore, il reçut la visite de l’aumônier de l’hôpital.
La fille Irma Pavolin, à son lit de mort, le suppliait de venir.
Il n’osa pas refuser de suivre l’aumônier, mais il entra dans l’hôpital le cœur gonflé de rancune méchante, de vanité blessée, d’orgueil humilié.
Il ne la trouva guère changée et pensa qu’elle s’était moquée de lui.
— Qu’est-ce que tu me veux ? dit-il.
J’ai voulu te dire adieu. Il paraît que je suis tout à fait bas.
Il ne la crut pas.
— Ecoute, tu me rends la risée du régiment, et je ne veux pas que ça continue.
Elle demanda :
— Qu’est-ce que je t’ai fait, moi ?
Il s’irrita de n’avoir rien à répondre.
— Ne compte pas que je reviendrai ici pour faire me moquer de moi par tout le monde !
Elle le regarda de ses yeux éteints où s’allumait une colère, et elle répéta :
— Qu’est-ce que je t’ai fait, moi ? Je n’ai pas été gentille avec toi, peut-être ? Est-ce que je t’ai quelquefois demandé quelque chose ? Sans toi, je serais restée avec M. Templier-Papon et je ne me trouverais pas ici aujourd’hui. Non, vois-tu, si quelqu’un a des reproches à me faire, ça n’est pas toi.
Il reprit, d’un ton vibrant :
— Je ne te fais pas de reproches, mais je ne peux pas continuer à venir te voir, parce que ta conduite avec les Prussiens a été la honte de toute la ville.
Elle s’assit, d’une secousse, dans son lit :
— Ma conduite avec les Prussiens ? Mais quand je te dis qu’ils m’ont prise, et quand je te dis que, si je ne me suis pas soignée, c’est parce que j’ai voulu les empoisonner. Si j’avais voulu me guérir, ça n’était pas difficile, parbleu ! Mais je voulais les tuer, moi, et j’en ai tué, va !
Il restait debout :
— Dans tous les cas, c’est honteux, dit-il.
Elle eut une sorte d’étouffement, puis reprit :
— Qu’est-ce qui est honteux, de m’être fait mourir pour les exterminer, dis ? Tu ne parlais pas comme ça quand tu venais chez moi, rue Jeanne-d’Arc ? Ah ! C’est honteux ! Tu n’en aurais pas fait autant, toi, avec ta croix d’honneur ! Je l’ai plus méritée que toi, vois-tu, plus que toi, et j’en ai tué plus que toi, des Prussiens !...
Il demeurait stupéfait devant elle, frémissant d’indignation.
— Ah ! Tais-toi... tu sais... tais-toi ... parce que... ces choses-là... je ne permets pas... qu’on y touche... Mais elle ne l’écoutait guère :
— Avec ça que vous leur avez fait bien du mal aux Prussiens ! Ça serait-il arrivé si vous les aviez empêchés de venir à Rouen ? Dis ? C’est vous qui deviez les arrêter, entends-tu. Et je leur ai fait plus de mal que toi, moi, oui, plus de mal, puisque je vais mourir, tandis que tu te ballades, toi, et que tu fais le beau pour enjôler les femmes...
Sur chaque lit une tête s’était dressée et tous les yeux regardaient cet homme en uniforme qui bégayait :
— Tais-toi... tu sais... tais-toi...
Mais elle ne se taisait pas. Elle criait :
— Ah ! Oui, tu es un joli poseur. Je te connais, va. Je te connais. Je te dis que je leur ai fait plus de mal que toi, moi, et que j’en ai tué plus que tout ton régiment réuni ... va donc ... capon !
Il s’en allait, en effet, il fuyait, allongeant ses grandes jambes, passant entre les deux rangs de lits où s’agitaient les syphilitiques. Et il entendait la voix haletante, sifflante, d’Irma, qui le poursuivait :
— Plus que toi, oui, j’en ai tué plus que toi, plus que toi...
Il dégringola l’escalier quatre à quatre, et courut s’enfermer chez lui.
Le lendemain, il apprit qu’elle était morte.
8 juillet 1884
Le protecteur
Il n’aurait jamais rêvé une fortune si haute ! Fils d’un huissier de province, Jean Marin était venu, comme tant d’autres, faire son droit au quartier latin. Dans les différentes brasseries qu’il avait successivement fréquentées, il était devenu l’ami de plusieurs étudiants bavards qui crachaient de la politique en buvant des bocks. Il s’éprît d’admiration pour eux et les suivit avec obstination, de café en café, payant même leurs consommations quand il avait de l’argent.
Puis il se fit avocat et plaida des causes qu’il perdit. Or, voilà qu’un matin, il apprit dans les feuilles qu’un de ses anciens camarades du quartier venait d’être élu député.
Il fut de nouveau son chien fidèle l’ami qui fait les corvées, les démarches, qu’on envoie chercher quand on a besoin de lui et avec qui on ne se gêne point. Mais il arriva par aventure parlementaire que le député devint ministre ; six mois après Jean Marin était nommé conseiller d’Etat.
Il eut d’abord une crise d’orgueil à en perdre la tête. Il allait dans les rues pour le plaisir de se montrer comme si on eût pu deviner sa position rien qu’à le voir. Il trouvait le moyen de dire aux marchands chez qui il entrait, aux vendeurs de journaux, même aux cochers de fiacre, à propos des choses les plus insignifiantes :
— Moi qui suis conseiller d’Etat...
Puis il éprouva, naturellement., comme par suite de sa dignité, par nécessité Professionnelle, par devoir d’homme puissant et généreux, un impérieux besoin de protéger. Il offrait son appui à tout le monde, en toute occasion, avec une inépuisable générosité.
Quand il rencontrait sur les boulevards une figure de connaissance, il s’avançait d’un air ravi, prenait les mains, s’informait de la santé, puis, sans attendre les questions, déclarait :
— Vous savez, moi, je suis conseiller d’Etat et tout à votre service. Si je puis vous être utile à quelque chose, usez de moi sans vous gêner. Dans ma position on a le bras long.
Et alors il entrait dans les cafés avec l’ami rencontré pour demander une plume, de l’encre et une feuille de papier à lettre : « Une seule, garçon c’est pour écrire une lettre de recommandation. »
Et il en écrivait des lettres de recommandation, dix, vingt, cinquante par jour. Il en écrivait au café Américain, chez Bignon, chez Tortoni, à la Maison-Dorée, au café Riche, au Helder, au café Anglais, au Napolitain, partout, partout. Il en écrivait à tous les fonctionnaires de la République, depuis les juges de paix jusqu’aux ministres. Et il était heureux, tout à fait heureux.
Un matin comme il sortait de chez lui pour se rendre au Conseil d’Etat, la pluie se mit à tomber. Il hésita à prendre un fiacre, mais il n’en prit pas, et s’en fut à pied, par les rues.
L’averse devenait terrible, noyait les trottoirs, inondait la chaussée. M. Martin fut contraint de se réfugier sous une porte. Un vieux prêtre était déjà là, un vieux prêtre à cheveux blancs. Avant d’être conseiller d’Etat, M. Marin n’aimait point le clergé. Maintenant il le traitait avec considération depuis qu’un cardinal l’avait consulté poliment sur une affaire difficile. La pluie tombait en inondation, forçant les deux hommes à fuir jusqu’à la loge du concierge pour éviter les éclaboussures. M. Marin, qui éprouvait toujours la démangeaison de parler pour se faire valoir, déclara :
— Voici un bien vilain temps, Monsieur l’abbé.
Le vieux prêtre s’inclina :
— Oh ! Oui, Monsieur, c’est bien désagréable lorsqu’on ne vient à Paris que pour quelques jours.
— Ah ! Vous êtes de province ?
— Oui, Monsieur, je ne suis ici qu’en passant.
— En effet, c’est très désagréable d’avoir de la pluie pour quelques jours passés dans la capitale. Nous autres, fonctionnaires, qui demeurons ici toute l’année, nous n’y songeons guère.
L’abbé ne répondait pas. Il regardait la rue où l’averse tombait moins pressée. Et soudain, prenant une résolution, il releva sa soutane comme les femmes relèvent leurs robes pour passer les ruisseaux.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Toine (1885)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Toine (1885)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Toine (1885)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.