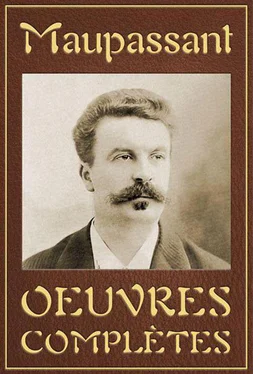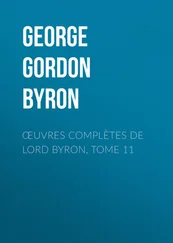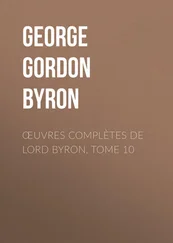Elle est parfaite, cette enfant, réservée et distinguée plus que personne. J’entends dire :
— Comme elle est jolie, cette petite marquise !..
27 juin . — Premier bain. On descend directement de la chambre dans les piscines, où vingt baigneurs trempent, déjà vêtus de longues robes de laine, hommes et femmes ensemble. Les uns mangent, les autres lisent, les autres causent. On pousse devant soi de petites tables flottantes. Parfois on joue au furet, ce qui n’est pas toujours convenable. Vus des galeries qui entourent le bain, nous avons l’air de gros crapauds dans un baquet.
Berthe est venue s’asseoir dans cette galerie pour causer un peu avec moi. On l’a beaucoup regardée.
28 juin . — Deuxième bain. Quatre heures d’eau. J’en aurai huit heures dans huit jours. J’ai pour compagnons plongeurs le prince de Vanoris (Italie), le comte Lovenberg (Autriche), le baron Samuel Vernhe (Hongrie ou ailleurs), plus une quinzaine de personnages de moindre importance, mais tous nobles. Tout le monde est noble dans les villes d’eaux.
Ils me demandent, l’un après l’autre, à être présentés à Berthe. Je réponds : « Oui ! » et je me dérobe. On me croit jaloux, c’est bête !
29 juin . — Diable ! Diable ! La princesse de Vanoris est venue elle-même me trouver, désirant faire la connaissance de ma femme, au moment où nous rentrions à l’hôtel. J’ai présenté Berthe, mais je l’ai priée d’éviter avec soin de rencontrer cette dame.
2 juillet . — Le prince nous a pris au collet pour nous mener dans son appartement, où tous les baigneurs de marque prenaient le thé. Berthe était certes mieux que toutes les femmes ; mais que faire ?
3 juillet . — Ma foi, tant pis ! Parmi ces trente gentilshommes, n’en est-il pas au moins dix de fantaisie ? Parmi ces seize ou dix-sept femmes, en est-il plus de douze sérieusement mariées ; et, sur ces douze, en est-il plus de six irréprochables ? Tant pis pour elles, tant pis pour eux ! Ils l’ont voulu !
10 juillet . — Berthe est la reine de Loëche ! Tout le monde en est fou ; on la fête, on la gâte, on l’adore ! Elle est d’ailleurs superbe de grâce et de distinction. On m’envie.
La princesse de Vanoris m’a demandé :
— Ah çà ! Marquis, où donc avez-vous trouvé ce trésor-là ?
J’avais envie de répondre :
— Premier prix du Conservatoire, classe de comédie, engagée à l’Odéon, libre à partir du 5 août 1880 !
Quelle tête elle aurait fait, miséricorde !
20 juillet . — Berthe est vraiment surprenante. Pas une faute de tact, pas une faute de goût ; une merveille !
10 août . — Paris. Fini. J’ai le cœur gros. La veille du départ, je crus que tout le monde allait pleurer.
On résolut d’aller voir lever le soleil sur le Torrenthorn, puis de redescendre pour l’heure de notre départ.
On se mit en route vers minuit, sur des mulets. Des guides portaient des falots : et la longue caravane se déroulait dans les chemins tournants de la forêt de pins. Puis on traversa les pâturages où des troupeaux de vaches errent en liberté. Puis on atteignit la région des pierres, où l’herbe elle-même disparaît.
Parfois, dans l’ombre, on distinguait, soit à droite, soit à gauche, une masse blanche, un amoncellement de neige dans un trou de la montagne.
Le froid devenait mordant, piquait les yeux et la peau. Le vent desséchant des sommets soufflait, brûlant les gorges, apportant les haleines gelées de cent lieues de pics de glace.
Quand on parvint au faite, il faisait nuit encore. On déballa toutes les provisions pour boire le champagne au soleil levant.
Le ciel pâlissait sur nos têtes. Nous apercevions déjà un gouffre à nos pieds ; puis, à quelques centaines de mètres, un autre sommet.
L’horizon entier semblait livide, sans qu’on distinguât rien encore au loin.
Bientôt on découvrit, à gauche, une cime énorme, la Jungfrau, puis une autre, puis une autre. Elles apparaissaient peu à peu comme si elles se fussent levées dans le jour naissant. Et nous demeurions stupéfaits de nous trouver ainsi au milieu de ces colosses, dans ce pays désolé de la neige éternelle. Soudain, en face, se déroula la chaîne démesurée du Piémont. D’autres cimes apparurent au nord. C’était bien l’immense pays des grands monts aux fronts glacés, depuis le Rhindenhorn, lourd comme son nom, jusqu’au fantôme à peine visible du patriarche des Alpes, le mont Blanc.
Les uns étaient fiers et droits, d’autres accroupis, d’autres difformes, mais tous pareillement blancs, comme si quelque Dieu avait jeté sur la terre bossue une nappe immaculée.
Les uns semblaient si près qu’on aurait pu sauter dessus ; les autres étaient si loin qu’on les distinguait à peine.
Le ciel devint rouge ; et tous rougirent. Les nuages semblaient saigner sur eux. C’était superbe, presque effrayant.
Mais bientôt la nue enflammée pâlit, et toute l’armée des cimes insensiblement devint rose, d’un rose doux et tendre comme des robes de jeune fille.
Et le soleil parut au-dessus de la nappe des neiges. Alors, tout à coup, le peuple entier des glaciers fut blanc, d’un blanc luisant, comme si l’horizon eût été plein d’une foule de dômes d’argent.
Les femmes, extasiées, regardaient cela.
Elles tressaillirent, un bouchon de champagne venait de sauter ; et le prince de Vanoris, présentant un verre à Berthe, s’écria :
— Je bois à la marquise de Roseveyre !
Tous crièrent : « Je bois à la marquise de Roseveyre ! »
Elle monta debout sur sa mule et répondit :
— Je bois à tous mes amis !
Trois heures plus tard, nous prenions le train pour Genève, dans la vallée du Rhône.
À peine fûmes-nous seuls que Berthe, si heureuse et si gaie tout à l’heure, se mit à sangloter, la figure dans ses mains.
Je m’élançai à ses genoux :
— Qu’as-tu ? Qu’as-tu ? Dis-moi, qu’as-tu ?
Elle balbutia à travers ses larmes :
— C’est… c’est… c’est donc fini d’être une honnête femme !
Certes, je fus à ce moment sur le point de faire une bêtise, une grande bêtise !.. Je ne la fis pas.
Je quittai Berthe en rentrant à Paris. J’aurais peut-être été trop faible, plus tard.
(Le journal du marquis de Roseveyre n’offre aucun intérêt pendant les deux années qui suivirent. Nous retrouvons à la date du 20 juillet 1883 les lignes suivantes.)
20 juillet 1883 . — Florence. Triste souvenir tantôt. Je me promenais aux Cassines quand une femme fit arrêter sa voiture et m’appela. C’était la princesse de Vanoris. Dès qu’elle me vit à portée de voix :
— Oh ! Marquis, mon cher marquis, que je suis contente de vous rencontrer ! Vite, vite, donnez-moi des nouvelles de la marquise ; c’est bien la plus charmante femme que j’aie vue en toute ma vie.
Je restai surpris, ne sachant que dire et frappé au cœur d’un coup violent. Je balbutiai :
— Ne me parlez jamais d’elle, princesse, voici trois ans que je l’ai perdue.
Elle me prit la main.
— Oh que je vous plains, mon ami !
Elle me quitta. Je suis rentré triste, mécontent, pensant à Berthe, comme si nous venions de nous séparer.
Le Destin bien souvent se trompe !
Combien de femmes honnêtes étaient nées pour être des filles, et le prouvent.
Pauvre Berthe ! Combien d’autres étaient nées pour être des femmes honnêtes… Et celle-là… plus que toutes… peut-être… Enfin… n’y pensons plus.
24 juillet 1883
En Bretagne
Juillet 1882
Voici la saison des voyages, la saison claire où l’on aime les horizons nouveaux, les vastes étendues de mer bleue où se repose l’œil, où se calme l’esprit, les vallons boisés et frais où parfois le cœur s’attendrit sans qu’on sache pourquoi, quand on s’assied, au soir tombant, sur un talus de route en velours vert et qu’on regarde, à ses pieds, un peu d’eau brune et dormante où se mire le soleil couchant au fond de l’ornière creusée par des roues de charrettes.
Читать дальше