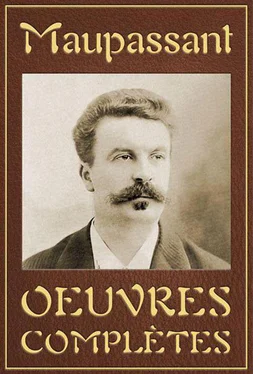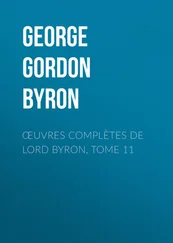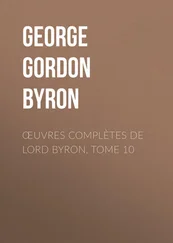Car Djelfa est une ville, une petite ville d’Europe, non une ville arabe, une petite ville qui a même une petite rivière où on pêche des petits poissons, où on voit des boutiques le long des rues, et des épiciers mozabites ou juifs, attendant le client, comme chez nous.
Mais soudain, au milieu d’un passage étroit enfermé entre deux lignes de maisons apparut, grande, mince, le corps cambre, drapée superbement sous des étoffes rouges et bleues, la tête couverte d’une montagne inimaginable de cheveux noirs formant une sorte de tour carrée, soutenue par un étrange diadème et par des chapelets de médailles qui serpentaient dedans, la gorge disparue sous des colliers faits avec des pièces de vingt francs, le ventre emprisonné sous une bizarre plaque d’argent naïvement ciselée où pendait, au bout d’une chaîne, une serrure symbolique, les bras couverts de bracelets, les chevilles chargées d’anneaux, une femme, une Ouled Naïl, une courtisane du Sud.
Dans cette petite ville de colons, poussée en plein désert, l’apparition subite de cet être éclatant et magnifique, couvert de parures, au visage tatoué d’étoiles bleues, à la démarche fière comme celle d’une reine barbare, me saisit d’étonnement et d’admiration. Plus loin j’en vis une autre debout sur le seuil de son logis, encadrée par sa porte, comme en une niche d’idole. La masse de ses cheveux édifiés en monument touchait le haut de l’entrée ; et elle nous regardait avec des yeux fixes, dédaigneux, vaguement souriants. Elles n’étaient belles ni l’une ni l’autre, mais inexprimablement étranges et saisissantes, bestiales et mystiques, parées pour des vices primitifs exigeants et simples de nomades.
D’autres nous apparurent encore. Dans ce village franco-arabe elles étaient plus de cinquante, car Bou-Amama, en ce temps-là, terrorisait les petites oasis de l’Ouest et avait forcé les courtisanes couvertes d’argent et d’or à se réfugier à Djelfa, centre de la tribu des Ouled Naïl, à laquelle beaucoup de ces femmes appartenaient.
C’est une tradition dans cette tribu, tradition acceptée, presque respectée par tout le peuple arabe, que les filles aillent amasser dans les ksours et villages, en se livrant aux hommes, la dot qu’elles rapporteront pour se marier chez elles.
Après le dîner, au mess des officiers, dont je n’oublierai jamais l’accueil charmant, un d’eux me proposa d’aller au Café Maure.
De loin, trois ou quatre rues avant celle où était placé cet établissement, on entendait la clameur aiguë, assourdie par les murs de terre, de la flûte en corne noire qui semblait un cri féroce, ininterrompu, mystérieux. Certes, quand Aïssa viendra, au dernier jour, réveiller les morts, il fera sortir de terre les cadavres arabes couchés sous les pierres du désert, au son de la rhaïka .
Nous approchons ; des fantômes blancs sont debout devant la porte, immobiles sous le flot de clarté jaune qui jaillit de ce lieu, et va frapper, de l’autre côté de la rue, ce mur de chaux où des silhouettes noires sont plaquées. D’autres hommes accroupis le long de ce logis, pour ne point payer l’entrée, écoutent. Il faut écarter ces corps qui ne se dérangent jamais, les bousculer et les enjamber et j’aperçois, dans une pièce basse, claire, nue et vaste, pleine de fumée d’huile à quinquet et de tabac, un monceau d’Arabes, debout, couchés, roulés, deux cents peut-être, ne laissant au milieu d’eux qu’un étroit et long passage sur le sol nu où glissent l’une en face de l’autre deux femmes qui dansent, la taille droite et la tête immobile. Seul le ventre s’agite, tressaille, traversé de frissons, et les jambes aussi remuent sans qu’on devine sous la robe éclatante et longue quel mouvement elles font, comment elles portent ce torse rigide et cette tête sévère avec ce glissement mystérieux, charmant, incompréhensible, scandé parfois d’un coup de talon sec qui rend encore plus étrange cette danse auguste et primitive. Les tambourins et la rhaïka accélèrent leur vacarme formidable, crispent, tordent, déchirent, affolent les nerfs ; et on comprend quel autre effet cela doit produire sur ces primitifs.
Devant les premiers Arabes vautrés à terre, une ligne d’autres danseuses est accroupie. Elles attendent leur tour pour se montrer. Deux d’entre elles tout à l’heure se lèveront, le corps sonnant sous les parures d’or et d’argent dont l’amour des hommes les a couvertes et, un mouchoir de soie bleue ou rouge tenu par les bouts entre leurs mains et balancé devant leur visage impassible, elles allumeront, en dansant aussi, les désirs dans les cœurs, afin d’amasser une dot pour l’époux.
Ce que je vis à Tunis m’a plus surpris encore, bien que je fusse préparé par plusieurs mois passés, à deux reprises différentes, dans l’intérieur des pays arabes, à tout ce qu’ils peuvent nous révéler de singulier. A Tunis, nous ne pouvons pénétrer ni dans les mœurs, ni dans les maisons des indigènes. Ils vivent à côté de nous, soumis, semble-t-il, à des lois européennes, ou plutôt à la police qui gouverne la voie publique, mais libres, en leurs demeures, de tout faire puisque nous n’y entrons point. Un prélat, que ses immenses propriétés et de grosses sommes gagnées, dit-on, par ses participations heureuses aux affaires de la jeune colonie, ont fait surnommer, là-bas, Monseigneur Mercanti, prêche une croisade contre les nègres esclaves chassés comme du gibier en des contrées lointaines ; pourquoi ne s’occupe-t-il pas plutôt de l’esclavage à Tunis, où on achète l’ouvrier au moyen d’un subterfuge très simple, où tout musulman peut acheter une femme, deux femmes, autant de femmes qu’il veut, pour les enfermer dans une oubliette conjugale où elles disparaissent, où il en fait ce qu’il lui plaît, où la seule loi qui veille véritablement sur elles est le grand principe d’économie domestique auquel obéissent secrètement tous les propriétaires de chair humaine ou d’autre chose.
Donc, un soir, un fonctionnaire français, fort gracieux et armé d’un pouvoir redoutable pour les Arabes, m’offrit de voir ensemble tout ce qu’on peut voir à Tunis la nuit.
Nous dûmes être accompagnés par un agent de la police beylicale sans quoi, aucune porte, même celle des plus vils bouges indigènes, ne se serait ouverte devant nous.
La ville arabe d’Alger est pleine d’agitation nocturne. Dès que le soir vient, Tunis est mort. Les petites rues étroites, tortueuses, inégales, semblent des couloirs d’une cité abandonnée, dont on a oublié d’éteindre le gaz, par places.
Nous voici partis très loin, dans ce labyrinthe de murs blancs ; et on nous fit entrer chez des juives qui dansaient la « danse du ventre ». Cette danse est laide, disgracieuse, curieuse seulement pour les amateurs par la maestria de l’artiste. Trois sueurs, trois filles très parées faisaient leurs contorsions impures, sous l’œil bienveillant de leur mère, une énorme petite boule de graisse vivante coiffée d’un cornet de papier doré, et mendiant pour les frais généraux de la maison, après chaque crise de trépidation des ventres de ses enfants. Autour du salon, trois portes entrebâillées montraient les couches basses de trois chambres. J’ouvris une quatrième porte et je vis, dans un lit, une femme couchée qui me parut belle. On se précipita sur moi, mère, danseuses, deux domestiques nègres et un homme inaperçu qui regardait, derrière un rideau, s’agiter pour nous le flanc de ses sueurs. J’allais entrer dans la chambre de sa femme légitime qui était enceinte, de la belle-fille, de la belle-sueur des drôlesses qui tentaient, mais en vain, de nous mêler, ne fût-ce qu’un soir, à la famille. Pour me faire pardonner cette défense d’entrer, on m’amena le premier enfant de cette dame, une petite fille de trois ou quatre ans, qui esquissait déjà la « danse du ventre ».
Читать дальше