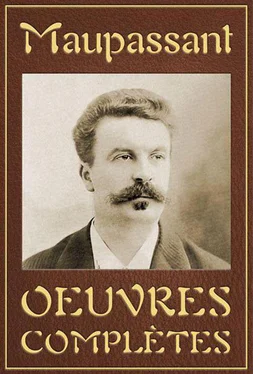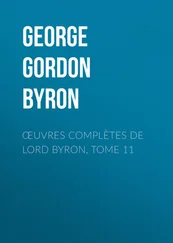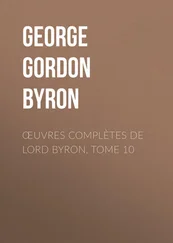Cependant, il ne codifia point sa manière de créer comme il est d’usage de k faire aujourd’hui. Il produisit simplement avec une surprenante abondance et une infinie variété.
Derrière lui, une école se forma bientôt, qui, s’autorisant de ce que Balzac écrivait mal, n’écrivit plus du tout, et érigea en règle la copie précise de la vie. M. Champfleury fut un des plus remarquables chefs de ces réalistes, dont un des meilleurs, Duranty, a laissé un fort curieux roman : Le Malheur d’Henriette Gérard .
Jusque-là, tous les écrivains qui avaient eu le souci de donner en leurs livres la sensation de la vérité semblent s’être peu préoccupés de ce qu’on appelait l’art d’écrire. On eût dit que, pour eux, le style était une sorte de convention dans l’exécution, inséparable de la convention dans la conception, et que la langue châtiée et artiste apportait un air emprunté, un air irréel aux personnages du roman qu’on voulait créer tout à fait pareils à ceux des rues.
C’est alors qu’un jeune homme, doué d’un tempérament lyrique, nourri des classiques, épris de l’art littéraire, du style et du rythme des phrases à n’avoir plus d’autre amour dans le cœur, et armé aussi d’un œil admirable d’observateur, de cet œil qui voit en même temps les ensembles et les détails, les formes et les couleurs, et qui sait deviner les intentions secrètes tout en jugeant la valeur plastique des gestes et des faits, apporta dans l’histoire de la littérature française un livre d’une impitoyable exactitude et d’une impeccable exécution, Madame Bovary .
C’est à Gustave Flaubert qu’on doit l’accouplement du style et de l’observation modernes.
Mais la poursuite de la vérité, ou plutôt de la vraisemblance amenait peu à peu la recherche passionnée de ce qu’on appelle aujourd’hui le document humain.
Les ancêtres des réalistes actuels s’efforçaient d’inventer en imitant la vie ; les fils s’efforcent de reconstituer la vie même, avec des pièces authentiques qu’ils ramassent de tous les côtés. Et ils les ramassent avec une incroyable ténacité. Ils vont partout, furetant, guettant, une hotte au dos, comme des chiffonniers. Il en résulte que leurs romans sont souvent des mosaïques de faits arrivés en des milieux différents et dont les origines, de nature diverse, enlèvent au volume où ils sont réunis le caractère de vraisemblance et l’homogénéité que les auteurs devraient poursuivre avant tout.
Les plus personnels des romanciers contemporains qui ont apporté dans la chasse et l’emploi du document l’art le plus subtil et le plus puissant sont assurément les frères de Goncourt. Doués, en outre, de natures extraordinairement nerveuses, vibrantes, pénétrantes, ils sont arrivés à montrer, comme un savant qui découvre une couleur nouvelle, une nuance de la vie presque inaperçue avant eux. Leur influence sur la génération actuelle est considérable et peut être inquiétante, car, tout disciple outrant les procédés du maître tombe dans les défauts dont le sauvèrent ses qualités magistrales.
Procédant à peu près de la même façon, M. Zola, avec une nature plus forte, plus large, plus passionnée et moins raffinée, M. Daudet avec une manière plus adroite, plus ingénieuse, délicieusement fine et moins sincère peut-être, et quelques hommes plus jeunes comme MM. Bourget, de Bonniéres, etc., etc., complètent et semblent terminer le grand mouvement du roman moderne vers la vérité. Je ne cite point avec intention M. Pierre Loti, qui reste le prince des poètes fantaisistes en prose. Pour les débutants qui apparaissent aujourd’hui, au lieu de se tourner vers la vie avec une curiosité vorace, de la regarder partout autour d’eux avec avidité, d’en jouir ou d’en souffrir avec force suivant leur tempérament, ils ne regardent plus qu’en eux-mêmes, observent uniquement leur âme, leur cœur, leurs instincts, leurs qualités ou leurs défauts, et proclament que le roman définitif ne doit être qu’une autobiographie.
Mais comme le même cœur, même vu sous toutes ses faces, ne donne point des sujets sans fin, comme le spectacle de la même âme répété en dix volumes devient fatalement monotone, ils cherchent, par des excitations factices, par un entraînement étudié vers toutes les névroses, à produire en eux des âmes exceptionnellement bizarres qu’ils s’efforcent aussi d’exprimer par des mots exceptionnellement descriptifs, imagés et subtils.
Nous arrivons donc à la peinture du moi, du moi hypertrophié par l’observation intense, du moi en qui on inocule les virus mystérieux de toutes les maladies mentales.
Ces livres prédits, s’ils viennent comme on les annonce, ne seront-ils pas les petits-fils naturels et dégénérés de l’ Adolphe de Benjamin Constant ?
Cette tendance vers la personnalité étalée — car c’est la personnalité voilée qui fait la valeur de toute œuvre, et qu’on nomme génie ou talent — cette tendance n’est-elle pas une preuve de l’impuissance à observer, à observer la vie éparse autour de soi, comme ferait une pieuvre aux innombrables bras ?
Et cette définition, derrière laquelle se barricada Zola dans la grande bataille qu’il a livrée pour ses idées, ne sera-t-elle point toujours vraie, car elle peut s’appliquer à toutes les productions de l’art littéraire et à toutes les modifications qu’apporteront les temps : un roman, c’est la nature vue à travers un tempérament.
Ce tempérament peut avoir les qualités les plus diverses, et se modifier suivant les époques, mais plus il aura de facettes, comme le prisme, plus il reflétera d’aspects de la nature, de spectacles, de choses, d’idées de toute sorte et d’êtres de toute race, plus il sera grand, intéressant et neuf.
Danger public
( Le Gaulois , 23 décembre 1889)
J’imagine que la plupart des hommes de lettres pensent à peu près de même en politique. Nous sommes, en général, des indifférents, des indifférents utiles, à l’occasion, et facilement changeants. Lorsqu’on s’est formé des idées, justes ou fausses, un peu sur toutes choses, il reste un point sur lequel on ne peut en avoir que de très fluctuantes : c’est celui-là. En somme, la profession de foi de celui qui réfléchit, qui voit les causes et les raisons, qui a appris dans (histoire ce que sont les peuples, comment on gouverne, comment on rend grandes ou décadentes, glorieuses ou méprisées, sages ou folles, opulentes ou misérables, les enfantines et simples multitudes, ne peut guère se formuler que par de décourageantes constatations. Entre le gouvernement d’un seul, qui peut être la tyrannie d’une brute féroce, le suffrage restreint qui est un bâtard de l’injustice et du tremblement, et le suffrage universel, émanation directe de toutes les ignorances, de toutes les convoitises, de toutes les bassesses de l’animal humain sans culture, un homme éclairé ne doit avoir que de très vagues sympathies.
Mais, si ces sympathies ne peuvent s’attacher en principe à la forme du pouvoir, elles peuvent aller aux hommes qui l’exercent. Les grands tyrans ont toujours eu des cours d’hommes distingués ; les grandes républiques aussi. Je crois que la nôtre n’en aura pas.
Quand on est bien renseigné par la lecture, par la réflexion et par l’observation, sur les qualités que doivent posséder ceux qui sont appelés à gouverner les masses ; quand on a les notions que nous possédons aujourd’hui sur la nature, sur le caractère spécial, sur les mérites très particuliers des politiciens utiles, on les connaît, on les juge, et on les classe à leur valeur, avec une rapidité et une sûreté qui ne laissent plus guère de place à l’erreur.
Читать дальше