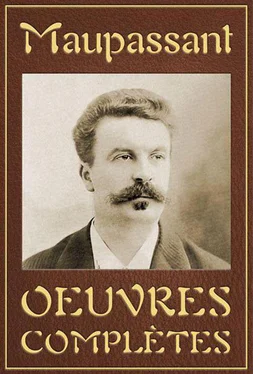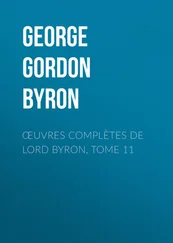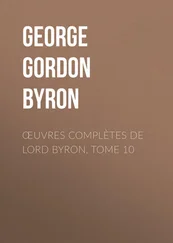« Il y eut un mouvement dans le groupe. On déposait à terre un tronçon.
— Encore une seconde, mon brave, dit le chirurgien.
« Je passais ma tête dans le créneau des épaules et je regardai le zouave.
— Allez vite, major, disait-il ; je sens que je vais battre la breloque.
« Il mordait sa moustache, blanc comme un mort et les yeux hors la tête. Il tenait lui-même à deux mains sa jambe et hurlait par moment d'une voix grelottante un « hou ! » qui vous faisait sentir la scie dans votre propre dos.
C'est fini, mon vieux loup ! dit le chirurgien en abattant le second moignon.
— Bonsoir ! dit le zouave.
« Et il s'évanouit ».
Et je me rappelle, moi, le récit de la dernière campagne de Chine, fait par un brave matelot qui en riait encore de plaisir.
Il me raconta les prisonniers empalés le long des routes pour amuser le soldat ; les grimaces si drôles des suppliciés ; les massacres commandés par des officiers supérieurs, pour terroriser la contrée, les viols dans ces demeures d'Orient, devant les enfants éperdus, et les vols à pleines mains, les pantalons noués aux chevilles pour emporter les objets, le pillage régulier, fonctionnant comme un service public, dévastant depuis les petites cases du tout petit bourgeois jusqu'au somptueux palais d'été.
Si nous avons la guerre avec l'empire du Milieu, le prix des vieux meubles de laque et des riches porcelaines chinoises va baisser beaucoup, messieurs les amateurs.
La finesse
( Gil Blas , 25 décembre 1883)
Vraiment, l'esprit français semble malade. On l'a souvent comparé à la mousse de vin de Champagne. Or, tout vin longtemps débouché s'évapore, il en est de même de l'esprit, sans doute.
Nous avons gardé, il est vrai, quelque chose qui nous tient lieu d'esprit : la blague… Mais nous avons perdu la qualité première qui constituait la marque française : la Finesse.
Aujourd'hui, nous remplaçons cette antique qualité nationale par quelque chose de brutal, de grossier, de lourd. Nous rions sottement.
L'esprit, en France, avait plusieurs sortes de manifestations. On pouvait le classer par genres :
L'esprit des rues ;
L'esprit des salons ;
L'esprit des livres.
Qu'est-ce que l'esprit ? Le dictionnaire n'en donne point de définition. C'est un certain tour de pensée tantôt joyeux, tantôt comique, tantôt piquant, qui produit dans l'intelligence une sorte de chatouillement agréable et provoque le rire.
On appelle rire une gaieté particulière de l'âme qui se manifeste par des grimaces, des plis nerveux autour de la bouche, et des petits cris saccadés qui semblent sortir du nez.
Or, à Paris, le rapprochement imprévu, bizarre, de deux termes, de deux idées ou même de deux sons, une calembredaine quelconque, une acrobatie de langage fait passer à travers la ville un souffle de contentement.
Pourquoi tous les Français rient-ils, alors que tous les Anglais et tous les Allemands trouveront incompréhensible notre amusement ? Pourquoi ? Mais parce que nous sommes Français, que nous avons l'intelligence française et que nous possédons cette charmante et alerte faculté du rire.
Mais nous rions, aujourd'hui, pour des sottises tellement lourdes qu'on en demeure confondu.
Sous la Fronde, sous la Régence, sous la Restauration, sous Louis XVIII les mots qui couraient la ville avaient une verve agile, une pointe effilée, parfois même empoisonnée, et toujours une portée secrète. Derrière la drôlerie ou la perfidie du trait se cachait une pensée subtile. Cela sonnait clair comme de la bonne monnaie d'argent. Aujourd'hui l'esprit sonne faux comme du plomb.
Est-il possible vraiment que depuis quatre ou cinq ans tout l'effort de l'intelligence alerte de la France aboutisse à travers les mots v'lan et pschutt ! V'lan ! Pschutt ! Pourquoi V'lan ? Pourquoi Pschutt ? Qu'y a-t-il de drôle dans ces deux syllabes ? Quel flot de stupidité a donc noyé notre esprit ?
« En France, l'esprit court les rues », dit-on. On l'y rencontre cependant de moins en moins. Mais où apparaît le plus cette décadence, c'est assurément dans les salons.
La conversation y est généralement banale, courante, oiseuse, toute faite, monotone, à la portée de chaque imbécile. Cela coule, coule des lèvres, des petites lèvres des femmes qu'un pli gracieux retrousse, des lèvres barbues des hommes qu'un bout de ruban rouge à la boutonnière semble indiquer intelligents. Cela coule sans fin, écœurant, bête à faire pleurer, sans une variante, sans un éclat, sans une saillie, sans une fusée d'esprit.
On parle musique, art, haute poésie. Or il serait cent millions de fois plus intéressant d'entendre un charcutier parler saucisse avec compétence que d'écouter les messieurs corrects et les femmes du monde en visite ouvrir leur robinet à banalités sur les seules choses grandes et belles qui soient.
Croyez-vous qu'ils pensent à ce qu'ils disent, ces gens ? Qu’ils fassent l'effort de comprendre ce dont ils s'entretiennent, d'en pénétrer le sens mystérieux ? Non.
Ils répètent tout ce qu'il est d'usage de répéter sur ce sujet. Voilà tout. Aussi je déclare qu'il faut un courage surhumain, une dose de patience à toute épreuve, et une bien sereine indifférence en tout pour aller aujourd'hui dans ce qu'on appelle le monde et subir avec un visage souriant les bavardages ineptes qu'on entend à tout propos.
Quelques salons font exception. Ils sont rares.
Je ne prétends point qu'on doive dégager dans une causerie de dix minutes le sens philosophique du moindre événement, cet « au-delà » de chaque fait raconté, qui élargit jusqu'à l'infini tout sujet qu'on aborde.
Non certes. Mais il faudrait au moins savoir causer avec un peu d'esprit.
Causer avec esprit ? Qu'est-ce que cela ? Causer c'était jadis l'art d'être homme ou femme du monde, l'art de ne paraître jamais ennuyeux, de savoir tout dire avec intérêt, de plaire avec n'importe quoi, de séduire avec rien du tout.
Aujourd'hui on parle, on raconte, on bavarde, on potine, on cancane ; on ne cause plus, on ne cause jamais.
Berlioz a écrit dans une de ses lettres :
« Je vis, depuis mon retour d'Italie, au milieu du monde le plus prosaïque, le plus desséchant. Malgré mes supplications de n'en rien faire, on se plaît, on s'obstine à me parler sans cesse musique, art, haute poésie ; ces gens-là emploient ces termes avec le plus grand sang-froid : on dirait qu'ils parlent vin, femmes, émeutes ou autres cochonneries. Mon beau-frère surtout, qui est d'une loquacité effrayante, me tue. Je sens que je suis isolé de tout ce monde par mes pensées, par mes passions, par mes amours, par mes haines, par mes mépris, par ma tête, par mon cœur, par tout. »
Eh bien ! Savoir causer, c'est savoir parler vin, femmes, émeutes… et autres balivernes, sans que ce soit jamais… ce que dit Berlioz.
Comment définir ce vif effleurement des choses par les mots, ce jeu de raquettes avec des paroles souples, cette espèce de sourire léger des idées que doit être la causerie spirituelle ?
On s'embourbe aujourd'hui dans le racontage. Chacun raconte à son tour des choses personnelles, ennuyeuses et longues qui n'intéressent aucun voisin.
Et puis toujours la conversation se traîne sur les faits politiques du jour ou de la veille. Jamais plus elle ne s'envole d'un coup d'aile pour aller d'idée en idée, comme jadis.
Mais ce n'est point seulement de la conversation qu'a disparu la charmante finesse française. La société actuelle, composée presque exclusivement de parvenus récents, a perdu un sens délicat, une sorte de flair subtil, insaisissable, inexprimable, qui appartient presque exclusivement aux aristocraties lettrées et qu'on peut appeler : le sens artiste.
Читать дальше