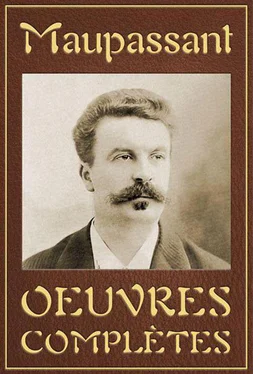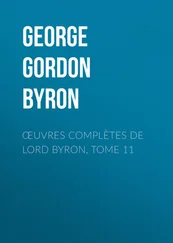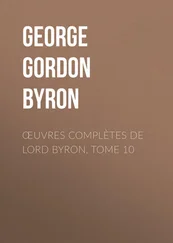Doué d’une intelligence remarquable, il semblait vivre dans un rêve fantastique comme dut le faire Edgar Poe. Il avait traduit en anglais un volume de surprenantes légendes islandaises que je désirerais ardemment voir maintenant traduites en français. Il aimait le surnaturel, le macabre, le torture, le compliqué, tous les détraquements cérébraux ; mais il parlait des choses les plus stupéfiantes avec un flegme tout anglais qui leur donnait, sous sa voix douce et tranquille, des allures de bon sens à rendre fou.
Plein d’un mépris hautain pour le monde, ses conventions, ses préjugés, sa morale, il avait cloué à sa maison un nom audacieusement impudent. Le patron d’une auberge déserte écrivant sur sa porte : « Ici on tue les voyageurs ! » ne ferait pas une plus sinistre facétie.
Je n’avais point pénétré chez lui quand je reçus une invitation à déjeuner à la suite d’un accident arrivé à un de ses amis, qui avait failli se noyer et que j’avais voulu secourir.
Bien qu’accouru après le sauvetage, je reçus les remerciements empressés des deux Anglais, et je me rendis chez eux le lendemain.
L’ami était un garçon d’une trentaine d’années qui portait sur un corps d’enfant, — un corps sans poitrine et sans épaules, — une tête énorme. Un front démesuré, qui semblait avoir dévoré tout le reste de l’homme, se développait comme un dôme au-dessus d’une mince figure, terminée en fuseau par la barbiche d’un menton pointu. Les yeux aigus et la bouche fuyante donnaient l’impression d’une tête de reptile, tandis que le crâne magnifique éveillait l’idée du génie.
Une trépidation nerveuse agitait cet être singulier qui marchait, remuait, agissait par saccades, comme aux secousses d’un ressort détraqué.
C’était Algernon-Charles Swinburne, fils d’un amiral anglais et petit-fils, par sa mère, du comte d’Ashburnham.
Sa physionomie, troublante, inquiétante même, se transfigurait quand il parlait. J’ai rarement vu un homme plus saisissant, plus éloquent, plus incisif, plus charmant dans l’action de la parole. Son imagination rapide, claire, suraiguë et fantasque semblait glisser dans sa voix, faire vivants et nerveux les mots. Son geste à sursauts scandait sa phrase sautillante qui vous pénétrait dans l’esprit comme une pointe, et il avait soudain des éclats de pensée, comme les phares ont des éclats de feu, de grandes lumières géniales qui semblent éclairer tout un monde d’idées.
La maison des deux amis était jolie et peu ordinaire. Partout des tableaux, parfois superbes, parfois étranges, fixant des conceptions d’aliénés. Une aquarelle, si je me souviens bien, représentait une tête de mort naviguant dans une coquille rose, sur un océan sans limites, sous une lune à figure humaine.
De place en place, on rencontrait des ossements. Je remarquai surtout une affreuse main d’écorché qui gardait sa peau séchée, ses muscles noirs mis à nu, et sur l’os, blanc comme de la neige, des traces de sang ancien.
La nourriture me parut une énigme que je ne devinais pas. Était-ce bon ? Était-ce mauvais ? Je ne le pourrais établir. Un rôti de singe m’ôta l’envie de manger ordinairement de cet animal ; et le grand singe en liberté qui rôdait autour de nous et me poussait, par farce, la tête dans mon verre quand j’allais boire, m’enleva tout désir d’avoir un de ses frères pour compagnon de tous les jours.
Quant aux deux hommes, ils m’ont laissé l’impression de deux esprits singulièrement originaux et remarquables, totalement bizarres, appartenant à cette race particulière d’hallucinés de talent dont sont sortis Poe, Hoffmann et d’autres encore.
Si le génie est, comme on le croit communément, une sorte de délire des grandes intelligences, Algernon-Charles Swinburne est assurément un homme de génie.
Les vastes esprits raisonnables ne sont jamais considérés comme géniaux, tandis qu’on prodigue une sublime qualification à des cerveaux souvent de second ordre, mais qu’agite un peu de folie.
Dans tous les cas, ce poète reste un des premiers de son temps par l’originalité de son invention et la prodigieuse habileté de sa forme. C’est un lyrique exalté, un lyrique forcené qui ne se préoccupe guère de cette humble et bonne vérité que recherchent aujourd’hui si obstinément et si patiemment les artistes français, mais qui s’évertue à fixer des songes, des pensées subtiles, tantôt ingénieusement grandioses, tantôt simplement enflées, parfois aussi magnifiques.
Deux ans plus tard, je trouvai la maison fermée, les hôtes partis, on vendait les meubles. J’achetai, en souvenir d’eux, la hideuse main d’écorché. Sur le gazon, un énorme bloc carré de granit portait gravé ce simple mot : « Nip ». Au-dessus, une pierre creuse, pleine d’eau, offrait à boire aux oiseaux. C’était la sépulture du singe, pendu par un jeune domestique nègre et vindicatif. Ce serviteur violent s’était ensuite enfui, disait-on, devant le revolver du maître exaspéré. Mais, après avoir erré sans toit, ni pain, pendant plusieurs jours, il reparut et se mit à vendre des sucres d’orge par les rues. Il fut définitivement expulsé du pays après avoir étranglé aux trois quarts un consommateur mécontent.
La terre serait plus gaie si on rencontrait souvent des intérieurs comme celui-là.
FIN
Pot-pourri
( Le Gaulois , 3 janvier 1883)
Comme elle est étrange cette foule des jours de fête, gauche, maladroite, endimanchée, drôlement inhabile à circuler, à se ranger, encombrant les trottoirs, sorte de pâtée grouillante, macaroni humain dont on peut couper les fils.
Et regardons les têtes ! Des têtes de petite ville, des têtes mal coiffées, des têtes grotesques. Ce sont les provinciaux de Paris qui passent.
Les provinciaux de Paris restent les plus endurcis des provinciaux, ceux que rien ne civilisera jamais.
Ils ne savent rien, ne soupçonnent rien de la vie ardente, passionnée, énervante et précipitée de la grande ville qu'ils habitent. Ils sont à Paris comme ils seraient à Clermont-Ferrand, et cela uniquement parce qu'ils sont nés dans une peau de provincial, nés pour habiter une petite ville. Ils sont fermés.
Leurs préoccupations restent bornées par le souci du ménage et de la place qu'ils ont ; leurs idées sont limitées par quelques principes transmis dans la famille et quelques notions de politique ; leurs passions n'ont pas d'envergure.
Beaucoup, pourtant, ont vu le jour à Paris, issus de parents parisiens ; et voilà encore les plus provinciaux de tous. Leur rue, leur quartier et leurs quelques connaissances arrêtent leur horizon.
Dans le bas, ce sont de petits marchands rivés à leur comptoir ; la débitante de tabac qui depuis douze ans n'a fait d'autres promenades que celles du boulevard aux jours de fête.
Dans le haut, des employés, des fonctionnaires endormis dans leurs habitudes régulières, gens qui vous invitent à leur dîner de famille et vous font retrouver des sensations oubliées depuis vingt ans, avec de vieux souvenirs de la maison paternelle.
Ils vous servent encore du vol-au-vent, et des petits gâteaux comme on en a mangé dans sa première jeunesse, et des confitures dans un pot de verre évasé.
Et rien ne les pourrait dégourdir. Ils forment une race, la race de province. Cela est dans leur nature, dans leur constitution, dans leur sang. On croit souvent que ce provincialisme tient à leur position modeste, non pas, car on rencontre à tout moment quelque employé à deux mille francs ; tapis tout le jour dans quelque sombre bureau, et sortant de là pour courir la ville, les théâtres, les salons, Parisien jusqu'aux moelles à qui rien n'échappe de toutes les nuances infinies, imperceptibles, bizarres, opposées et diverses dont est fait l'esprit parisien.
Читать дальше